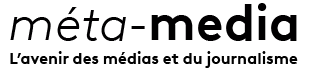Méta-talk #1 : “Je t’aime, moi non plus” — Créateurs et journalistes face à l’info

En décembre 2024, Méta-Media, en partenariat avec le CLEMI et LUMNI, lançait son premier live sur Twitch avec « Méta-talk : Journaliste-Influenceur : Décryptage d’une relation ‘Je t’aime, moi non plus' ». Pendant une heure et quarante minutes, Adeline Hulin, Jean Massiet, Justine Reix et Samuel Etienne ont confronté leurs points de vue sur les liens complexes et ambivalents entre journalistes et créateurs de contenu, à une époque où les réseaux sociaux sont devenus l’un des principaux canaux d’accès à l’information.
Faut-il distinguer strictement journalistes et créateurs de contenu ? Comment ces profils aux logiques différentes peuvent-ils, ensemble, mieux servir l’information ? Telles étaient les questions centrales de la discussion, animée par Alexandra Klinnik.
Ce premier direct prolonge les réflexions amorcées dans le cahier de tendances #23 de Méta-Media, intitulé Journaliste-Influenceur : Moins de média, plus de service ? Il approfondit les questionnements soulevés par ce numéro sur l’évolution des formats, des postures et des pratiques dans un paysage médiatique en pleine mutation.
Le journalisme : une démarche plutôt qu’un statut
Le journalisme ne se limite pas à un titre ou à une carte de presse. C’est avant tout une méthode, un cadre rigoureux qui impose des règles précises de vérification et de hiérarchisation de l’information. Samuel Étienne insiste sur cette approche : être journaliste, c’est s’inscrire dans une démarche exigeante, fondée sur une quête d’honnêteté intellectuelle et un engagement moral envers le public. Ce n’est pas tant le statut qui définit le journaliste, mais la rigueur avec laquelle il traite et transmet l’information.
Une vision que partage Adeline Hulin, qui considère le journalisme comme une fonction transverse, exercée par des profils variés. L’essence du métier, selon elle, réside dans la capacité à rapporter des faits vérifiés, nouveaux et d’intérêt public.Mais au-delà de cette exigence, une question demeure : la neutralité doit-elle être un idéal journalistique ? Une interrogation centrale à une époque où l’opinion et l’analyse s’entrelacent avec l’information brute. Sur ce point, Samuel Étienne tranche : « Mieux vaut une subjectivité assumée plutôt qu’une objectivité proclamée. » Une approche que Justine Reix nuance en rappelant que la neutralité absolue est un mythe : « Personne n’est neutre, c’est quelque chose qui touche tous les secteurs. Un journaliste n’est pas neutre, un historien n’est pas neutre. On a tous des biais. » Dès lors, la transparence sur ces biais semble primordiale pour maintenir un lien de confiance avec le public.
La publicité : un point de tension
Ce qui suscite des crispations autour de la double casquette journaliste-créateur de contenu, c’est la question de la publicité. Jean Massiet rappelle qu’il existe une incompatibilité historique entre la fonction de journaliste et la publicité commerciale, bien que cette dernière soit aussi présente dans les médias traditionnels.
Pour Justine Reix, le problème avec la publicité chez les journalistes-influenceurs réside dans la fusion des rôles : une même personne peut à la fois informer et promouvoir un produit. À l’inverse, dans les médias classiques, les encarts publicitaires sont gérés par un service distinct. Elle cite l’exemple de Hugo Décrypte, qui tente de ne plus porter le message publicitaire en confiant la narration et la gestion de ses publicités à d’autres personnes dans certaines de ses vidéos.
Avec la montée en puissance des influenceurs et leur poids croissant dans l’écosystème médiatique, les pouvoirs publics ont dû intervenir. Désormais, les créateurs sont tenus par la loi d’indiquer clairement tout contenu sponsorisé.
L’éducation aux médias : un enjeu clé
Dans un paysage où les repères traditionnels de l’information s’effacent au profit d’un écosystème plus fragmenté, l’éducation aux médias apparaît comme un levier essentiel. Trop souvent, le grand public ignore les différences fondamentales entre publicité, publirédactionnel et journalisme culturel, des zones grises exploitées aussi bien par des marques que par certains acteurs de l’information.
Cette méconnaissance est en partie alimentée par des catégories trop vastes pour être pertinentes. Samuel Étienne met en garde contre l’usage des expressions « les médias » et « les influenceurs », qu’il considère comme des concepts flous ne reflétant pas la diversité des réalités qu’ils recouvrent.
Face à ces enjeux, former le public à décrypter ces dynamiques devient essentiel. Le CLEMI et LUMNI, partenaires de l’émission, jouent un rôle clé dans cette mission : donner aux jeunes générations les outils pour naviguer dans un espace médiatique en constante évolution, où l’information cohabite avec la communication et la publicité.
Et ce n’est qu’un début : restez connectés pour ne pas manquer le prochain épisode de Méta-Talk !