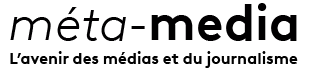Fabrice Arfi « La vérité n’est plus qu’une opinion comme une autre »

« Je suis tout sauf un crevard du scoop » : Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes à Mediapart, publie en novembre 2024 La Troisième Vie, fruit de seize années d’investigation sur un espion roumain présumé. Dans cet entretien, il revient sur la genèse de cette obsession, et défend sa vision du journalisme, à l’ère où le vrai et le faux se brouillent.
Propos recueillis par Alexandra Klinnik, MediaLab de l’Information de France Télévisions
D’ordinaire Fabrice Arfi traque les crimes d’argent et de sang. Mais cette fois, pas d’éclaboussures ni de scoop. Simplement une obsession tenace. En 2024, il publie La Troisième Vie, une enquête consacrée à Vincenzo Benedetto, un Roumain arrivé en France en 1969, soupçonné d’être un espion. L’histoire lui est confiée en 2008 par un ancien agent du contre-espionnage français aujourd’hui à la retraite. Sans crier gare, Benedetto devient une obsession. Qui est-il ? Quelles sont ses motivations profondes ? Est-il vraiment le neveu qu’il prétend être, dans cette famille d’origine italienne qu’il aurait infiltrée ? Pendant seize ans, le journaliste déterminé noircit des carnets, fouille les archives de Paris, Vincennes, Lyon, Villeurbanne, voyage en Roumanie, s’immerge dans l’histoire du renseignement. Il croise les écrits de Georges Steiner sur l’espionnage, de Jacques Derrida sur le mensonge. Mais rien n’y fait : les certitudes, d’ordinaire offertes par l’enquête, se dérobent à celui qui a l’habitude que « le réel lui offre un retour sur investissement. »
La Troisième Vie n’est pas tant une enquête sur un homme qu’un récit d’apprentissage sur la nature fuyante du réel. Dans cet échange, Fabrice Arfi évoque, entre autres, son rapport aux sources (il ne se « bouche jamais le nez » et « parle à tout le monde, des gens qui ont fait de la prison à ceux qui leur courent après »), le rôle du journalisme dans un monde saturé d’opinions, la confusion croissante entre communication et information… Surtout, il insiste sur la nécessité vitale de préserver une grammaire commune à l’heure où l’on ne s’accorde même plus sur « deux et deux font quatre ».
C’est une histoire qui vous a poursuivi pendant seize ans. Pourquoi une telle obsession ?
Au départ, il s’agit d’une obsession très journalistique face à l’histoire de cet homme qui infiltre une famille qui n’est pas la sienne pour se fondre dans une communauté française. Ma réaction est celle d’un journaliste d’enquête : il faut retrouver des témoins, consulter les archives, comprendre le sens de cette mission, de la tromperie. Au fil de mon travail, j’accepte d’enlever ma casquette de détective pour m’interroger sur la nature même du réel. Quelles sont les armes du réel ? Où commence-t-il ? Où s’arrête-t-il ? Qu’est-ce que peut le réel face à la fiction des autres ? L’espionnage est un terrain idéal pour y répondre. L’espionnage, c’est une fiction d’État ! L’agent secret incarne cette fiction, avec des objectifs politiques, industriels, idéologiques. J’ai dû me défaire de certains prérequis, et admettre que les faits accumulés ne font pas une vérité. Au fond, j’enquêtais sur le rapport qu’un journaliste entretient avec la vérité. J’ai un copain, qui m’a dit très gentiment : « En lisant ton livre, on comprend que même les impasses mènent quelque part »
L’une de vos conclusions est qu’un journaliste peut être victime de ses propres biais. C’est une leçon d’humilité…
Un journaliste n’est pas un robot, ni un comptable grisâtre du réel. Le réel n’est pas une grille analytique dans laquelle on coche des cases. Dès l’instant où l’on choisit un sujet plutôt qu’un autre, on fait un choix. Ce choix est, par nature, subjectif. On décide de ce qui compte, ce mois-ci, ce jour-là dans l’actualité. C’est là que réside la subjectivité. Qu’un journal ait des engagements — plus progressistes ou plus conservateurs, selon les sujets — me semble parfaitement légitime. Je suis attaché à la liberté, et c’est précisément pour cela que le pluralisme est essentiel. Je suis très libéral sur ce point : chacun fait comme il veut. Moi-même, je ne suis pas toujours d’accord avec moi-même, ni avec mon propre journal. Ce qui compte avant tout, c’est l’honnêteté, l’indépendance et la sincérité dans le travail. Rendre compte du réel de la manière la plus intègre possible, en respectant les points de vue, le contradictoire et, surtout, les faits.
S’il y a bien une chose dont je suis persuadé, c’est que ce sont les faits qui forgent les opinions, et non l’inverse. Certes les journalistes ont une place privilégiée pour pouvoir donner leurs opinions, mais ce n’est pas leur métier. Notre fonction sociale, c’est l’information. Une information utile n’a pas besoin d’être enrobée d’opinion pour être puissante. L’information doit venir avant les opinions.
Dans votre livre, vous évoquez un échange marquant avec le réalisateur Xavier Giannoli au cours duquel il parle de « l’effet Koulechov ». Vous parlez alors d’une véritable « révélation »…
En 2016, lors d’une discussion avec Xavier Giannoli autour de l’adaptation de mon précédent livre D’argent et de sang, il mentionne au détour de la conversation l’effet Koulechov, du nom du cinéaste russe. Je ressens alors une sorte de déflagration mentale — comme ces mèmes sur les réseaux sociaux, où le cerveau explose. J’ai compris, chimiquement, ce qu’est un biais — en l’occurrence, un biais cognitif. L’effet Koulechov, c’est l’idée que deux images juxtaposées changent notre perception, alors que l’une des deux est exactement la même. Et pourtant, on ne la voit pas pareil. C’est fascinant. Il m’a offert, ce jour-là, la clé de ce que j’essayais de raconter avec cette histoire. C’est d’ailleurs ce que je préfère quand je discute du livre avec les lecteurs et lectrices : chacun a une interprétation différente de l’histoire de Benedetto. Certains sont convaincus qu’il n’était pas du tout un espion. D’autres, comme moi, en sont absolument certains. L’effet Koulechov fonctionne : chacun projette ce qu’il veut dans ce qu’il regarde. La perception n’appartient pas seulement au journaliste qui écrit, mais aussi au lecteur ou au spectateur. On ne voit jamais tous la même chose. J’adore quand une discipline sert à en éclairer une autre. La solution du journalisme se trouve dans la littérature, les mathématiques, la sociologie, le cinéma. Je crois profondément à l’interdisciplinarité.
D’ailleurs, dans le livre, vous êtes un peu historien, à la recherche d’archives… Je pense qu’un journaliste est un peu tout à la fois. J’ai une vision haute — sans doute prétentieuse — de notre métier. Pour moi, un journaliste est à la fois anthropologue, sociologue, historien, détective… C’est un mélange de tout ça. Parfois même, certains journalistes sont des penseurs, des intellectuels. Je ne crois pas faire partie de cette catégorie. Mais c’est ça qui rend ce métier si fascinant : c’est un creuset extrêmement malléable, capable d’absorber toutes les sciences sociales.
Quelle différence faites-vous entre conviction et certitude ?
C’est une très bonne question. Pour moi, la conviction, c’est une certitude pour soi. Tandis que la certitude, c’est quelque chose que l’on peut énoncer publiquement. Un fait certain, s’il relève de l’intérêt général, est un fait qu’un journaliste doit rendre public et au public. Il nous incombe, en tant que journalistes, de publier ce qui est d’intérêt public — à n’importe quel prix sauf à quelques rares exceptions. Il y a une limite : celle de l’intégrité physique. Dès que cette intégrité est en jeu, je m’arrête immédiatement. Il n’y a pas de débat. Cela m’est déjà arrivé. J’ai déjà accepté de ne pas publier une information à la demande d’une autorité, après les attentats de 2015 à Paris. Les terroristes n’avaient pas encore été trouvés. J’avais eu accès à des informations sur des choses qui avaient été découvertes dans une poubelle devant le Bataclan, puis dans une voiture laissée par Abdeslam. On m’a expliqué pourquoi la révélation de ces éléments, qui relevaient de l’intérêt public, risquait de mettre en péril l’enquête. Je n’ai pas hésité une seconde. Je ne suis pas un « crevard du scoop ». J’adore révéler des informations, mais mon cœur ne palpite pas professionnellement pour ça.
Pendant seize ans, vous êtes resté focalisé sur la même histoire. Avez-vous avez un rapport obsessionnel à la vérité ?
Je ne pense pas. Pour une raison simple : je ne sais pas ce qu’est la vérité. Je ne suis ni curé, ni rabbin, ni imam, ni philosophe – et je ne suis même pas sûr qu’ils le sachent davantage. En revanche, ce qui m’importe, c’est « la vérité de fait », dont parle brillamment Hannah Arendt, peut-être la plus journaliste des philosophes. Je suis obsessionnel du factuel, de faits bruts, durs, de faits qui contiennent des vérités contraignantes. Le fait vous oblige à vous confronter à vous-même. Les faits offrent une grammaire commune. C’est ce que les journalistes apportent : un langage commun qui permet à la société de débattre. Pas pour être d’accord – mais pour ne pas être d’accord ensemble, de manière civilisée. La démocratie, c’est organiser le dissensus. Or, pour débattre, encore faut-il s’entendre sur ce qui est. Ce n’est pas un mojito, c’est une citronnade. Voilà un verre, une paille, une cuillère. On n’est même plus d’accord sur « deux et deux font quatre ». Aujourd’hui, on est très désarmé pour faire société ensemble parce qu’on n’a plus de grammaire commune.
Quand on perd cela, on se perd collectivement. On se replie dans des bulles de réassurance, chacun dans son couloir. On parle de post-vérité, où la vérité n’est plus qu’une opinion comme une autre. A ce moment-là, la conversation devient impossible. La confrontation est évidente. De là naissent des drames. Le vrai danger, comme le rappelait Hannah Arendt en auscultant les totalitarismes du XXe siècle, ce n’est pas le nazi ou le stalinien convaincu. C’est l’effacement progressif de la frontière entre le vrai et le faux – un glissement dans lequel nous pouvons tous sombrer. On devient fous, collectivement. On voit bien ce que ça donne : des Trump, Bolsonaro, Berlusconi, Orbán… Ce n’est pas seulement une affaire d’extrême droite. Le fond de l’air est très post-fasciste. Mais la gauche a aussi produit ses monstres. Les pouvoirs autoritaires, les islamistes, les fanatismes de toutes sortes : ils ont besoin de l’ignorance pour régner. C’est pourquoi, plus que jamais, le travail des journalistes est crucial.
Dans le livre collectif Informer n’est pas un délit, co-écrit avec quinze autres reporters, il est question de la place grandissante de la communication, qui tend à supplanter celle de l’information. Ce glissement, de plus en plus perceptible, semble désormais poser peu de problèmes à nombre de journalistes eux-mêmes…
Absolument. Laurent Richard en a fait un très bon chapitre. Le problème, c’est la collusion, la connivence, la complicité. Ça commence dès l’université, avec les filières « info-com ». L’université met dans un même vocable deux adversaires ! C’est antagoniste. Le simple fait qu’elles s’adressent toutes deux au public ne suffit pas à les faire appartenir au même univers. Le journalisme cherche à trouver ce que la communication souhaite ne pas montrer. La com’ est une version dégradée de la publicité. Les communicants ont des mandataires. Ils travaillent pour le compte de. Quand un journaliste prend un communicant ou un attaché de presse comme « source », il se trompe de registre. Ce n’est pas une source, c’est un représentant. Ce qui est terrible est de voir comment le journaliste est devenu l’otage consentant de la communication. C’est sidérant de voir comment des mots de la communication politique sont devenus des mots du journalisme. Le mot « séquence », par exemple. Issu du cinéma, repris par la com’, il est devenu courant chez les journalistes : « le président est dans une séquence » … Le journalisme politique a intégré ce qui le détruit.
Et puis, il y a l’argent. La communication est puissante car elle est financée. Elle dispose de moyens colossaux. On est bien peu de choses avec nos calepins. Le combat est inégal. C’est douloureux, mais c’est pour ça qu’il faut le mener. D’où l’importance des consortiums, du travail en réseau, de la solidarité entre médias, même concurrents. La camaraderie, dans ce métier qui en manque beaucoup, c’est important. Ce n’est pas une question de confraternité corporatiste. Je suis très triste de voir à quel point chaque journal est dans son couloir. Si un journal sort une histoire, il en est quasi-propriétaire, les autres s’en intéressent moins. Comme si l’information n’appartenait pas à tout le monde.
Comment déterminez vous qu’une source mérite votre confiance ?
Je pars du principe qu’un journaliste doit vraiment parler à tout le monde. C’est sa qualité première. Je n’ai pas de rapport moral à mes sources. J’ai un rapport moral au monde, aux sujets que je traite. Je ne me bouche pas le nez. Si on s’intéresse à la corruption, je veux parler à des corrupteurs, des intermédiaires, des gens qui ont fait de la prison, ceux qui leur courent après, les juges, les procureurs, les ministres, les fraudeurs. On ne fait jamais confiance à une source à 100%. Une source, presque toujours, a un intérêt à parler. Ce n’est pas un problème tant qu’on en est conscient. Ce qui compte, c’est de comprendre quel est cet intérêt : personnel, politique, géopolitique, commercial. Et surtout, ne pas être prisonnier de cet intérêt. C’est la seule manière d’éviter que notre plume serve, malgré nous, l’agenda de quelqu’un.
Le bon journalisme, c’est celui qui croise les sources, qui confronte les points de vue divergents. Les sources désintéressées, celles qui parlent par pure indignation, qui se mettent en danger simplement parce qu’elles estiment qu’il faut le faire, existent — mais ce n’est pas la majorité des gens. Il faut les chercher, les écouter, parfois les convaincre. Ce n’est pas aux sources que je fais confiance, mais en ma capacité à vérifier ce qu’elles me disent. Si une source nous trompe, et qu’on publie une mauvaise information, c’est notre faute. Ce n’est pas celle de la source. On n’avait qu’à mieux vérifier. C’est pourquoi je trouve sain que le journalisme soit responsable devant la loi. On a un pouvoir immense sur la vie des gens. Même quand on écrit sur Sarkozy, des gens très puissants. Quand on écrit sur des gens qui n’ont pas les moyens de se défendre, on fait beaucoup de mal. Ce n’est pas rien d’écrire sur quelqu’un. C’est hyper violent.
Vous vous décrivez comme un « sombre optimiste ». Vous dites : « C’est quand ça va mal qu’il faut se battre »…
Si je ne suis pas optimiste, j’arrête. C’est quand on a moins de libertés qu’il faut les défendre. Ce serait bien pire sans ce travail. Il faut continuer, même quand ça échoue. Ne pas renoncer à la condition collective. Parfois, une grande enquête ne change rien. Mais un jour, ça prend. Et même quand ça ne marche pas, on travaille pour l’histoire, pour les archives. Sinon, je pose le stylo, je fais autre chose.
L’information est un service public, même dans un média privé. Mon optimisme n’est pas béat. Il est inquiet. Quand je dis sombre optimisme, il faut regarder l’épaisseur de l’obscurité. Je suis né en 1981. Enfant de la classe moyenne dans une démocratie, je n’ai jamais manqué de rien. Le mot « multiculturalisme » était un joli mot. L’antiracisme allait de soi. L’antisémitisme n’avait pas connu une telle résurgence. Et aucun candidat à l’élection présidentielle ne disait que Pétain avait sauvé des juifs. Aujourd’hui, 44 ans plus tard, j’ai le sentiment de vivre l’Histoire avec un grand H, en direct. Adolescent, je me suis toujours demandé : Quand est-ce qu’on a conscience qu’on vit l’Histoire ? Comme n’importe quelle génération, nous avons vécu des choses historiques dans nos vies. J’ai vu tomber Ceaușescu, le mur de Berlin, j’ai vécu le 11 septembre, les attentats… Les événements historiques ne font pas toujours l’Histoire en soi. Mais aujourd’hui, on vit mondialement l’Histoire avec un grand H. Elle s’écrit au mépris du journalisme. On assiste à une entreprise massive, internationale, de destruction des faits, du journalisme, avec des autocrates tels que Trump, Poutine, le leader chinois… C’est ça qui me rend sombre. Et pourtant. Je vois émerger une génération plus libre, débarrassée de certains poids qui freinaient la mienne. Ça me rend optimiste.

Couverture du livre de Fabrice Arfi, publié aux Éditions Seuil