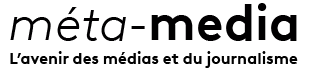Un outil pour démasquer les deepfakes ?
Par Pascal Doucet-Bon, France Télévisions, directeur délégué de l’Information
Les deepfakes domineront bientôt la scène politique via la généralisation d’outils de fabrication à moindre coût. Situés en première ligne de la désinformation, les journalistes ont besoin d’outils solides pour les identifier. A l’occasion de l’ONA, Matthew Wright, professeur au Rochester Institute of Technology présente en exclusivité un outil de débunkage.
Un outil technologique efficace bientôt à disposition
Matthew Wright a mis au point DeFake un outil technologique permettant d’identifier les deepfakes. Il suffit d’uploader la vidéo pour que soient analysés des paramètres tels que les pixels, le son ou la lumière (liste volontairement non exhaustive, pour raison de sécurité). En quelques minutes, l’outil permet de savoir si la vidéo est fiable ou pas. L’outil sera lancé en version beta courant octobre.
Source : Conférence ONA 2019.
L’ère des deepfakes est devant nous
Les deepfakes vont défier notre référentiel de vérité. Pour les identifier, une collaboration efficace entre les ingénieurs informatique et les journalistes sera nécessaire.
‘Deep fakes will challenge the standards of evidence’ for journalists and law enforcement #deepfakes #ONA19debunk pic.twitter.com/sbapSywhy4
— Tawanda Kanhema (@KanhemaPhoto) September 14, 2019
« Nous aurons bientôt besoin d’un niveau très élevé d’éducation aux médias de la part de toute la population » souligne Matthew Wright.
Et Jérémy Gilbert, directeur stratégique au Washington Post ajoute « Dans la littérature, il peut y avoir de la fiction, de la fiction historique. En tant que société, nous serons amené à labelliser les productions de contenus. »
Joan Donovan, directrice technologie à la Harvard Kennedy School, commente « Nous devons mettre en place des gardes-fous contre les deepfakes en nous mettant à la place des victimes. C’est le seul moyen d’éviter l’accroissement des inégalités dans l’éducation aux média »
Une réserve cependant : comment partager massivement un outil de débunkage sans qu’il serve d’outil d’auto-test aux deepfakers ?
Crédit photo Une : Complément d’enquête sur les deepfakes.
Reuters invente le stress test pour journalistes
Par Pascal Doucet-Bon, France Télévisions, directeur délégué de l’Information.
Hazel Baker est persuadée que les journalistes ne jouent pas à se faire peur, que les progrès de la création de personnages de synthèse sont ultra rapides, et que les deepfakes ultra réalistes seront bientôt là. C’est aussi l’avis de tous les chercheurs présents cette à La Nouvelle Orléans pour l’ONA, la conférence annuelle du journalisme en ligne aux Etats-Unis.
« Vous ne la trouvez pas bizarre, cette vidéo ? J’ai attiré leur attention en disant que j’avais un doute, mais c’est tout. Je suis restée vague, parlant d’un sentiment diffus. » Hazel Baker, Directrice de la vérification de l’UGC, Reuters.
« Je me suis adressée à la société Synthesia pour réaliser ces vidéos en Français. L’image est en partie réelle. Seul le bas du visage est modifié pour faire dire à la présentatrice un texte enregistré par une autre, totalement différent, de ce qu’elle dit en réalité. » C’est un deepfake typique.
« Nous poursuivions deux buts : comprendre dans le détail comment un deepfake est fabriqué, et mesurer notre éventuelle vulnérabilité. »
Bien sûr, Hazel Baker a présenté la vidéo à son équipe sans les « masques verts » visibles sur le document partagé sur internet. Les journalistes de Reuters, intrigués par les doutes de leur patronne, n’ont pas validé cette video. Celle-ci n’aurait donc pas pu être envoyée aux clients de Reuters (dont France Télévisions fait partie). Ils sentaient eux-aussi que quelque chose n’allait pas.
« Certains ont invoqué la lumière (sic), d’autres une simple désynchronisation du son et de l’image, qui appelait une vérification technique. Aucun n’a prononcé le mot « deepfake ».
Hazel Baker va-t-elle renouveler l’expérience ? « Je ne l’exclue pas, dit-elle, même si tout cela a un coût » -nous ne saurons pas lequel-, »mais d’autres manipulations moins chères sont possibles, et je pense qu’il faudra tester nos capacités de détection régulièrement. »
Battre Netflix, c’est possible. La TV publique finlandaise l’a fait !
La dernière fois que nous avions échangé — il y a un peu moins de deux ans — Netflix était devenu la 1ère chaîne de télé en Finlande. Aujourd’hui, les dirigeants de l’audiovisuel public finnois l’affirment haut et fort : Yle Areena est bien désormais la première plateforme de vidéos à la demande à la pointe des nouveaux usages numériques. Un quart des habitants de ce pays nordique la consulte chaque jour.

En Suède, la situation est quasiment la même : « nous sommes aujourd’hui au coude à coude avec Netflix, loin devant toutes les autres TV, grâce à un bond cette année de 60% du visionnage sur notre player ; comme Netflix d’ailleurs ! », a indiqué la patronne de la SVT, Hanna Stjärne, lors de la conférence annuelle des TV et radios publiques mondiales.
La SVT pourrait même bien se retrouver d’ici peu l’unique groupe de TV de Suède après la vente probable de la grande chaîne privée concurrente (sûrement à un telco), a indiqué sa DG. Une situation bien étrange. Qui va avec de fortes responsabilités.

A Helsinki, la clé de la réussite de Yle – même si Netflix reste en tête pour les 15-30 ans– a été la transformation d’Areena d’un site de « catch-up » (visionnage TV en différé) à un vrai site de destination vidéo, a expliqué Gunilla Ohls, directrice de la stratégie de Yle, assorti évidemment d’un allongement des droits d’exploitation des contenus en ligne (de 3 à 5 ans dont un an d’exclusivité).
Ce qu’elle omet de rappeler c’est aussi l’intégration numérique drastique entamée chez Yle dès 2012, les importantes économies consenties pour y investir, l’utilisation réelle et croissante des données pour améliorer les contenus. Chez Yle, l’expertise des conseillers de programmes ne suffit plus. Pour le public de moins de 45 ans, la priorité est désormais aux données.

Yle a aussi subi une forte réduction de ses effectifs passés de plus de 5.000 personnes à environ 3.000 en quelques années ; le passage des populistes au pouvoir à Helsinki ayant ratiboisé la taxe TV.
Mais les résultats sont spectaculaires : Yle touche chaque semaine 94% des Finlandais. Et chaque jour 78% d’entre eux. Son seul player vidéo/audio Areena, gratuit, sans pub, et qui se développe donc très vite, en atteint 60% chaque semaine (49% des 15-44 ans) et 25% quotidiennement.
Pas de news sur Areena mais de plus en plus de podcasts. L’appli dédiée à l’info + l’info TV permet, de son côté, de toucher aujourd’hui 70% de la population.

Les défis n’ont pas pour autant disparu
Pour Yle, il y en a deux grands :
- Comment parler aux moins de 30 ans ? Eux, dont les habitudes ont incroyablement changé : les jeunes finlandais ne regardent plus que 10 mn en moyenne de TV classique chaque jour ! Yle a bien lancé Kioski, une plateforme d’infos pour les jeunes qui utilise essentiellement YouTube et Instagram.

Mais elle aimerait bien les amener sur son principal player, Areena.
Elle y est parfois parvenue, notamment avec « Au pair », un reality show destiné aux jeunes finlandaises et avec une série d’épisodes courts sur les jeux vidéo pour son public masculin.
- Comment accélérer la personnalisation des contenus ? Le débat sur un log-in obligatoire n’est toujours pas tranché. L’idée d’un pass numérique commun avec les autres médias du pays est à l’étude.

Un autre défi est celui d’une plus grande liberté à donner (ou pas) à la plateforme Areena, qui, pour l’instant, travaille très étroitement avec les équipes traditionnelles de la TV et de la radio.
Aujourd’hui Yle ne vend plus rien d’exclusif à Netflix. Et ses relations aux réseaux sociaux changent constamment. La prudence est désormais de mise.
En Suède, la priorité est à la proximité avec le public pour accentuer le recentrage du groupe sur l’audience. Par des entrevues physiques (les fameux cafés « Fika » dans tous les pays) et via les données. La SVT a même créé une direction data mise au même niveau que les autres grandes directions du groupe.
La coopération avec les autres TV nordiques se renforce encore
Un des secrets de la réussite nordique c’est aussi la coopération très ancienne entre les acteurs publics régionaux. L’association Nordvision, qui existe depuis 1959, accélère actuellement pour partager entre ses membres les fameuses grandes fictions nordiques.

Depuis l’an dernier, Nordvision permet de mettre à disposition 12 séries par an avec un an de droits d’exploitation. Fin 2019, ce seront donc 200 épisodes de fiction de grande qualité qui seront à la disposition des publics de ces pays. De quoi commencer à mieux rivaliser avec les catalogues des géants américains. Le pari est évidemment d’être bien meilleur sur les contenus locaux.
Mais le Reuters Institute a jeté un froid : la BBC à 1,5% de part de marché !
Publiant justement cette semaine son étude sur les défis des audiovisuels publics, son directeur, Rasmus Kleis Nielsen, a sidéré leurs dirigeants à Helsinki avec des chiffres de la BBC, pourtant souvent présenté comme un exemple de transformation réussie.
Si la BBC capte toujours aujourd’hui 63% du temps radio des britanniques, et 31% de leur temps télé, elle ne représente plus que… 1,5% de leur temps consacré aux médias numériques. On est bien passé du « one media to many people » à « many media to many people ». Même si dans le même temps Google (avec YouTube) représente à lui seul 22% de ce temps dédié aux médias numériques et Facebook 14%.

« Comment voulez-vous offrir un service au public quand vous ne captez que 1,5 % de leur temps », a demandé, sans prendre de gants, Rasmus Kleis Nielsen.
En fait, vous êtes loin de répondre aux défis du moment qui sont bien plus importants que vous ne l’avez imaginé, a-t-il ajouté : et votre audience est âgée et plutôt éduquée (donc peu représentative). « Vous êtes devenus marginaux pour les jeunes générations ». « Cela va être de plus en plus difficile de justifier vos investissements importants », a-t-il ajouté.
En Suède toutefois, si Netflix, YouTube et Facebook représentent à eux trois 69% du temps vidéo des suédois, la SVT parvient déjà à en capter 12%. C’est déjà un beau résultat.
ES
(Disclosures :
- Ces informations ont été recueillies lors de la conférence annuelle des TV publiques, mais aussi directement auprès des dirigeants de Yle à qui la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et quelques collaborateurs, ont rendu visite cette semaine à Helsinki.
- Pour Yle, prononcer « Waïeli » en anglais, et « Üullo » en finnois !)
Cahier de Tendances Printemps–Été: vers des médias synthétiques ?
L’intelligence artificielle (IA), qui irrigue déjà le monde de la culture et de la communication, est-elle en train de changer la donne dans les médias et le journalisme ?
Les algorithmes vont-ils se substituer à ceux et celles qui créent, informent, produisent, diffusent et partagent, pour nous inonder de contenus synthétiques et d’œuvres calculées ? Ou réussirons-nous à apprendre à vivre avec ce nouvel écosystème élargi homme-machines et à en profiter ? Notamment pour réussir à co-créer et coproduire avec le public des œuvres et des contenus qui, lentement, se déverrouillent et deviennent « vivants », changeants, modifiables.
Dans ce nouveau Cahier de Tendances sur la mutation des médias et du journalisme, nous vous proposons un état des lieux, à date, des utilisations de l’IA dans toute la chaîne de valeur des médias de l’information et du divertissement.
L’IA permet ainsi de valoriser les données dans des champs entièrement nouveaux de la presse, du cinéma, de la radio, la télé et la publicité : automatisation des process métier et des relations client, veille et écoute des réseaux sociaux, vérification de l’info, analyse prédictive de succès, création de vidéo et post-production, assistants vocaux et conversation, rédaction automatisée, personnalisation, recommandation, optimisation de la diffusion de contenus, tracking émotionnel et accessibilité.
Ce panorama inédit, réalisé par Kati Bremme (direction Innovation et Prospective), est complété par une vaste cartographie — non exhaustive — d’acteurs et de solutions existantes. Il est aussi enrichi des réflexions éclairantes de plus d’une vingtaine d’experts et de professionnels, français et étrangers, concernés de près ou de loin par cette nouvelle révolution technologique. Des chercheurs, des ingénieurs, des praticiens, des syndicats (SNJ et CGT), des journalistes, des publicitaires, s’interrogent avec nous sur la manière dont les médias vont vivre avec l’IA, profiter (ou pas) de ses fonctions de prédiction, d’automatisation et d’optimisation.
Merci à eux, merci à Barbara Chazelle pour la coordination rapide et efficace de ce gros travail d’édition, et merci au coup de crayon du talentueux et fidèle Jean-Christophe Defline.
Comme toujours, vous trouverez, décrites en détail la mutation accélérée des médias internationaux et l’évolution des principaux usages du public, de même que notre sélection de livres recommandés pour la période estivale.
Très bonne lecture et excellent été à toutes et tous !
ES
Comme celle-ci, les précédentes éditions semestrielles sont toutes disponibles gratuitement en pdf dans la colonne de droite de ce blog.
#Fake, #DeepFake – On n’a encore rien vu ! Ne croyez plus rien de numérique !
Gross modo « nous en sommes actuellement entre l’étape 1 et l’étape 2 ! »du tableau ci dessus, a averti, cette semaine à Londres, Shuman Ghosemajumder, directeur de la technologie pour Shape Security et ancien responsable de la cyber fraude chez Google.
« Facebook a dit avoir éliminé 3 milliards de faux comptes ces six derniers mois, mais on estime qu’il en reste 40 millions non détectés ! », a-t-il ajouté lors de la conférence CogX, dédiée à l’IA.
Des milliers de faux comptes Facebook, avec divers degrés de véracité ou d’ancienneté, ou d’autres réseaux sociaux, sont d’ailleurs en vente libre sur le web.

Le deep fake se démocratise, les outils sont dans les mains du public : 10 $ pour 50 mots d’un faux Trump
Coté deepfake, « le mois dernier, on comptait déjà 12.000 vidéos synthétiques en circulation, dont 95% de porno. (…) Des places de marchés sont en train de s’ouvrir où le deep fake est vendu comme un service. Il ne faut que quelques jours pour obtenir une vidéo de bonne qualité. Pareil pour la voix. Compter ainsi 10 $ pour 50 mots dits par un faux Trump », a complété Giogio Patrini, pdg de Deeptrace, qui s’exprimait dans la même conférence. « La qualité va encore progresser et les prix continuer de baisser ».
Chacun va pouvoir installer bientôt des applis de deep fake sur son mobile. Comment croire désormais ce qu’on voit ?
Vit-on déjà dans un monde où on ne peut plus croire ni nos yeux ni nos oreilles ?
Oui, affirme, Giogio Patrini : « Nous allons devoir nous entraîner à ne plus croire ce qui est créé de manière numérique ».
Et on commence à observer des conséquences politiques importantes, a-t-il ajouté en prenant l’exemple de vidéos virales qui ont semé le trouble au Gabon fin 2018 autour de la santé du Président. « Nous devons être prêts » à voir cela un jour chez nous.
Pour lui, la confiance ne reviendra que lorsque les plateformes et les gouvernements agiront vraiment.
« Ces deep fake ne viennent d’ailleurs pas de cyber-criminels classiques, mais essentiellement de groupe locaux de suprémacistes blancs d’extrême droite qui produisent beaucoup », a assuré de son côté, Philip Howard, directeur de l’Oxford Internet Institute.
« Seuls les pays dotés d’un audiovisuel public indépendant et assumant les valeurs du journalisme professionnel, estime ce chercheur, voient leurs citoyens mieux vaccinés contre ce nouveau fléau ».
Ça ne va pas s’arranger. Derniers exemples spectaculaires à l’appui :
Le montage vidéo devient aussi simple que l’édition de texte:

Tout le monde a vu ces derniers jours la vidéo bidon faisant dire des énormités à Zuckerberg. Un nouvel algorithme de Stanford permet ainsi de modifier sur une vidéo les paroles d’une personne comme on copie, colle, ajoute ou supprime des mots. De même la start-up israélienne Canny, spécialisée dans le doublage de contenus vidéos avec IA, intervient dans le contenu pour modifier le mouvement des lèvres des personnes ou des personnages.
C’est encore plus facile pour la voix :
Après Lyrebird dès 2017, Facebook vient de créer une IA capable de copier la voix de n’importe qui.
Voire trop dangereux pour être montré :
On a aussi vu récemment une firme d’Elon Musk développer un générateur de textes par IA tellement dangereux que ses créateurs se sont empêchés de le montrer.
Depuis, en quelques heures et pour moins de 10 $, une IA est capable d’écrire un discours onusien !
Mais il suffit de simplement ralentir le débit de quelqu’un pour le faire apparaître saoul, comme l’a montré récemment la fausse vidéo virale de la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, que Facebook n’a pas voulu retirer.

Ou bien encore plus drastique de créer de toutes pièces des personnes qui n’ont jamais existé:

Que faire dans l’immédiat ?
Pour la BBC :
- tout questionner
- demander les outils pour le faire
- parler aux enfants mais aussi aux adultes (éducation aux médias)
- plus d’introspection de la part des journalistes et demander des comptes aux médias
« Nous devons apprendre aux journalistes à aider les gens à accroitre leur sens critique et à tirer les bonnes conclusions des contenus qu’ils voient », a estimé Laura Ellis, responsable de la prospective technologique à la BBC. « Le problème c’est que les gens n’en veulent pas et préfèrent partager du b/s. C’est un vrai défi pour nous. » (…) « On aurait du ainsi mieux montrer vite en quoi la vidéo de Nancy Pelosi était bidon, et ne pas hésiter à coopérer entre médias professionnels ».
Pour l’Internet Institute d’Oxford :
- renforcer la boîte à outils des commissions électorales des grandes démocraties pour mieux lutter contre les manipulations
Pour Shape Security :
- s’armer du maximum de scepticisme et apprendre à détecter les faux
- assumer ses responsabilités (médias, gouvernement, plateformes)
- leur demander des comptes
Pour Deeptrace :
- réclamer une forte implication des gouvernements
- aider les écoles
- forcer la Big Tech à consacrer plus de sa R&D sur ces sujets
Beaucoup misent aussi sur l’IA pour contrer ce phénomène très inquiétant. Mais l’automatisation de cette lutte n’est pas pour demain.
« Et si ça nous prenait 50 ans ? Que faisons nous d’ici là ? », s’est interrogé Ghosemajumder, pessimiste. « Quand on pense qu’on ne sait toujours pas quoi mettre sur les paquets de cigarettes pour que les gens arrêtent de fumer… ».
L’inquiétude grandit dans les grandes démocraties sous pression où chacun peut créer n’importe quoi. Downing Street vient de débloquer des fonds importants pour mieux lutter contre la désinformation, et à l’approche du scrutin présidentiel de 2020, le Congrès américain panique devant l’explosion de médias manipulés.
Car il ya encore plus pernicieux que le deepfake : le savant mélange de vrai et de faux
« Tout le monde croit qu’on partage des fake news. Mais en fait, expliquait récemment à Porto, Jamie Bartlett, auteur et journaliste britannique, devant des responsables des audiovisuels publics européens, le plus souvent on partage un savant mélange d’infos vraies et fausses, triées avec grand soin par des groupes activistes radicaux, qui reflètent leur vision du monde, cohérente mais mensongère ».
Qui croire alors et à qui faire confiance ?
ES
Médias automatiques ou complicité hommes-machines ?
Il y a deux ans, notre Cahier de Tendances intitulé « Et si les médias redevenaient intelligents ? » s’intéressait à la propagation, déjà forte, de l’intelligence artificielle (IA) dans notre secteur.
Depuis, la dissémination s’est bien sûr étendue et a rayonné. Très rapidement, même.
Nos interactions culturelles sont, chaque jour un peu plus, déléguées à des machines : les algorithmes savent nous dire désormais quoi lire, écouter, regarder, acheter, qui croire, comment s’informer.
Très vite est venue l’angoisse du « grand remplacement technologique » : les mêmes algorithmes vont-ils aussi se substituer à ceux et celles qui créent, informent, produisent, diffusent et partagent, pour nous inonder de contenus synthétiques et d’œuvres calculées ?
Ou bien apprendrons-nous à travailler avec ce formidable nouvel outil pour enfin réussir à co-créer et coproduire avec le public des œuvres et des contenus qui, lentement, se déverrouillent et deviennent « vivants », changeants, modifiables ?
Les points à retenir :
- L’intelligence artificielle irrigue de plus en plus le monde la culture et de la communication. Sera-t-elle aussi créative ?
- Elle devrait, au moins, enfin permettre une vraie interaction entre les producteurs et leurs publics
- Mais il nous faudra apprendre à vivre avec ce nouveau système élargi homme-machines
Certes, les métiers de la culture et de la communication ne sont pas liés, dans leur grande majorité, à ces travaux de routine que l’IA a l’habitude de suppléer en premier. Nous aimons penser que la création artistique, l’inspiration, le savoir-faire ancestral sont absolument inséparables de la conscience humaine.
Et pourtant….
Pourtant, déjà, des machines écrivent des livres, résument des textes scientifiques, pondent des articles, troussent des scénarios, composent de la musique, peignent des toiles, sculptent et impriment en 3D.
« La vraie créativité de l’intelligence artificielle est en train d’arriver et révélera l’esprit des machines », assure même ce mois-ci le professeur de mathématiques à Oxford Marcus du Sautoy.
Christie’s a bien mis aux enchères le premier tableau peint par une IA. Un robot a failli gagner un concours littéraire au Japon. Un nouveau chapitre d’Harry Potter a été écrit par une IA. IBM Watson a produit tout seul une bande-annonce de film. L’IA d’un smartphone de Huawei vient de créer une collection de mode. Des journaux scandinaves laissent des robots écrire des articles par milliers. Et en Chine, le JT peut être présenté par une IA !
Et c’est dans la musique que les avancées sont les plus spectaculaires. Profitant d’une proximité de cet art avec les maths, des logiciels de production musicale, basés sur l’apprentissage profond, existent depuis longtemps. IBM, Google ou Spotify s’en servent abondamment. Et l’exemple d’Amper est impressionnant !
Si ces logiciels peuvent tromper leur monde pendant un court moment en imitant le style d’un artiste, comme fond sonore de vidéo YouTube ou en musique d’ascenseur, ils ne tiennent pas encore la distance. Leurs « créations » ne sont possibles qu’après avoir digéré des centaines de milliers d’oeuvres déjà existantes, créées par les humains.
On ne sait d’ailleurs pas si cette IA peut être entraînée sur la base d’une musique protégée par des droits d’auteur. Et quid du copyright d’une musique créée par IA ? Va-t-il au développeur, à l’IA, ou à l’œuvre dont elle est dérivée ? Que se passera-t-il quand une IA sera capable d’imiter le style d’un compositeur ou chanteur décédé ?
Warner Music a en tous cas déjà signé un contrat avec une IA (en fait avec l’éditeur du logiciel), la SACEM a accordé le statut de compositeur à une artiste virtuelle et Huawei a terminé la symphonie inachevée de Schubert.
Mais cela fait-il des algorithmes des écrivains, des journalistes, des musiciens, des cinéastes, des peintres, des artistes ? Ou juste des copieurs particulièrement bien entraînés ?
L’IA n’est plus une expression à la mode ! C’est l’électricité du 21è siècle !

Un cocktail de 5G, d’IA, d’AR (réalité augmentée), d’IoT (dire désormais Intelligence des Objets), mâtiné de robotique, est en train de conduire assez naturellement à un nouveau monde interconnecté, très horizontal, où fusionnent informatique et électronique, monde physique et numérique, dans la plupart des secteurs (santé, sport, finance, agriculture, mode, transports, infrastructures, …). Et donc aussi dans la culture, de l’information et le divertissement.
C’est la mise en place progressive d’une nouvelle vague technologique intégrée qui repose sur les données, maîtrisées et moissonnées principalement par les grandes plateformes.
Répondant à une demande croissante d’automatisation, l’IA est désormais partout : des microprocesseurs aux smartphones, des applis aux assistants numériques, des caméras à la messagerie mobile TikTok, nouvelle coqueluche des ados.
C’est quoi l’IA ?
Cantonnée pour l’instant à la résolution efficace de problèmes bien particuliers, l’IA aujourd’hui c’est aujourd’hui surtout de l’apprentissage machine : des logiciels qui cherchent dans de vastes quantités de données des modèles permettant de faire des prédictions pour produire une solution adaptée à une situation. À court terme, elle fera bien moins que ce qu’on peut lire dans la presse aujourd’hui ; mais à long terme, il est probable qu’elle aura un impact beaucoup plus important que ce que nous pouvons imaginer maintenant.

L’IA comprend de mieux en mieux nos besoins, voire nos intentions. Des progrès sont en cours pour en profiter à partir de bassins de données moins importants, plus à notre échelle, même si, pour l’instant, seule une infime partie des données émises par nos smartphones, montres, réfrigérateurs, enceintes, trottinettes et autres objets intelligents connectés sont en fait collectées et traitées. La plupart des modèles utilisés reposent aussi sur un apprentissage supervisé par un humain, qui « éduque » la machine et corrige des erreurs.
Nous n’en sommes donc qu’au tout début, mais elle inquiète déjà beaucoup.
À juste titre.
Voici quelques-unes des craintes :
Disparition des emplois
L’automatisation et la mondialisation exacerbent les inégalités et les deux forces peuvent amener les tensions sociales au point de rupture : ce ne sont pas les syndicats qui le disent, mais l’OCDE, le club des pays les plus riches. Certes, les pronostics varient (40% des jobs seraient menacés) mais tous les experts s’accordent à prévoir que des proportions importantes de tâches répétitives vont être assez vite remplacées. Comme dans l’industrie, les humains vont probablement se spécialiser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.

Accroissement de la fracture numérique
Est-ce que seule une faible portion de la population profitera des gains de l’automation ? Car même si des employés réussiront bien à en bénéficier, d’autres salariés, souvent jeunes, féminins, peu qualifiés et intérimaires, risquent d’être plus vulnérables. Seront-ils invités à n’être que des « dresseurs d’IA » ?
Et puis il y a une grande différence entre ceux qui ont, du moins en partie, les clés pour gérer la surabondance d’informations et de sollicitations, qui ne se laissent pas submerger, qui savent faire le tri, où regarder, que retenir, quoi rejeter, tout en naviguant entre les terminaux, et ceux, moins lettrés dans ce monde digital, ou ayant une culture numérique moins affutée, qui ne peuvent que subir des algorithmes mystérieux qui décident pour eux.

Manque de compétences
Après avoir acheté quantité de start-ups dans l’IA, les « Big Nine » (GAFA et BATX) détiennent le quasi-monopole du marché de l’Intelligence Artificielle et entendent même imposer leurs normes. Dans un élan de générosité, ils mettent à disposition des compétences, d’une part dans des Centres de Recherche (comme celui de Facebook à Paris), ou en proposant des outils libre d’accès pour les développeurs (à l’instar du Google AutoML).
La solution pour se rendre plus indépendant de cette prédominance ? Des partenariats, des collaborations, des projets au niveau européens, comme celui d’IA4EU qui regroupe différents acteurs, des gouvernements jusqu’aux industriels en passant par les Universités. L’Europe commence aussi à proposer de plus en plus de formations en IA, comme les 4 instituts « 3IA ». Mais cette offre est loin d’être suffisante face à la demande.
Anxiété algorithmique, nouvelles réalités altérées bourrées d’IA
Quand la réalité virtuelle enferme l’utilisateur dans un monde artificiel parallèle, et que la réalité augmentée ou synthétique superpose (ou efface) des objets virtuels dans notre environnement réel, il y a de quoi distordre nos sens ! Nous allons connaître des niveaux différents de réalité.

Transparence insuffisante, nombreuses questions éthiques
La science et la technologie, toujours plus complexes, ont de plus en plus de mal à expliquer leurs propres progrès. Les algorithmes sont trop souvent vus comme des boîtes noires, opaques, mystérieuses, desquelles sortent des décisions dont nous ne comprenons pas l’origine.
Beaucoup d’interrogations s’élèvent aussi sur les biais introduits dès les premières lignes de codes par des développeurs, souvent masculins, souvent blancs et souvent mal formés aux enjeux socio-politiques de leurs décisions informatiques. Leur proximité géographique (la plupart sont concentrés dans la Silicon Valley, la région de Pékin ou de Shenzen) et sociale accentue ce risque.
Or un algorithme est comme une recette de cuisine : il prend des données – parfois peu satisfaisantes– issues du passé, crée un modèle mathématique et en ressort une labellisation ou une prédiction. La récente législation européenne sur les données (RGPD) donne aux citoyens un droit d’explication sur ce processus, et le comité d’experts IA de haut niveau à la Commission Européenne, qui vient de présenter des guidelines pour une IA éthique, souligne, lui aussi, l’importance de la transparence. Mais même avec des connaissances, il est difficile d’en saisir les mécanismes.
Et surtout, une IA loin d’être une artiste ou un journaliste !
L’IA est seulement capable de produire une œuvre composite à partir de l’apprentissage des œuvres déjà produites (un peu comme l’Homme quand même !). Sans contexte, incapable d’émotion et d’intention, il lui manque encore la créativité permettant de casser les codes et d’innover pour dépasser l’existant. Elle ne fait pour l’instant que copier le style d’autres créateurs. Et lorsqu’elle en crée un grand nombre, c’est toujours l’humain qui fait le tri. Dans la presse, l’IA reste pour l’instant ultra formatée pour reproduire à la chaîne des compte-rendus sportifs, financiers ou électoraux.
Et ce ne sont là qu’une petite partie des griefs.
Mais il n’y pas que l’aspect poison. Il y a aussi et surtout les remèdes, existants et potentiels, de cette nouvelle technologie.

lntelligence élargie
Le grand espoir est de voir cette nouvelle intelligence émergente, introduite dans nos processus, accroître les capacités des individus et amplifier leur potentiel plutôt que les remplacer. Et surtout améliorer et enrichir les systèmes interconnectés dans lesquels nous évoluons désormais au quotidien. Voyons-là comme une boîte à outils !

Déjà une meilleure expérience
Tellement de contenus et si peu de temps ! Nous le savons, l’IA, notamment par les moteurs de recommandations, permet déjà de réduire le bruit d’Internet, d’aider le public à mieux trouver les contenus dans le brouhaha et la grande fragmentation des contenus.
La recherche visuelle, et déjà vocale, contribuent aussi à alléger les tourments liés à la noyade dans les sollicitations, tout en transformant les expériences culturelles et informationnelles. La voix confirme son nouveau statut d’interface privilégiée, à la maison et dans les véhicules. Nous allons de plus en plus parler à nos appareils ! La BBC et le Financial Times automatisent déjà des versions audio de tous leurs articles en ligne.
En améliorant le ciblage des messages et donc leur pertinence, l’IA réduit quand même la pression publicitaire, véritable taxe sur ceux qui n’ont pas les moyens de souscrire à des abonnements.
En prédisant le succès d’un contenu, l’IA va aussi s’avérer utile pour mieux programmer les œuvres en ligne et pour affiner les fenêtres d’exploitation de leurs droits. Déjà les nouveaux téléviseurs peuvent mettre à niveau, par IA, la définition de l’image (de la HD à la 4K par exemple) et adapter le son à la nature des contenus regardés.

Demain, Samsung rêve de pouvoir distribuer de la puissance informatique d’un terminal à un autre, selon les besoins (d’un smartphone à une TV pour jouer à des jeux vidéo par exemple).
Collaboration hommes – machines pour enfin plus d’interactivité
Nous avons appris depuis plus de 20 ans que la mutation numérique ne transformait pas seulement la distribution des contenus mais les contenus eux-mêmes ! L’ensemble de l’expérience, donc. L’IA devrait nous permettre d’accroître les possibilités d’interactivité, notamment conversationnelles, promises mais encore trop limitées aujourd’hui dans cette mutation numérique.
L’immersion dans les contenus n’en est qu’à ses débuts.

Les paris en temps réel, la réalité augmentée sont en train de transformer les expériences liées aux sports. Nous pouvons déjà être littéralement transportés dans le stade, parmi les joueurs. Bientôt, leurs avatars disputeront leur partie sur notre table basse. Elles permettront probablement aussi l’invention de nouveaux sports. Et que dire de l’e-sport, dans lequel le spectateur peut à tout moment devenir joueur ? C’est tout le sens du projet Stadia de Google, qui permet en un clic de rejoindre une partie depuis une vidéo YouTube.

L’immersion et la personnalisation ont aussi déjà transformé les contenus. Dans la manière dont ils sont fabriqués et consommés.
Mon Netflix ne ressemble pas à votre Netflix ! L’IA améliore déjà (en tous cas élargit) la distribution des œuvres, notamment en ciblant mieux les contenus. Les données permettent de mieux mesurer le fameux engagement de l’audience. L’essor des assistants vocaux, bourrés d’IA, est un nouveau véhicule pour des œuvres innovantes.
L’IA permet aussi de restaurer, voire améliorer les œuvres passées. Par exemple dans le domaine du cinéma, effacer les outrages du temps sur une pellicule, voire coloriser et bruiter des films en noir et blanc.
L’IA nourrit aussi la création conversationnelle
Là où l’utilisation de l’IA dans la création réussit est dans la combinaison avec la créativité humaine. L’IA n’enrichit pas à elle seule l’art, mais elle peut être un outil pour « augmenter » la créativité de l’artiste. Notamment dans cette fameuse nouvelle interactivité.
Dopée à l’IA, ce processus de rétroaction, de collaboration, de coopération entre les acteurs qui produisent un contenu, va permettre de rendre possibles des versions différentes d’une œuvre, de les modifier en cours de route. Y compris pour la fiction.

Bientôt une même œuvre sera accessible selon différents niveaux d’interactivité et d’immersion suivant le souhait et l’équipement du spectateur, depuis la version linéaire en 2D sur téléviseur jusqu’à la version interactive en 3D sur casque VR.
Fin 2018, Netflix a proposé des fins différentes à un épisode de la série « Black Mirror ». Le télénaute y emprunte des voies d’arcs narratifs différents et peut prendre des décisions pour le personnage principal. La firme vient de récidiver avec la série « You vs. Wild » où la survie du héros dépend du public.
Nous sommes ici à la frontière du jeu vidéo. Les artistes, designers, développeurs utilisent de plus en plus les architectures de simulation des jeux vidéo pour voir comment mieux s’inspirer des conditions changeantes et imprévisibles des environnements.

Les fans de la série britannique à succès « Peaky Blinders » vont pouvoir ainsi s’immerger dans leur univers, visiter les lieux, rejoindre leur gang préféré dans un jeu vidéo en VR et interagir avec leur héros. L’IA permettra à ces derniers de répondre aux différentes sollicitations du joueur qui s’il est performant, pourront rejoindre …le gang !
YouTube se met aussi à promouvoir la participation de l’audience dans sa programmation et la BBC vient de rendre interactive son émission « Click » permettant au télénaute de choisir la manière dont il veut la regarder en séquençant lui-même les différentes parties. Elle prépare aussi une série de magazines « Future You » sur les grands sujets contemporains mondiaux – intégrant des possibilités d’interactions en fonction des degrés de connaissance des thématiques par le public.
L’audiovisuel public scandinave expérimente assez bien avec Snap et Instagram pour déjà co-créer avec les jeunes audiences, tandis que l’agence de presse Reuters a construit le plus grand dépôt mondial de vidéos venant du public.

L’IA peut aussi permettre désormais de co-créer avec l’audience en s’alimentant à la fois du passé et des réponses des utilisateurs, comme Shelley, une IA qui raconte des histoires d’horreur avec le public.
Le Reuters Institute prédit que l’innovation média la plus intéressante développée actuellement est dans l’utilisation de la voix pour développer de l’audio conversationnel ; des questions/réponses interrogeant des data pour en faire de nouvelles expériences.

L’IA, une aide aussi pour les journalistes
Des robots générateurs de textes sont déjà installés dans des rédactions en Amérique du Nord et en Europe pour aider les journalistes dans les tâches les plus ingrates telles que les résultats financiers, sportifs, électoraux déjà mentionnés.
La rédaction de l’audiovisuel public finlandais a ainsi adopté le bot Voitto (par le biais d’une peluche) tandis que le groupe de presse suédois MittMedia n’hésite pas à trouver les robots-journalistes plus fiables, plus productifs et plus lus !
L’IA permet de supprimer des tâches répétitives via des logiciels de récupération et classification de documents, de traduction automatique, de reconnaissance vocale pour la prise de notes automatiques (« speech to text »), de reconnaissance visuelle (pour identifier des gens dans les foules), de montage et labellisation à la volée de contenus photo et vidéo. Elle rend accessible aux malentendants l’ensemble des contenus audiovisuels, en attendant l’IA capable d’audio-décrire tout type de contenus visuels.

Chez Bloomberg, près d’un tiers des contenus journalistiques contient déjà des éléments d’automatisation. L’IA y est aussi utilisée pour la collecte d’infos (traduction automatique, capteurs dans les smartphones, …), pour la veille des réseaux sociaux (signaux faibles, …) et pour la personnalisation des contenus. À terme, elle devrait également aider à reformater l’info (actualisation rapide avec nouveaux éléments, …).
Voici à quoi pourrait ressembler par exemple un desktop en VR sous Oculus :
Mais l’IA en journalisme doit aussi être solidement contrôlée par les professionnels des rédactions (qui devront en évaluer les risques) et devra être arrimée à la transparence des process pour éviter la propagande, les biais, les risques de création de bulle informationnelle.
Loin de la vision romantique du métier d’informer, faudra-t-il placer dans la salle de rédaction un « data scientist » auprès des journalistes, comme il y en a désormais dans les salles de marché auprès des traders ? L’IA remplacera-t-elle l’intuition du journaliste et son fameux « news judgement » ?
Moins de « fake news » ?
En tous cas, jusqu’ici, les machines savaient calculer et lire. Aujourd’hui, elles voient et reconnaissent des photos et des vidéos. Un peu comme nous avons vu diminuer le spam dans nos boîtes emails, les experts en IA s’attendent à ce qu’elle permette aussi de réduire le bruit de la désinformation. À condition de l’identifier. Des travaux autour de la traçabilité de l’info, de ses composants, sont notamment en cours. Automatisant la confiance, le recours à la blockchain est aussi envisagé pour remonter à la source.
Mais attention, la désinformation s’automatise aussi. L’IA sait aussi créer des fausses images, photos et vidéos : des contenus synthétiques. L’œil nu n’est déjà plus suffisant pour détecter ces « deep fakes », encore peu répandus mais spectaculaires : des voix, des visages ou des personnes qui n’ont jamais existé sont créés de toutes pièces.
Des personnalités peuvent se retrouver dans des situations qu’ils n’ont jamais vécues, et leurs voix être parfaitement imitées. On aura donc besoin de l’IA pour détecter les faux créés par l’IA.
NVidia, qui modélise la réalité, permet de re-créer ainsi des paysages réalistes à partir de schémas ou même des visages. Nous sommes là dans de la traduction vidéo ! Et probablement dans le calme avant la tempête, avant le déluge de mensonges qui va s’abattre sur les discours de vérité.
Aider à distinguer le faux du vrai est un des défis de l’IA, mais la course de vitesse est engagée.


(progrès en faux visages créés par IA)
Et donc, demain ?
Les mutations de demain vont beaucoup dépendre des progrès de l’IA, mais aussi de ceux de la robotique et de l’informatique quantique, où le volume des données et la vitesse de calcul sont sans équivalent.
D’ores et déjà de nombreux travaux se concentrent sur une IA non plus centralisée et homogène dans le cloud, mais travaillant davantage à la périphérie, dans nos terminaux et objets connectés, et nécessitant moins de données et de puissance informatique centralisée. Les dernières annonces de Google vont dans ce sens, avec comme bénéfice immédiat pour les utilisateurs une meilleure protection de leur vie privée, promettent-ils.
Nous avons déjà des robots qui apprennent en faisant, se supervisent eux-mêmes et réalisent parfois des tâches plus complexes que celles initialement prévues. Demain, une IA plus élaborée sera plus efficace, plus personnalisée et aura une meilleure perception du contexte, de notre activité, de nos besoins, intentions, émotions… Pour déboucher sur davantage d’interactions et de nouveaux services rendus.

Des chercheurs regardent déjà comment utiliser l’IA pour transformer des signaux du cerveau en pensée. Peut-on imaginer qu’un jour la créativité le sera aussi ? Notre libre arbitre sera-t-il défié ? Comment alors embarquer du bon sens dans l’IA ?
Qui va décider ce qu’est une bonne ou une mauvaise amplification ou augmentation des capacités humaines ? L’ingénieur, le client, le citoyen, l’Etat ? Tous peuvent pourtant être manipulés…
Mais que se passera-t-il si une partie de la société décide de se passer des algorithmes ? En aura-t-elle la liberté ?
« La nouvelle littératie numérique, ce n’est pas seulement savoir utiliser un ordinateur ou naviguer sur Internet, mais comprendre les conséquences de notre nouvelle vie connectée », a résumé ce printemps, Anjana Susarla, professeur en Systèmes d’information à l’Université du Michigan.
Les humains et l’IA pris dans un écosystème d’intelligences
Chacun le sent bien : l’IA, technologie encore très neuve mais force majeure de transformation, va être intégrée dans tout, tout ce que nous utilisons, tout ce que nous touchons.

Nous sommes très loin d’approcher un niveau de conscience non-organique et la fabrication de pensées autonomes. N’oublions pas que nous ne savons pas encore comment fonctionne notre cerveau biologique. Nous sommes donc loin d’une intelligence artificielle générale, capable d’accomplir des tâches complexes sans chair, sang et atomes de carbone. Et sans émotion.
Car si parfois nous avons le sentiment étrange que l’IA nous connaît mieux que nous-mêmes, la confiance, l’empathie, la compassion ne sont pas prêtes d’être remplacées par des formules mathématiques. L’IA n’est donc pas omnipotente aujourd’hui et avant même qu’elle n’atteigne le niveau de celle des humains, de nombreuses questions sont en train de se poser autour de l’éthique, du droit, de l’emploi ou des armements.

Mais sur la route des progrès en cours, il ne fait guère de doutes que nous verrons apparaître de nouvelles formes de compétences des machines. Probablement spectaculaires.
Profitant de ressources informatiques meilleur marché, les experts sont en train d’ajouter de la mémoire aux capacités de traitement du « deep learning ». Restent le problème du raisonnement et l’apprentissage non supervisé, l’acquisition d’une sorte de bon sens ou de sens commun, encore mal maîtrisée, à base de prédictions.
Mais jamais l’humanité n’a créé une technologie qui lui ressemble autant ! Hélas, le débat se fige trop souvent aujourd’hui sur une seule question simpliste : qui gagnera de l’homme ou de la machine ?
En fait, les avantages des humains ne sont pas ceux des machines. Et inversement. Ils sont complémentaires. L’IA, n’est pas une solution universelle, mais aujourd’hui un outil qui renforce et augmente les capacités. Cette complémentarité permet d’avoir un impact plus grand, d’atteindre plus de gens, d’amplifier le potentiel des êtres humains. Les attentes culturelles diffèrent aussi d’un point de la planète à l’autre : au Japon, les universités travaillent à rendre les IA les plus humaines possible alors qu’en Europe la tendance est plutôt à la différentiation en privilégiant l’outil.
« Nous sommes tous un système géant homme-machine. Nous devons commencer à l’admettre et à agir comme tel », résume le chercheur du MIT Nick Obradovich.
« Il ne s’agit donc pas d’opposer les hommes aux machines, mais de considérer l’ensemble du système qui intègre humains et machines – donc ne pas parler d’’intelligence artificielle mais d’intelligence étendue », précise Joi Ito, le patron du MediaLab du MIT à Boston.

Il va donc nous falloir apprendre à vivre désormais avec ces machines. Et reconnaître notamment les changements de paradigmes, dont celui de l’arrivée d’une nouvelle économie de l’abondance ! Car contrairement aux piles Wonder (1935), plus vous utilisez l’IA, plus elle prend de la valeur ! Et contrairement au pétrole, à qui les données sont volontiers comparées, il y en a chaque jour davantage ! Mieux : une fois consommées, elles n’ont pas disparu ! C’est là l’immense avantage des plateformes américaines et chinoises qui, fonctionnant à l’IA et aux données, sont chaque jour plus populaires en termes de contenus, d’expériences et donc de valeur.
Pour l’instant l’IA s’est peu démocratisée. Et la littératie de la data est très faible dans les médias et le monde de la culture. Il faudra pourtant que les professionnels des contenus – et pas seulement de la technologie—se familiarisent bien davantage avec les données. Qu’ils organisent leur data, les annotent correctement, voire en livrent l’accès.
Qu’ils ne répètent pas non plus l’indifférence ou le déni qu’ils ont manifesté à l’égard des réseaux sociaux ou du mobile. Qu’ils en retiennent les leçons. Comme pour Internet, les réseaux sociaux et le mobile, l’arrivée de l’IA dans les usages quotidiens du public force les médias à revoir leur fonctionnement, notamment au niveau du management et des ressources humaines. Et comme précédemment, ils sont peu préparés à profiter de cette transformation et à s’approprier, à bon escient, les nouveaux outils. Y compris pour améliorer les services rendus ou bien tenter de réglementer la propriété des données.
L’un des principaux apports de l’IA sera donc, grâce à cette nouvelle collaboration hommes-machines, de transformer les process au sein des médias afin que ces derniers deviennent moins rigides, qu’ils travaillent moins en silos, et réussissent à s’adapter plus vite aux changements. Afin également qu’ils restent pertinents, puissent se réinventer en permanence, et voient mieux les trous dans la raquette, car cette avancée ne va pas se stabiliser. Attention : faute de compétences, il ne sera guère facile de rendre opérationnelle l’ingestion de données pour aider à la prise de décision.

Ce sont là des taches difficiles et sophistiquées dans des environnements complexes, liées notamment à la créativité, difficilement prise en charge par des robots. Et en Europe, nous n’avons ni les investissements, ni les données comme aux Etats-Unis et en Chine, pour entraîner les algorithmes. Nous avons aussi un environnement règlementaire plus contraignant, bénéfique pour les consommateurs, pas forcément pour les développeurs.
Mais c’est aussi, sans doute, l’occasion rêvée de passer d’une culture de média centrée sur le contenu, à une attention davantage portée sur les attentes et les interactions possibles des utilisateurs et des clients qui deviennent des collaborateurs des services rendus.
Mettre les développements en open source, créer des API pour n’importe quel service ou produit, les documenter, identifier des cas d’utilisation et permettre de créer des micro-services doit être fortement encouragé pour permettre au public de s’en emparer. Et ainsi doper et amplifier la créativité.

Les millenials, qui ont chamboulé nos habitudes, et surtout la Génération Z, sont désormais en première ligne.
Dès le début de sa carrière, le jeune journaliste devra être en prise avec ces nouveaux outils, notamment pour développer un modèle de journalisme intégrant mieux le citoyen. D’ailleurs son CV sera d’abord lu par …une IA. Puis les salariés devront être formés tout au long de la vie. L’IA va certes détruire des emplois, mais en créera aussi de nombreux nouveaux. Reste à savoir si leur création sera plus rapide que leur destruction. A condition aussi de ne pas aboutir à un management par algorithmes où les ordinateurs licencient eux-mêmes les employés, comme chez Amazon.
De plus en plus les ingénieurs et développeurs prennent les décisions clés de nos vies. L’IA peut donc être une technologie de domination du 21è siècle, notamment à l’encontre de ceux qui seront laissés derrière et auront l’impression que personne n’aura plus besoin d’eux.
Une des craintes des experts est aussi de voir l’IA se mettre à viser des objectifs qui ne sont pas alignés avec ceux des humains. Tâchons aussi de ne pas favoriser une transformation du monde réel pour accommoder l’IA. Attention enfin de ne pas se faire hacker le cerveau par ceux qui abusent méthodiquement de notre attention : les géants de la Tech, qui ont le monopole de la connaissance IA, savent tellement bien comment maximiser notre temps sur leurs sites et applis !
Quelle sera finalement la relation entre l’intelligence humaine et l’intelligence de la machine, qui, elle, n’a ni esprit ni corps ? Comment profiter l’une de l’autre ? Comment faire pour que l’Homme évolue dans le bon sens en tant qu’homme/femme, individu et collectif ?

Car l’IA n’est que la moitié du problème, selon l’historien israélien Yuval Harari, auteur des best-sellers « Sapiens » et « Homo Deus ». L’autre partie, c’est l’essor spectaculaire de la biologie et des neurosciences, qui combiné avec l’IA et les données, risque bien de « hacker l’être humain ».
Nous allons donc devoir vivre avec des systèmes gouvernés simultanément par plusieurs sources donneuses d’ordres, les humains et les machines. Qu’on le veuille ou non.
« Moins de contrôle et plus d’humilité », prône pour cela Joi Ito, le patron du MIT MediaLab, pour qui il est plus important de participer aux nouveaux systèmes complexes de manière responsable et consciente.
Avons-nous besoin de savoir tout ce qu’il se passe dans les arrière-cuisines ? Après tout, une rédaction est aussi une boîte noire qui ne dit rien sur ses choix ou ses impasses ; un atelier d’artiste, un studio d’enregistrement ou une salle de montage, aussi.
Pragmatique, le MIT propose d’utiliser un nouveau terme pour décrire ce nouveau type de prises de décision : « le comportement des machines ». Cette nouvelle sociologie des machines ne veut pas dire qu’elles sont dotées de libre arbitre, mais qu’elles sont considérées comme impactantes sur leur environnement et sur les humains
Max Tegmark, professeur de physique au MIT et auteur du prophétique « Life 3.0 » résume parfaitement cette question fondamentale : « La conversation autour de la manière dont nous allons vivre avec l’IA est bien la plus importante de notre époque ».
Eric Scherer
——————
PS : Pour la sortie de notre prochain Cahier de Tendances Printemps – Eté, nous proposerons notamment une « Cartographie des applicatifs IA dans les médias ». Loin de prétendre à une exhaustivité dans les exemples, elle dresse les cas d’usage de l’IA dans toute la chaîne de production et de diffusion des médias : de la veille et écoute des réseaux sociaux à la personnalisation de la diffusion, en passant par la rédaction automatisée et la vérification de l’information. Publicité, information, création et marketing sont des secteurs profondément impactés par l’IA, la preuve par l’image dans cette (déjà longue) liste d’applicatifs concrets.
Le cahier sera disponible ici, sur Méta-Media en PDF gratuitement début juin.
(Illustration de couverture : Jean-Christophe Defline)
L’Internet des médias sociaux aussi dangereux que la crise climatique
Impressionnante et très sombre keynote, cette semaine à Berlin, du professeur de droit de Columbia, Eben Moglen, sur l’urgence – dans l’intérêt de nos enfants et petits-enfants– de vite réguler les médias sociaux qui sont des machines à « collecter nos comportements », à les modifier, et à nous empêcher de réfléchir en réduisant notre espace intérieur.
Pendant 40 minutes, cet informaticien américain a sidéré les centaines de geeks allemands réunis pour leur festival numérique annuel re;publica en dénonçant le modèle d’affaires parasitaire et destructeur (mais très fructueux) des médias sociaux et a comparé la tâche qui nous attend au défi du changement climatique.

Extraits :
« Nous vivons en fait deux désastres environnementaux majeurs, chacun nécessitant toute notre attention et notre mobilisation : la crise climatique et celle des médias sociaux qui, elle, pollue notre for intérieur ».
« Notre espace intérieur est désormais délabré », par ces sollicitations incessantes « qui ont changé qui nous sommes et l’objet de nos réflexions ».
« Les adolescents américains regardent leur mobile plus de 2.000 fois par jour. En temps normal, nous aurions parlé de troubles obsessionnels compulsifs ».
« Avec son design persuasif, le réseau métabolise notre comportement, puis le stimule pour créer un nouveau comportement. Il change chimiquement qui nous sommes, fracture la cohérence de notre esprit, et réduit notre espace intérieur. »
« Le problème n’est pas seulement Trump ou le Brexit, mais une véritable attaque sur notre capacité à réfléchir (…) et qui se répand plus vite que la Chrétienté ou l’Islam».
« tl ; dr : too long ; did’nt read – symbole en quatre caractères de la crise de l’esprit »
« Il faut aider à réhabiliter notre capacité à nous concentrer, à réfléchir. Notre génération a la capacité de retrouver cette autonomie et cette liberté qui ne datent que de la Réforme. C’est beaucoup moins sûr pour nos enfants et petits-enfants qui n’ont connu que ça ».
« Nous devons vite régler ce problème, mais le temps joue contre nous et nous avons gâché un temps précieux (…) Et le temps joue contre nous comme il joue contre nous pour la planète (…). Le problème c’est qu’aujourd’hui, les gens sont plutôt convaincus d’un progrès (permis par les médias sociaux) dans l’accessibilité à l’Information et dans la commodité d’utilisation.
« Ces médias nous consomment au moment où nous les consommons. (…) Il faut rendre le Net plus silencieux. La démocratie et notre liberté en dépendent. »
« Il faut changer les règles économiques de ces services ; reconnaître que ce ne sont pas des plateformes, ou des outils de communication, mais des business de collecte de nos comportements ».
Ce discours très alarmiste a fait écho à la tribune publiée le même jour aux Etat-Unis dans le New York Times du dernier Prix Nobel d’économie : « c’est le boulot du gouvernement d’éviter une tragédie du bien commun », a estimé Paul Romer, qui prône une taxe sur la publicité des GAFA pour changer leur modèle d’affaires jugé dangereux pour la démocratie.
En février le New Yorker, avait publié un texte posthume du fameux neurologue Oliver Sacks, dans lequel il prévenait : « ce que nous voyons – et ce que nous nous infligeons – ressemble à une catastrophe neurologique à une échelle gigantesque. »
En France, Jacques Attali, a estimé jeudi que « les réseaux sociaux tuaient aussi sûrement que le sucre ».
Vendredi, le président Emmanuel Macron reçoit Mark Zuckerberg à l’Elysée.
ES
Le mieux, je le redis, c’est de regarder la keynote d’Eben Moglen, disponible ici : https://www.pscp.tv/re_publica/1ZkJzrgRrBwJv
Forcés d’innover ensemble, les médias suisses privilégient la proximité sur la techno
Un sacré avertissement ! Les médias suisses n’en finissent pas d’être secoués par la votation nationale qui, l’an dernier, a bien failli jeter aux oubliettes leur audiovisuel public, finalement sauvé par son public. Ils ont donc décidé — au moins pour leurs acteurs francophones– de travailler ensemble pour voir comment innover.
Pour « réenchanter les médias », firmes publiques et privées, journaux comme télévisions ou radios nationales ou régionales se sont donc retrouvés cette semaine à Lausanne pour leur 1er Forum* des médias romands. L’occasion donc de partager des « best practices », de dépasser les clivages historiques et de découvrir des initiatives venant de certains d’entre eux ou de start-ups.
L’occasion aussi de parler du fond.
« L’innovation porte moins aujourd’hui sur la technologie ou les formats que sur les questions de liens » avec le public, a bien résumé Gaël Hürlimann, rédacteur en chef du numérique pour le quotidien Le Temps, de plus en plus lu en France. C’est vrai, a reconnu Serge Gumy, rédacteur en chef du quotidien régional La Liberté, ces dernières années, « nous avons perdu en humanité. Nous n’avons pas été assez à la rencontre des gens ». « Nous nous sommes beaucoup perdus dans la tuyauterie, notre métier c’est journaliste, pas plombier », a renchéri Ariane Dayer, rédactrice en chef au groupe Tamedia.
Tous ont donc souligné cette première nécessité d’être en « conversation permanente » avec leur audience.
Mais ils sont aussi restés ouverts aux initiatives de modernité offertes par les nouvelles technologies, en privilégiant notamment des alliances pour travailler ensemble sur le renforcement du lien social. « Les sujets sont trop vastes pour avancer tout seul! ».

Ainsi la SSR, l’audiovisuel public suisse, s’est associé au groupe de presse privé Ringier, mais aussi à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Triangle Azur, réseau qui réunit les Universités de Genève, de Lausanne et de Neuchâtel, pour lancer l’Initiative pour l’innovation dans les médias (IMI) dotée d’un fonds de soutien annuel d’environ 600 K €. Leurs premiers projets tournent autour de la lutte contre la désinformation.
D’autres initiatives ont été présentées :

AINews, développée par La Liberté, la start-up Djebots et les écoles d’ingénieurs et de gestion de Fribourg pour insérer des messages personnalisés au sein des fils d’infos. « Le journalisme du futur est une conversation entre le lecteur et son journal ». Radio Chablais utilise elle Whatsapp pour faire participer ses auditeurs à l’antenne.

Le robot-journaliste Tobi du groupe de presse Tamedia qui génère automatiquement des articles, notamment à l’occasion d’élections ou de rencontres sportives non couvertes par des journalistes. Ses contenus ont parfois mieux « scoré » que des compte-rendus traditionnels, dit-on chez Tamedia, « des journalistes ont été choqués de si bons scores de satisfaction« .
La RTS, branche francophone de la SSR, a mis en production une intelligence artificielle pour indexer les vidéos d’archives en utilisant des technos de recherche visuelle, reconnaissance faciale et identification de locuteurs.
Des start-ups suisses bousculent le jeu

Kapaw est un média d’actu pour les jeunes suisses qui met l’accent sur une conso mobile, sur les réseaux sociaux et en vidéo.

Heidi.News créé par l’ancien éditeur numérique du Monde, Serge Michel, va mettre l’accent sur deux formats : les flux et les explorations. Employant 14 personnes dont 8 journalistes, il a déjà levé 1 million de FS avant une nouvelle levée prochaine. Avec 2 recettes : « on attend qu’un produit marche avant d’en lancer un autre; et on s’intéresse beaucoup aux communautés ».
Finity qui produit des contenus pour des grandes firmes en utilisant l’IA ou encore SmartWall qu propose des paywalls dynamiques pour la presse.
Le président de Tamedia, Pietro Supino, a enfin évoqué la possibilité pour les médias romands de se doter à terme d’une plateforme de login commune. La branche est « contrainte d’innover« , a souligné Daniel Pillard, directeur de Ringier Axel Springer pour la Suisse romande.

ES
*Disclosure: j’ai eu le privilège d’être invité à Lausanne pour partager certaines de nos analyses lors d’une des keynotes de cette journée.
« La mission du journalisme » : se battre, rester debout #IFJ19 (Pérouse)
Par Nathalie Gallet, France Télévisions, MédiaLab
Il est 17h… nous sommes dans la Sala dei Notari à Pérouse… Italie.. Magnifique ville née quelques 300 ans avant JC, qui abrite le Festival international du journalisme pour la 13ème fois. Cinq jours de conférences et débats alimentés par des intervenants illustres du monde entier.
17h donc.. la salle est comble. Les spectateurs ont envahi tous les fauteuils et bancs possibles pour assister à la séance. Le brouhaha des discussions enflammées sur le journalisme, comme d’hab !
17h05…Rien.. Ou plutôt quelques techniciens qui s’affairent à ce que tout soit plus parfait qu’il y a 5 mn… mais c’est déjà parfait.
A l’ #IFJ les conférences commencent à l’heure..
Mais là.. il est 17h10.. la conférence aura-t-elle lieu ? L’effervescence monte d’un petit couloir qui mène à la salle. Les discussions de la salle s’éteignent. Deux femmes sortent du couloir, filmées, photographiées. Maria Ressa arrive sur scène sous les applaudissements… Elle est là… c’est presque un miracle. Cette journaliste philippine descend à peine de l’avion qu’elle a tenté de prendre 2 fois avant de réussir à s’envoler vers Pérouse… tout en passant par la case prison dans son pays emmenée dans un véhicule par sept policiers. Certaines personnes influentes cherchaient une raison de l’empêcher de partir.
Elle est là et c’est en toute humilité que cette femme, élue personne de l’année 2018 par Time magazine, délivre son message dont l’intitulé de l’#IFJ est : « La mission du journalisme ».
Maria Ressa est une journaliste philippo-américaine. Elle travaille en Asie depuis plus de 25 ans dont la plupart pour CNN. Elle est co-fondatrice et rédactrice en chef de Rappler, site d’information philippin, créé en 2010 et basé sur un journalisme citoyen et de crowdsourcing. Et c’est en tant que témoin et victime de campagnes de décrédibilisation, que Maria Ressa nous livre son expérience aujourd’hui.

Faire monter la haine
Elle nous raconte comment tout s’organise sur les réseaux sociaux pour créer, amplifier et faire monter la haine de personnes qui dérangent. Comme elle, ou son site Rappler sur lequel sont écrit des reportages d’investigation de qualité. Elle décortique la manipulation par le mensonge, les fake news… leur propagation à grande échelle. Les étapes par lesquelles les instigateurs passent soigneusement, une par une, pour réussir à décrédibiliser les journalistes et leurs travaux.

Dans le cas des Philippines, c’est Facebook qui est utilisé. On a coutume de dire qu’internet c’est Facebook dans ce pays. Tout ou presque passe par ce biais. C’est l’écosystème de l’information aux Philippines.
Alors des comptes sont créés, des bots souvent, pour lancer de fausses nouvelles et sont relayés par de vraies personnes qui vont jusqu’à menacer Maria Ressa ou d’autres personnes. Ce qui la chagrine le plus c’est que même de jeunes gens tombent dans le piège.

Cela se passe toujours à des moments opportuns. La sortie d’un article, le vote d’une loi … Des moments où les journalistes doivent être décrédibilisés le plus possible. Des moments où la vérité ne doit surtout pas être crue.
Beaucoup de journalistes sont touchés et pour alerter, Rappler a fait une vidéo sobre que vous pouvez regarder ici : « Defend Press Freedom »
L’utilisation de Facebook, Twitter mais aussi Google dessert ici la démocratie. Car si vous insistez bien sur un mensonge, qu’il se propage sur la toile, qu’il se retrouve en haut des recherches Google, alors les gens le croient VRAI. Et à l’#IFJ, et plus largement dans le monde du journalisme, l’étonnement reste grand devant cette crédulité.
Dans le cas des grandes campagnes de dénigrement aux Philippines, les échanges se font par centaines de milliers, voir parfois au-dessus du million de partages ! Des personnes sont mises en danger. Ici, des journalistes, via l’arme des réseaux sociaux qui emmène les personnes sur des chemins de haine et de violences.
Cette conférence aurait-elle donc du s’appeler « Démocratie en danger via Facebook et consorts » ? Non répond Maria Ressa qui d’ailleurs travailler avec la firme pour trouver des solutions.. non.. son message concerne la raison profonde de sa vocation pour le métier de journaliste : « we need to fight. We need to stand up and fight back »
Continuer de se battre, rester debout … Continuer de se battre pour délivrer des informations de qualité. Pour la liberté de la presse. Et c’est en cela que la mission du journalisme doit, selon Maria Ressa, rester intacte : informer et le faire bien, sans peur…
Démocratie hackée
Martin Moore est directeur du Centre d’études sur les médias, la communication et le pouvoir au King’s College University de Londres. Il décrypte, dans une autre conférence, les mécanismes d’une démocratie « hackée ».
Il explique comment le système de communication a changé avec l’arrivée des réseaux sociaux et la possibilité de toucher une grande partie de la population. Mais aussi de récupérer ses données via des algorithmes appropriés afin de pouvoir manipuler les foules. Selon lui, cela a permis au monde politique de changer sa manière de communiquer en utilisant ces moyens « faciles » mis à leur disposition, permettant une propagation exponentielle, au-delà des frontières, des propagandes et de désinformation.
Le meilleur remède à cela est l’éducation, assure Martin Moore. Et sur ce point tous sont d’accord. Cela fait aussi l’objet de plusieurs conférences et démonstrations dont celle de l’école G.Alessi qui a fait participer ses élèves à la réalisation de reportages. Professeurs et journalistes ont réalisé que l’éveil des consciences valait la peine, que loin de s’ennuyer, les adolescents participants faisaient des remarques pertinentes et ont aimé pouvoir décrypter le rôle des journalistes en se mettant dans leur peau.
Google/Facebook s’éloigner ou se rapprocher ?
Sponsors du Festival #IFJ, Google et Facebook sont désormais parties prenantes du paysage du journalisme d’aujourd’hui. Ils distribuent des sommes faramineuses pour des projets d’information et forcément, suscitent la curiosité. Pourquoi donc donner des centaines de millions d’euros ? Les journalistes se font-ils acheter ?
Critiques du Google News Lab

La plateforme allemande pour les droits à la liberté numérique, NetzPolitik, a présenté à Pérouse une étude très critique des actions du Google News Lab en Europe et des actions de financement de projets journalistiques (DNI). Elle dénonce une sorte d’emprise dans laquelle tout le monde semble se complaire.

Olivia Ma, la patronne mondiale des Google News Labs, elle, a parlé de son enfance avec son père journaliste, sa mère avocate, raconte qu’elle a été élevée dans l’amour du journalisme bien fait. Elle nous dit que chez Google « nous croyons profondément en un journalisme de qualité » et que le but de Google est d’offrir un accès à ce journalisme de qualité parce que c’est la demande des internautes. Elle explique encore que cet argent vient aussi des clics qui génèrent de l’argent et enrichissent Google. C’est, en quelque sorte, une manière de reverser les gains à ceux qui font du clic. Olivia Ma explique donc que Google a la responsabilité de donner de bonnes réponses aux internautes.. Pour avoir leur confiance.. blablabla …Rien de bien neuf donc…
Et Facebook ? Quelle confiance mettre en Facebook ?
La session « Critiquer Facebook ? Oui. Le quitter pourquoi ? » a été, elle, riche de discussion. La sala Raffaello de l’hôtel Brufani était d’ailleurs si remplie que les gens étaient assis par terre. Comme quoi ce n’est pas l’indifférence qui étouffe ce sujet…
Pour l’occasion, Jesper Doub, directeur News Partnerships de Facebook, était à la même table que Jennifer Brandel, Jeff Jarvis, Alan Rusbridger et James Ball. Leur point commun ? Ils ont tous une fascination pour Facebook. Le respect reste la base. En tant que journalistes éclairés, leur recommandation est de « faire avec ». Mais concernant la confiance.. Ils sont aussi unanimes: méfiance, méfiance!

« J’entendais un journaliste du NYTimes dire qu’il fallait quitter Twitter. Moi je vois ces médias comme une possibilité pour ceux qui n’étaient pas entendus avant de s’exprimer. Je trouve donc difficile pour les journalistes de tourner leur dos à ces ressources », a déclaré Jeff Jarvis.
Les jeunes sont plus véhéments… moins mesurés… Et les arguments de James Ball pour laisser vivre Facebook sont loin de devoir être balayés : « Sur Facebook il y a des choses bonnes et d’autres désastreuses. Si on leur donne du crédit on se discrédite encore plus en tant que journaliste. On peut en revanche recommander qui écouter ou lire sur Facebook. Nous devons nous améliorer pour couvrir Facebook ».
Jesper Doub, Pour Facebook, argumente sur les motivations de Facebook et le travail qui est fait pour remédier aux situations de propagande, de fake news, de diffamation. Des groupes indépendants de factcheckeurs ont été créés et travaillent sur les posts. Mais tous savent que cette situation échappe à Facebook qui n’a pas été créé en pensant que le réseau deviendrait ce qu’il est aujourd’hui !
Qui doit réguler ?
James Ball dit : Facebook.. Jesper Doub répond que si c’est Facebook alors qui dans Facebook ? Des journalistes ? Des développeurs ? des salariés au hasard ? Facebook est-il crédible pour avoir ce rôle ? Il explique la complexité d’établir ces règles tout en n’éludant pas qu’il y a urgence à trouver les solutions.
Les gouvernements ? Non. Un collège de sachants ? Des lois ?
Tout cela est bien compliqué et si Jennifer Brandel (Hearken) est présente c’est bien pour montrer que des solutions technologiques sont à l’œuvre. Que l’IA pourra surement aider à trouver rapidement ce qu’il faut enlever ou non de Facebook ou des autres réseaux sociaux. Son entreprise propose notamment d’écouter les réseaux sociaux pour aider les rédactions à faire des articles sur ce dont les gens parlent.
Le résultat de ces débats est tout de même plutôt consensuel : faire confiance à Google, Facebook et autres ? Non. « Faire avec ? Oui », résume l’ancien patron du Guardian Alan Rusbridger, désormais directeur d’un collège d’Oxford.
Comment le journalisme s’en sortira ?
Résumons.. Le journalisme doit vivre pour que la démocratie vive. Il doit être transparent, indépendant à tout niveau. Il doit faire avec les tentatives d’intimidation de façon intelligente et technologique. Il doit être le défenseur de l’information et combattre les fake news.
Bien.. mais comment le financer sans être dépendant ?
Devons-nous croire Google quand, dans la bouche d’Olivia Ma, on entend « On travaille avec vous pour que vous expérimentiez, mais le but est votre indépendance financière » ?
Doit-on croire Facebook quand on comprend que le journalisme n’est pas son métier, mais que Facebook fera son possible pour que les rédactions puissent utiliser le réseau social et faire de l’information de qualité dessus ?
Le journalisme doit-il vivre grâce à la philanthropie ?
Invités de ce panel : Vivian Schiller, Craig Newmark et Alan Rusbridger.
Le premier à s’exprimer fut Craig Newmark, le tueur des petites annonces de la presse US, devenu philanthrope dans les projets qui lui semblent porteur d’un « un journalisme de confiance ».
Ses premiers mots lors de cette discussion ? « En vérité, la presse est le système immunitaire de la démocratie ».
Ce qu’il fait pour le journalisme est pour lui une question d’éthique. Il faut savoir ce que l’on veut comme journalisme.. Et lui c’est un journalisme indépendant et de qualité qu’il défend. Il balaye une quelconque ingérence dans les projets qu’il finance. Le but est de donner les moyens au journalisme de retrouver une posture digne de confiance aux yeux de tous. Il veut pouvoir acheter un journal sans se poser de questions de ce type.
Vivian Schiller, directrice de la Civil Foundation. C’est une fondation indépendante à but non lucratif qui finance les innovations dans le journalisme, notamment via la blockchain. « Elle est fondée sur le principe qu’une presse libre est essentielle à une société juste et équitable ».
Ancienne responsable des news de Twitter, Vivian Schiller se souvient des moments où elle dirigeait NPR, la radio publique nationale aux Etats-Unis. La vie financière pouvait y être compliquée. Elle trouvait que devoir trouver de l’argent rendait le métier de journalisme vulnérable. Cette position inconfortable n’est pas une position que devrait vivre les journalistes qui font leur métier comme une mission, une vocation d’informer avec justesse. La philanthropie « bienveillante » peut éviter cela, dit-elle, aujourd’hui.

Quant à Alan Rusbridger, il a été un acteur important de la transformation du modèle économique du Guardian durant les 20 années qu’il y a passé en tant que patron de l’info. En faisant des appels de fond et, depuis 2012, en créant un système d’adhésion (mise en place réellement en 2015). Le journal a largement tiré son épingle du jeu financièrement. Sur son site, il est suivi par plus de 150 millions de visiteur unique par mois dans le monde entier. Le Guardian a toujours eu une volonté de liberté et d’indépendance et l’a toujours appliqué, notamment sur les révélations d’Edouard Snowden.
Le débat en vient forcément à l’indépendance des rédactions et sur ce point Alan Rusbridger parle de règles claires à appliquer dès le début avec les « philanthropes ». « Des règles claires et de la transparence » pour ne pas avoir à discuter ensuite au lieu de travailler librement. Si ces règles sont bien établies alors Alan Rusbridger pense que cela fonctionne bien.
Alors, à les écouter, la philanthropie serait peut-être une solution. De l’argent pour la démocratie ? De l’argent désintéressé pour la liberté de la presse… Une presse éthique et juste…
Les médias de demain ?
Beaucoup de médias numériques indépendant naissent. Leur modèle économique se fonde sur de l’appel de fonds. Leur raison de vivre est un journalisme indépendant, plus près de son public, à l’écoute. Quelques exemples récents évoqués à Pérouse :
- https://www.zetland.dk/
- https://www.republik.ch/
- https://www.reporter.lu/
- https://www.thesplicenewsroom.com/
- https://hostwriter.org/
- https://www.internews.org/

Une autre nouveauté entre technologie de données et rédaction est en cours de lancement : The Markup. C’est une rédaction qui se veut précurseur car elle est avant tout portée sur les technologies d’enquête numérique. Elle utilise les données pour informer. Son souhait : « mettre en lumière la manière dont des institutions puissantes utilisent la technologie de manière à avoir un impact sur les personnes et la société. »
Julia Angwin, cofondatrice et rédactrice en chef de The Markup, espère montrer une forme de voie pour le journalisme de demain. Tenter d’informer sans fake news ? Peut-être possible grâce à la technologie et à des réflexes de reporter « scientifique » : « hypothèse, recherche de preuves, revoir les hypothèse en comparant avec les preuves » ?
D’autres initiatives expérimentent pour tout faire pour contrer les fake news : le Trust project. Fondé par Sally Lehrman, l’objectif est de restaurer la confiance du public dans la presse. Il aide les rédactions du monde entier qui le souhaite à « montrer patte blanche » en faisant des actions de transparence. Ils font un guide qui définit leur politique journalistique, ils mettent des indicateurs sur leurs articles concernant par exemple des rectifications si il y avait erreur. Ils mettent à jour toutes les biographie des journalistes. Ainsi ces médias obtiennent un label qui montre au public leur engagement pour un journalisme éthique et transparent.
Beau millésime 2019 donc de l’#IFJ avec des journalistes toujours plus passionnés par leur métier, leur mission, et qui tentent de porter la bonne parole pour que ce métier retrouve son identité et sa juste valeur auprès d’une population mondiale qui doute toujours plus.
Car, comme le dit Maria Ressa, « quand on a réussi à instiller le doute dans l’esprit de la population, elle est vulnérable ».
Crédit photo de Une : Simon King via Unsplash
Américains et Chinois privilégient une carrière dans la tech, les Français dans la banque !
Par Eric Scherer, Directeur du MédiaLab, France Télévisions
Si, comme le disent Les Echos ce matin, « la guerre du 21ème siècle sera technologique« , alors la dernière enquête de LinkedIn, publiée cette semaine, a révélé les vainqueurs !
Aux Etats-Unis, comme en Chine, les entreprises les plus attractives en 2019 sont déjà quasi toutes les grandes firmes de la tech; en Europe, l’Allemagne et le Royaume Uni intègrent quelques entreprises de haute technologie parmi les plus courtisées, mais en France, ce sont, comme dans les années 80/90, les banques qui attirent toujours le plus !

USA Chine
Dans les 10 premières compagnies où les Américains souhaitent aujourd’hui travailler (et rester) figurent 9 géants high tech et un grand cabinet de conseil mondial spécialisé dans la technologie. Dans l’ordre : Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Salesforce, Deloitte, Uber, Apple, Airbnb, Oracle et Dell.
En Chine, parmi les 5 premiers choix, on trouve 3 grandes firmes tech (Alibaba, Baidu, ByteDance), un constructeur automobile électrique (Nio), et un conglomérat (Fosun).
Et où les Français rêvent-ils de travailler?
Dans trois banques, aux 3 premières places !
Le mythe des golden boys a la vie dure !
Et donc dans l’ordre : BNP Paribas, Société Générale, Groupe BPCE, puis LVMH, Groupe Crédit Agricole, Axa, Engie, Groupe Bouygues, L’Oréal, Orange.
L’Allemagne et la Grande Bretagne sont toutefois déjà mieux orientées vers les secteurs de haute technologie :
En Allemagne, les entreprises les plus courtisées sont SAP, Daimler, Siemens, Zalando, Deutsche Telekom, McKinsey, BMW, Deutsche Bank, Boston Consulting Group, Amazon.
Au Royaume Uni, les britanniques sont d’abord attirés par Amazon, JP Morgan Chase, Sainsbury’s (distribution), GFK (pharmacie), Bupa (santé), JLL (immobilier), Barclays, BP, Goldman Sachs, Engie.
LinkedIn explique sa méthodologie :
« Chaque année, nos journalistes et data scientists analysent les milliards d’actions effectuées par les membres LinkedIn du monde entier pour découvrir les entreprises qui non seulement suscitent l’intérêt des candidats, mais savent aussi retenir leurs talents.
Ce classement est unique en son genre. Il est le seul à être entièrement basé sur les actions des utilisateurs, ce qu’ils font – et non pas ce qu’ils déclarent – durant la quête du job de leur rêve. Ces données nous ont permis d’établir notre 4e classement annuel des employeurs les plus convoités en France.
Comme toujours, nous avons analysé les actions anonymisées et agrégées des membres selon quatre critères : l’attractivité de l’entreprise, les interactions avec ses employés, l’intérêt pour les offres d’emploi publiées et la rétention des talents. (A noter que nous excluons systématiquement LinkedIn et sa société mère, Microsoft, de tous nos classements. Retrouvez plus d’explications sur la méthodologie en bas de cet article.) »
(…)
« Pour établir ce classement, LinkedIn évalue les entreprises dans quatre domaines: l’intérêt pour l’entreprise, les interactions avec ses employés, l’intérêt pour les offres d’emploi publiées et la rétention des salariés. L’intérêt pour l’employeur est mesuré par le nombre de nouveaux abonnés, non salariés de l’entreprise, à sa page LinkedIn. L’engagement avec les salariés correspond au nombre de consultations des profils des salariés par des non-salariés. L’intérêt pour les offres d’emploi prend en compte la fréquence à laquelle les candidats consultent les offres d’emploi (diffusées gratuitement ou payantes) et y postulent. La rétention des salariés est mesurée par la part des salariés qui restent pendant au moins un an dans l’entreprise ».