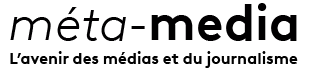En France, les journalistes indépendants à la conquête de YouTube

Quitter des rédactions prestigieuses pour se lancer sur YouTube : un choix de carrière risqué que certains journalistes n’hésitent pas à prendre pour produire de l’information telle qu’ils l’entendent. Un mouvement naissant en France, sur une plateforme plus habituée aux influenceurs et vulgarisateurs. Le pari est osé dans un univers où les succès numériques sont de plus en plus éphémères, soumis à des règles imprévisibles et des difficultés croissantes pour atteindre des followers. Et où les plateformes peuvent du jour au lendemain décider de couper tout un réseau de relations que les créateurs ont mis des années à bâtir.
Par Alexandra Klinnik du MediaLab de l’Information de France Télévisions
Quitter un CDI bien établi pour se lancer en tant que journaliste indépendant sur YouTube. Le défi a priori fait peur. Pourtant, même s’ils restent minoritaires, de plus en plus de journalistes français se lancent dans l’aventure, en quête de sens et de liberté. « Après plus de trois ans au service vidéo du Monde en CDI, je me suis dit : soit j’arrête le journalisme, soit je deviens chauffeur de taxi pour parler de nouveau aux gens, soit je me lance sur YouTube en indépendant », raconte le journaliste Benoit Le Corre, qui, à force de passer du temps derrière son ordinateur, s’est senti complètement déconnecté de la réalité et de l’actualité. Finalement, le trentenaire choisit le grand huit numérique. Il publie sa première vidéo, en tant qu’indépendant, en décembre 2024 qui raconte le quotidien d’un homme statue, un artiste de rue au maquillage doré. La simplicité de la démarche fait mouche. Quatre mois plus tard, sa chaîne compte 134 000 abonnés. Soit une ascension fulgurante … et une anomalie sur la planète YouTube. Le nombre de vues pour une vidéo sur la plateforme étant seulement de 41 vues en moyenne, d’après une étude de l’Université du Massachusetts. Aux Etats-Unis, la migration opérée par Benoit le Corre vers YouTube est déjà chose courante chez les journalistes. Le phénomène est tel qu’il existe de véritables hubs dédiés, résolument business, pour accompagner ces nouveaux-vénus certes motivés mais encore intimidés par YouTube. C’est le cas, par exemple, de l’agence fondée par Johnny Harris, ancien journaliste de Vox et YouTubeur à succès, qui finance son activité en prélevant un pourcentage sur les recettes des journalistes. En France, la tendance émerge de façon beaucoup plus artisanale et spontanée.
Un système d’entraide
Ceux qui se lancent assurent leurs arrières. Bien qu’ils soient encore peu nombreux face à la vague des vulgarisateurs, ils avancent ensemble. Et comptent sur un mentor qui a fait ses preuves : Charles Villa, reporter chez Brut et créateur d’une chaîne YouTube suivie par plus de 803 000 abonnés. À ses débuts, il lance sa chaîne pour partager les coulisses de ses documentaires. Le journaliste-YouTubeur constate que ces vidéos en coulisses attirent parfois davantage de spectateurs que les reportages eux-mêmes, explique-t-il dans le podcast « Zack en Roue Libre ». Désormais à la tête d’une vaste communauté, il y propose des reportages, des interviews et des décryptages, s’imposant ainsi comme une figure centrale du journalisme indépendant sur YouTube. Aujourd’hui, il aide d’autres journalistes à suivre sa voie. Dans son sillage, Justine Reix et Benoit Le Corre bénéficient de son expérience et de ses locaux. « Charles est inspiré par Johnny Harris. Il m’a incité à me lancer et de créer du contenu qui a de la valeur pour moi », explique Justine Reix, ancienne cheffe vidéo de Slate. Pour sa première vidéo, intitulée « J’ai enquêté sur le trafic de viande de singe », mise en ligne début février et qui a connu un bon démarrage (80 000 vues à ce jour), elle a pu bénéficier du prêt du studio : « Si j’avais dû le louer, cela m’aurait coûté entre 400 et 500 euros », précise-t-elle. Aujourd’hui, elle s’équipe progressivement, adoptant une approche « système D ». En parallèle, la journaliste travaille entre autres pour la chaîne de Charles Villa en CDD et en droits d’auteur.
Au-delà du soutien matériel, ces journalistes indépendants s’appuient sur un réseau de recommandations mutuelles. Émerger nécessite un travail d’équipe et de communication. A la manière des pods LinkedIn, ils renvoient vers les travaux de leurs confrères, renforçant ainsi leur visibilité. Charles Villa, par exemple, met en avant sur sa page YouTube Camille Reporter (ex-Brut), Benoit Le Corre, Justine Reix ou encore Charlotte Vautier, ex-Clique sur Canal+, qui a récemment lancé sa propre chaîne de reportage, Ok Charlotte. Dans cette dynamique, on retrouve aussi Camille Courcy (ex-Brut), l’une des premières journalistes de terrain à s’être lancée sur YouTube, qui compte aujourd’hui 148 000 abonnés. Ancienne camarade de promo de Benoit Le Corre en école de journalisme, elle a recommandé ses vidéos sur sa chaîne Camille Reporter, lui offrant ainsi une mise en lumière bienvenue. « Ça a été la petite marche qui m’a permis de monter sur l’estrade », reconnaît Benoit Le Corre, soulignant l’importance du réseau. Même si cela ne reste pas le seul facteur de réussite.

Sur la chaîne YouTube de Charles Villa
Cette émulation incite à progresser. « Avec Charles et Benoit, on se montre régulièrement notre travail. Ça nous oblige à nous remettre en question et à nous améliorer », estime Justine Reix. A l’ère des YouTube Shorts, Benoit Le Corre lui conseille par exemple de publier des vidéos courtes sur Instagram pour renvoyer vers son enquête et toucher ainsi un public au-delà de YouTube : « Il m’a dit que cela avait bien marché pour lui et m’a encouragée à le faire », ajoute-t-elle.
Par ailleurs, ces journalistes ne partent pas de rien et naviguent depuis quelques années dans le vaste univers de la création de contenus. Benoit Le Corre a collaboré avec Camille Courcy sur l’écriture et l’incarnation des vidéos, a été chef adjoint au service des vidéos verticales au Monde et travaille sur les vidéos du YouTubeur Valentin Squirelo. Justine Reix a travaillé avec Hugo Décrypte et Simon Puech. Charlotte Vautier, elle, s’est formée auprès de Cyprien dans l’émission 301 vues sur Twitch et a développé un format d’interviews « en mode portrait » pour Clique, où elle rencontrait des personnalités du web. La journaliste peut aussi compter sur le soutien de YouTubeurs établis : Freddy Gladieux lui prête du matériel, tandis que Cyprien lui distille des conseils basiques mais essentiels (comme ne pas se limiter au format horizontal mais explorer aussi le vertical). Règle parmi les règles : ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Grâce à cette proximité avec les créateurs de contenu, chacun affine son approche. « C’est un vrai atout d’être entouré de YouTubeurs », souligne Charlotte Vautier, dont la première vidéo a atteint 10 000 vues. Pour son premier documentaire, elle s’est intéressée au recul des plages à Miami, en privilégiant l’incarnation. Plus qu’une tendance, c’est une nouvelle manière d’exercer le journalisme, avec ses propres codes… et ses nouveaux réseaux.
Indépendance et place à prendre sur YouTube
« Ce qui est encourageant, c’est qu’on est plusieurs à s’être lancés en même temps. Je suis persuadée qu’il y a une vraie demande, autant du public que des plateformes : une demande pour avertir, moins pour divertir. Vu comment se profile l’état du journalisme en France, c’est le moment de prendre sa place, d’offrir des voix différentes de celles des grands groupes. On ne peut pas entendre seulement de vieux Parisiens issus d’institutions », pointe Charlotte Vautier, la reporter d’investigation pour le documentaire Service Public.
L’objectif de ces journalistes aventureux est clair : reprendre le contrôle de leur manière d’exercer le métier et proposer une information accessible et de qualité. Pour eux, l’indépendance est devenue la seule manière de défendre le journalisme qu’ils veulent pratiquer. Pas besoin de convaincre qui que ce soit d’autre que soi-même. « La seule personne qui donne le go de la diffusion à la fin, c’est moi », se réjouit Benoit le Corre. Mais cette liberté a un coût. Ils doivent composer avec un algorithme imprévisible, une attention du public de plus en plus volatile, une économie dictée par la publicité, et des aides pas forcément suffisantes à l’ère d’un marché de la création en pleine expansion. À cela s’ajoute l’absence de supervision éditoriale, qui leur impose une rigueur encore plus grande pour maintenir un haut niveau de qualité.
Face à des fake news amplifiés par l’IA, développer un journalisme sérieux et rigoureux sur YouTube devient un enjeu majeur. Comme le rappelle l’Alliance de la presse, les utilisateurs de réseaux sociaux figurent parmi les moins bien informés sur des faits vérifiables. Seulement 31% des Américains savent que l’inflation a baissé cette année. «YouTube ne peut pas être que du divertissement et des influenceurs », indique Charlotte Vautier. La plateforme doit aussi devenir un espace d’information crédible. Et ces nouveaux journalistes comptent bien y trouver leur place, aux côtés des créateurs de contenus informatifs (et non plus seulement dans l’ombre !). Et certains l’assurent, l’onglet actualités par YouTube est très mis en avant ces temps- ci. Contactée à ce sujet, la plateforme n’a pas donné suite. Contrairement à Amazon, Apple, Microsoft et Meta qui ont peu d’intérêt pour l’actualité, la mission affichée de Google (dont YouTube est l’une des filiales) est de rendre l’information « universellement accessible et utile », rappelle le chercheur Rasmus Kleis Nielsen.
Ne pas reproduire les codes des médias traditionnels
Si ces jeunes journalistes tiennent tant à se faire une place sur YouTube, c’est qu’ils ne se reconnaissent plus dans un modèle médiatique qui les a peu à peu éloignés du terrain, des gens, des préoccupations quotidiennes. Ils se sentent en décalage, enfermés dans une bulle. Quitter un grand média n’est jamais anodin. Pour Benoit Le Corre, l’envie de renouveau a été plus forte : « J’avais envie d’adopter une manière différente d’incarner l’info, en troquant l’objectivité par l’honnêteté et de raconter l’actualité à travers les histoires de ceux qui la vivent. » Même au sein d’une rédaction comme Le Monde, il s’est senti coupé du réel. Son travail consistait à produire des vidéos pour les réseaux sociaux, souvent basées sur des dépêches d’agence ou des articles déjà écrits : « Plus je baignais dans l’actualité, moins j’avais l’impression de comprendre le monde. Je ne voyais pas les gens. Ma lecture du réel devenait floue. J’avais perdu mon empathie. »
Ce sentiment d’être « hors sol » l’a poussé vers un journalisme immersif. Il voulait retrouver l’information de première main, renouer avec le quotidien des gens : « J’ai toujours fait ce métier pour eux. » Aujourd’hui, le journaliste prend le temps de s’immerger. Il filme le quotidien d’un homme alcoolique et reste plusieurs jours à ses côtés, sans le brusquer. Il suit un artiste de rue, projetant d’abord ses propres fragilités avant de comprendre réellement la personne qu’il a en face de lui. Celui qui se voit comme « l’araignée sympathique du quartier » raconte la vie de ceux que la société ne regarde plus. Son travail se rapproche du court-métrage, observe Pierre Lecornu, son ami et ancien collègue du Monde. Il n’hésite pas à montrer ses doutes, ses erreurs, à reconnaître face caméra qu’il s’est trompé ou qu’il a été bête (selon lui). Il se défait ainsi de l’image du journaliste « sachant ». Comme le dit la journaliste Nina Fasciaux et autrice de l’essai Mal Entendus, qui rappelle l’importance de l’écoute dans la pratique journalistique : « Il faut arrêter de croire que le journaliste est dans la position de sachant parce que sinon ça laisse très peu de place à ce qu’il ne le sait pas ».
Derrière ce choix, il y a une volonté de renouer avec un public de plus en plus sur la défensive. Benoit le Corre veut montrer les coulisses pour restaurer ce lien perdu : « Quand tu lis les commentaires du Monde, tu vois bien que les gens doutent. Soit ils pensent que tu mens, soit que l’information est incomplète donc biaisée. » Et les chiffres le confirment : selon le baromètre de confiance des Français dans les médias, seuls 32 % estiment que l’on peut croire ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité, tandis que 62 % jugent qu’il faut s’en méfier (+8 points en un an). « Une grande partie du public considère que les journalistes cherchent plus à attirer l’attention qu’à rapporter les faits, qu’ils sont motivés par l’argent, et seule une minorité croit qu’ils vérifient indépendamment les informations qu’ils rapportent. La presse aime se voir comme un « chien de garde ». Une grande partie du public la perçoit plutôt comme un « chien de salon », voire pire », ironise le chercheur Rasmus Kleis Nielsen.
Ce besoin de transparence passe aussi par la manière de raconter. YouTube permet à Benoit Le Corre d’intégrer dans le récit ce qui, autrefois, restait hors champ. Ce qui s’apparente également aux documentaires radio, où souvent tout est enregistré. « Pour la première fois, j’ai pu montrer le montage final de ma vidéo aux personnes filmées avant diffusion. Je ne vais pas la montrer pour qu’elle la change, mais pour qu’il y ait un dialogue autour de la vidéo et qu’elle puisse être contextualisée en amont. Cela permet d’approfondir, de rectifier si j’ai fait une erreur, cela permet de préparer la personne », considère-t-il.
Une expérience à l’opposé de celle qu’il a vécue chez Brut. Son rôle consiste à enchaîner les témoignages, filmant des personnes aux parcours difficiles sans réellement avoir le temps d’échanger. Le reporter passe d’un tournage à l’autre sans pouvoir les accompagner ni les préparer à une exposition médiatique potentiellement massive. Nina Fasciaux pointe d’ailleurs une dérive du journalisme actuel : « Beaucoup d’interviews sont tellement cadrées qu’elles deviennent transactionnelles. On ne laisse plus de place à l’imprévu, à l’écoute véritable. Or, on apprend à poser des questions en école de journalisme, mais pas à recevoir la parole des autres pour qu’ils se sentent entendus. » Benoit Le Corre assume aussi de ne plus effacer au montage ce qui pourrait le desservir : « Je préfère intégrer ces moments dans la narration. » Il a retrouvé du sens dans son métier : « En deux mois, mon travail a plus de valeur à mes yeux que durant mes trois années précédentes. » Et ça fonctionne. Sa vidéo C’est quoi le quotidien d’un alcoolique ? cumule 1,5 million de vues.
Son approche séduit par son humilité. Pas de mise en scène, et priorité à la transparence. « La différence entre se mettre en scène – comme le font certains journalistes sur les plateaux télé ou dans les vidéos – et être transparent sur sa démarche, et donc sur qui l’on est, est fondamentale. Cela peut sembler subtil, mais c’est une distinction essentielle. Dès le premier jour de tournage avec l’homme alcoolique qu’il suit, Benoit Le Corre se filme lui-même en expliquant qu’il n’a pas osé filmer son interlocuteur immédiatement, car il voulait d’abord établir une relation de confiance. Il ne cherche pas à se mettre en avant, mais simplement à être transparent et honnête sur son approche. Et c’est là toute la différence », observe Nina Fasciaux. Charles Villa et Camille Courcy misent également sur cette transparence avec leur communauté. Ils n’hésitent pas à parler de leurs difficultés, dans des FAQ, par exemple.
Une économie de bouts de chandelle
Comment faire vivre ses idéaux sur le long terme ? Pour un journaliste indépendant sur YouTube, la diversification des sources de financement est essentielle. La monétisation sur YouTube repose principalement sur les partenariats avec des marques, bien plus que sur les revenus publicitaires d’AdSense, dont le fonctionnement reste opaque. Plus les vidéos cumulent de vues, plus elles rapportent, ce qui pousse à une production intensive… et au risque de burn-out. Confrontés à une concurrence féroce, les créateurs doivent aussi jongler avec un algorithme qui les incite à publier en continu, une stratégie délibérée des plateformes pour maximiser leur rentabilité. Résultat : 75 % des créateurs estiment être pénalisés s’ils ne postent pas régulièrement, et 53 % jugent qu’il est aujourd’hui plus difficile d’atteindre leur audience qu’il y a cinq ans, d’après un rapport mené par Patreon.
C’est dans ce contexte en pleine mutation que les journalistes doivent évoluer. Charles Villa soulève un dilemme déontologique majeur, dans une vidéo FAQ publiée en novembre 2024 : « Je suis un des rares vidéastes à ne pas avoir fait de placement de produit et en réalité c’est ça qui finance la création sur YouTube. Le problème c’est qu’en tant que reporter, ça me met dans une position compliquée. La majorité des marques, pour qu’elles acceptent de venir sur ma chaîne, veulent que j’incarne cette publicité à l’image, mais dans ma profession, il y a des chartes et des devoirs qui interdisent au journaliste de faire de la publicité. Cette charte est hyper importante parce qu’elle permet de protéger l’indépendance d’une profession, d’une certaine manière de la sanctuariser. ». Selon la charte de Munich, un journaliste ne peut pas être un panneau publicitaire. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, plus exactement. Les journalistes-youtubeurs se battent donc avec leurs principes et la réalité économique. Charles Villa pose le doigt sur un vrai problème : « La vidéo, ça coûte cher à produire. Le modèle économique est en pleine métamorphose. Je pense que de plus en plus de marques vont accepter des intégrations, c’est-à-dire de la publicité désincarnée. Je n’ai pas à porter moi-même le placement de produit, c’est déjà le cas pour certains créateurs ». Comme Hugo Décrypte par exemple.
Ce modèle, bien que plus discret, n’échappe pas aux critiques. Un journaliste peut-il se permettre d’être un support publicitaire, même indirectement ? Charlotte Vautier tranche : « Je n’ai aucun problème avec ça, parce que dans tous les cas, on est dépendants économiquement, que ce soient des actionnaires dans les rédactions ou d’une marque de dentifrice sur internet ». Pour l’heure, elle rappelle qu’elle n’en est pas encore là et se donne une vision à deux ans, en multipliant les tests. Et compte toujours sur ses collaborations avec des médias traditionnels comme GQ, Vogue ou encore le pôle vidéo du Parisien. Benoit Le Corre constate un débat plus vif chez les Youtubeurs que chez les podcasteurs : « Dans un podcast, faire la pub d’un sponsor ne choque personne. Mais sur YouTube, cela suscite bien plus de questions. Pour l’instant, je ne me sens pas concerné. Le jour où je devrai y réfléchir, il faudra que je confronte le journaliste que je suis à cette réalité. » Camille Courcy, elle, souligne une autre difficulté dans sa vidéo FAQ : « Les sponsors ne raffolent pas des thématiques journalistiques. Parler de scandales, ça ne fait pas énormément vendre. »
Face à ces enjeux, de nombreux journalistes explorent d’autres pistes, notamment le financement participatif. Une solution, mais pas une garantie, qui nécessite une large communauté ou une armée de true believers, des fans absolus qui vous défendent coûte que coûte. « Il y a dix ans, payer un créateur en ligne pour la valeur qu’il fournit était inconcevable. Aujourd’hui, c’est la norme », affirme Patreon. Selon la plateforme, plus de la moitié des 290 milliards de dollars que représente le potentiel de l’économie des créateurs proviennent des contributions directes des fans : abonnements, formations, événements ou livestreams. Charles Villa, par exemple, réfléchit à organiser des avant-premières pour projeter ses documentaires et rencontrer son public. Mais ces alternatives ne suffisent pas toujours : « J’ai lancé un Patreon et je reçois 400 euros par mois. Cela me permet de payer un monteur pendant une journée. C’est une aide précieuse, mais insuffisante », rappelle le reporter dans sa FAQ. Pour assurer une meilleure rentabilité de son travail, il aimerait alterner davantage entre reportages de terrain et formats plus accessibles, comme des interviews ou des analyses. Car même avec des millions de vues, les coûts de production restent un défi.
Se lancer sur YouTube signifie aussi adopter parfois un statut d’auto-entrepreneur, ce qui pousse à repenser la place des journalistes. Dans la newsletter Très Haut Débit, la journaliste Lucie Ronfaut met en garde : « Je m’inquiète de la généralisation de certains modes de financement propres à la création en ligne dans le milieu du journalisme, de type avoir un Patreon individuel, une newsletter payante, etc. Je comprends la tentation (et la précarisation croissante de notre métier) mais je tiens beaucoup à mon statut de pigiste et à ses avantages. Je suis une salariée rémunérée à la tâche, pas une auto-entrepreneuse. Et c’est un modèle qu’on peut appliquer aux nouvelles pratiques en ligne. Par exemple, ma newsletter #Règle30 est hébergée par un média (Numerama) et rémunérée à la pige. Idem pour Internet Exploreuses, une émission que je co-anime sur Twitch et YouTube, produite par le média indépendant Origami. » Le salariat offre en effet une protection sociale précieuse : assurance maladie, droit au chômage, retraite… Un confort que peu de créateurs peuvent se permettre.
Le Fonds d’aide aux créateurs vidéo sur Internet (CNC Talent), une aide précieuse
En France, les fonds destinés à financer la création de contenu en ligne restent rares, mais le CNC Talent est souvent cité comme une aide précieuse. Ce fonds comporte deux aides sélectives avant la réalisation : une aide à la création, jusqu’à 30 000 euros pour les créateurs vidéo ayant au moins 10 000 abonnés ou ayant été primés dans un festival au cours des cinq dernières années. Et une aide à l’éditorialisation des chaînes, jusqu’à 50 000 euros pour les créateurs vidéo ayant 50 000 abonnés ou plus. Depuis 2017, plus de 700 créateurs en ont bénéficié, avec un total de 14 millions de subventions alloués. Rappelons que les plateformes de vidéos, comme YouTube ou TikTok, versent environ 21 millions d’euros au CNC via la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne, d’après les informations de Klara Durand de Politico.
Cependant, ces financements restent limités face aux besoins du secteur. Comme l’explique Arthur Delaporte, député PS, à Méta-Media, qui prépare avec Stéphane Vojetta (EPR) un projet de loi fin mars sur le sujet : « Il y a le fonds CNC Talent qui est doté de 1,5 à 2 millions d’euros mais ce n’est pas énorme par rapport aux besoins du marché de la création de contenu numérique. 1,5 à 2 millions d’euros, c’est le chiffre annuel de gros influenceurs qui sont des PME de 15-20 personnes, d’un seul gros influenceur. C’est extrêmement faible par rapport à la densité d’un secteur qui est amené à se renforcer. Il faudrait une dizaine de millions par an qui devrait être mis sur le secteur, et pas seulement deux millions. Le CNC en est conscient. Tout ça va bouger dans les prochaines années ». Mais le monde de l’influence, lui, se structure très vite, plus vite que les dispositions de financement public.
Malgré ces limites, plusieurs journalistes comptent sur ce fonds pour développer leurs projets. Justine Reix affirme : « Je n’hésiterai pas à postuler, ça peut me permettre de financer des reportages plus coûteux et acheter du matériel de qualité ». Elle peut d’ailleurs déjà y prétendre, ayant passé la barre des 10 000 abonnés. Benoit Le Corre partage cet enthousiasme : « Ce serait génial, ça me permettrait de bosser avec un monteur, un cadreur ». D’autres, comme Charles Villa, ont déjà pu en bénéficier, avec une enveloppe de 50 000 euros l’année dernière. Camille Courcy, qui a dépassé les 50 000 abonnés, a obtenu l’aide du CNC pour financer, entre autres, deux projets de reportage en Israël et en Guyane.
Par ailleurs, un membre de la commission CNC Talent, appelle à plus de diversité parmi les bénéficiaires : « Je constate qu’il y a une forte présence de vulgarisateurs scientifiques et de critiques cinéma. À un moment donné, il faut ouvrir la porte à d’autres profils. Ces catégories sont surreprésentées. Les mêmes sujets reviennent régulièrement et d’autres profils pourraient obtenir l’aide comme les journalistes. Par ailleurs, je pense aussi aux femmes, qui n’osent pas présenter leur travail et demander de l’argent alors que c’est accessible quand tu fais du qualitatif. Alors que Jean-Michel du 72, avec tout le respect que je lui dois, qui souhaite lancer une chaîne sur la mécanique, n’a aucune honte de faire sa vidéo à l’arrache et demander 50k ». Aujourd’hui, seuls 8% des vidéos sur YouTube sont faites par des femmes, selon une étude 2023 du Haut Conseil à l’Égalité.
Mon double IA
En choisissant désormais d’entrer sur la scène YouTube à la manière des créateurs de contenus, et en osant façonner une identité de marque autour de leur personne, les journalistes participent à une transformation profonde du paysage médiatique. Un phénomène qui comprend autant d’opportunités que de risques. Parmi ces risques, l’emprise grandissante des grandes entreprises technologiques, qui exploitent ces trésors de données pour entraîner des intelligences artificielles capables de simuler nos capacités humaines. « Notre moi soigneusement construit peut être défait de multiples manières en un instant par un deepfake », prévient Naomi Klein. Sans protection adéquate, l’émergence de « fermes à chaînes IA » pourrait reléguer les créateurs de contenu au second plan, les transformant en figurants d’un écosystème automatisé, biaisé par des algorithmes qui enferment le public dans des bulles cognitives.
Dans ce paysage, le journalisme sur YouTube représente une nouvelle forme de médiation, favorisant l’échange direct avec le public. Mais cette dynamique peut aussi reproduire les travers du star-système : personnalisation excessive de l’information, repli sur des cercles d’intérêts restreints, risques de conflits et de polarisation exacerbée. « Finalement, le risque c’est que la personnalité du journaliste puisse parfois primer davantage que ce qu’il raconte », nuance le journaliste du Monde Pierre Lecornu, (qui précise qu’il parle en son nom et pas en celui de la rédaction). L’un des atouts du journalisme en rédaction reste la diversité des sujets traités, enrichie par la confrontation des points de vue et la relecture critique. « À l’échelle d’un journal comme Le Monde, il y a forcément des trous dans l’actualité, mais on essaie de parler de plein de sujets différents. Quand tu es tout seul maître de ce que tu veux faire, tu risques de te limiter aux sujets qui te plaisent », poursuit-il. L’enjeu, alors, n’est pas d’opposer ces modèles, mais de veiller à ce que la diversité de l’information et la rigueur journalistique ne soient pas sacrifiées sur l’autel des logiques de plateforme et des algorithmes de recommandation. « Toute nouvelle initiative est plutôt chouette si cela s’inscrit dans une logique de complémentarité. Plus tu multiplies les types d’approches différentes du métier du journaliste, plus tu es ouvert à plein de façon de le pratiquer, ça enrichit ta vision, si tu es que dans l’opposition à un type de journalisme en particulier et prétend que le tien, le vrai, la façon dont il faudrait faire, tu es forcément limité à un seul type de vision, c‘est un peu dommage », constate Pierre Lecornu. Restons ouverts à la diversité pour le bien-être de l’information !