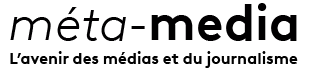10 choses à retenir de l’été 2025 pour les médias

L’été 2025 restera peut-être dans les mémoires comme celui du « Brain Rot », selon Business Insider : face à la surabondance de contenus artificiels, aucune chanson marquante, aucun film, aucun événement fédérateur n’a su émerger, confirmant l’érosion d’une culture partagée. Un contraste saisissant avec l’an dernier, où Jeux olympiques et élections avaient offert des repères communs. L’attention collective se dissout dans les flux personnalisés, la fragmentation s’accélère, et les plateformes imposent discrètement une esthétique algorithmique standardisée. Les films dominants sont des suites (comme Jurassic Park ou Lilo & Stitch), la mode se standardise en avatars fantasmés, et même un son viral comme celui de #Jet2holidays relève davantage du bruit passager que d’un véritable phénomène culturel. Chacun s’enferme dans sa bulle solipsiste, bercé par son assistant intelligent, à l’abri du réel et du soleil. Enfin… peut-être pas tout à fait encore.
Mais bienvenue dans notre ère post-monoculturelle où l’attention collective s’évapore dans le chaos algorithmique. Face à cette apathie ambiante, dix tendances se dessinent (parmi bien d’autres que nous n’évoquons pas ici) : l’affrontement entre avatars IA et influenceurs humains, la prolifération des copies low cost, la montée d’une information hyper-personnalisée, l’émergence de mondes jouables où le public devient bâtisseur, l’effondrement du podcast narratif, les regroupements stratégiques du streaming… et, comme par saturation ultime, en contrepoint, un retour au réel. Là où les réseaux sociaux échouent à créer du lien, les rencontres physiques semblent redevenir essentielles. Peut-être même qu’au détour de l’été, chacun a retrouvé son « enfant intérieur », en serrant son Labubu contre lui. Comme le formule très justement Andrew Roth (DCDX) : « The brain rot is super real… people are going offline ».
Par Alexandra Klinnik, Océane Ansah et Kati Bremme, Méta-Media France Télévisions
1. Les influenceurs humains tiennent tête aux avatars IA (pour l’instant)
L’été 2025 aura marqué un basculement symbolique. Vogue US, longtemps gardien du bon goût et des canons esthétiques, a publié dans son édition d’août une campagne Guess signée par l’agence Seraphinne Vallora, mettant en scène une mannequin 100 % synthétique. Une étape logique après Photoshop et les filtres Instagram, mais cette fois-ci, aucun humain n’a été malmené pour ces images, aucun corps pré-transformé : il s’agit plutôt d’un fantasme algorithmique sorti directement de l’imaginaire de l’IA générative (donc, par extension, de celui de tout Internet), qui rend définitivement impossible la comparaison avec l’humain. Néanmoins, on ne semble pas encore assister au « grand remplacement » des humains par les IA, du moins pour l’instant, en tout cas en Occident.
Les marques dépensent 11 Mds $ par an en marketing d’influence et, malgré l’irruption d’avatars comme la chanteuse virtuelle Yuri, « l’authenticité » et « l’émotion » semblent garder une longueur d’avance. Une majorité (> 50 %) de jeunes déclarent se méfier des figures « trop parfaites », selon un sondage YouGov auprès des consommateurs américains, cité par Reuters. Le Financial Times constate la même tension : les IA offrent échelle et contrôle (pas de caprices, pas de scandales, pas de divergences de ton), mais les créateurs humains gardent de meilleurs taux d’engagement et parviennent à mieux monétiser chaque publication. Cependant, la confusion monte à mesure que l’IA se perfectionne : dans une micro-enquête menée cet été à Times Square, aucun passant n’a su identifier correctement lesquels, parmi six visages présentés, étaient humains et lesquels avaient été générés par une IA. Le révélateur d’un « Turing test visuel » déjà perdu d’avance. La publicité artificielle publiée dans Vogue a déclenché une cascade de réactions de Good Morning America/ABC à Fast Company en passant par The Cut, révélant une fracture nette : innovation publicitaire prometteuse pour les uns, signe annonciateur de la fin de l’humanité pour les autres.
Vogue’s August issue has begun to use “AI models” instead of human models for some of their photoshoots.
— Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2025
pic.twitter.com/zjcwe4hNr3
En Chine, laboratoire à grande échelle de l’avenir avec l’IA, des « virtual humans” tiennent l’antenne des livestreams e-commerce 24/7 depuis longtemps et dépassent des vendeurs humains sur Taobao (combinaison augmentée d’ebay et Amazon) : la marque Brother revendique +30 % de ventes après un passage aux avatars, avec 2 500 $ écoulés en deux heures de lancement, via des bots produits par l’entreprise PLTFRM et adossés à Baidu/DeepSeek. Le potentiel du marché est vertigineux : le volume de ventes généré par le live commerce en Chine devrait atteindre environ 6 400 milliards de yuans en 2025, selon les estimations d’iResearch. Dès 2022, Douyin (la version chinoise de TikTok) captait près de la moitié de ce marché sur les principales plateformes, grâce à l’intégration fluide entre vidéo courte, streaming en direct et parcours d’achat. Mais Pékin (qui était déjà à l’origine de la première loi sur les deepfakes) encadre désormais l’IA générative avec un degré de granularité inédit à travers les « Measures for Identifying AI-Generated Synthetic Content » sorties le 1er septembre. Tous les contenus générés par IA, qu’ils soient textuels, audio, visuels, vidéos ou immersifs, doivent désormais comporter un avertissement visible et persistant, signalant leur caractère synthétique. En parallèle, des identifiants techniques doivent obligatoirement être intégrés au moment du téléchargement ou de l’export, afin d’assurer leur traçabilité.
Les app stores sont eux aussi mis à contribution : ils doivent déclarer et vérifier l’ensemble des services proposant des fonctions de génération, tandis que les conditions générales d’utilisation devront désormais détailler les méthodes employées pour générer les contenus, ainsi que les styles ou balises utilisées pour les identifier. Les grandes plateformes chinoises ont déjà communiqué sur leur mise en conformité. Cette législation est, à ce stade, bien plus prescriptive que le règlement sur l’IA européen, dont l’article 50 impose un devoir d’information et de labellisation des “deepfakes”, mais laisse des marges d’interprétation sectorielles en attendant les actes d’exécution et codes de pratique.
@kanekallaway These 2 AI Avatars sold $7M worth of products in 6 hours (future of commerce) #ai #artificialintelligence #tech #techtok #technology #avatar #shopping #china ♬ original sound – Kallaway
A propos de l’image de soi, Glamour alerte dans un article incisif : des modèles IA comme Vivienne dans Vogue normalisent un « corps numérique » lisse et eurocentré, au risque de détruire des années d’efforts d’inclusion ; même informés, nos cerveaux internalisent ces comparaisons irréelles. Avec un détail important évoqué dans le papier : « Pour ceux qui seraient tentés de défendre l’existence d’une armée de mannequins IA au nom de la diversité qu’elle représenterait, il est essentiel de rappeler que cette “diversité” permet surtout aux marques de capitaliser sur l’idée d’inclusion… sans avoir à inclure, en réalité, de vraies personnes issues de groupes marginalisés. » Pour les marques (y compris celles de l’information), l’équation se durcit : efficacité opérationnelle des avatars (coût, constance, disponibilité) vs capital-confiance humain (vulnérabilité, santé mentale, controverse gérée en direct).
Surtout après les drames révélés cet été, comme le suicide d’un adolescent à la suite de longs échanges avec l’IA de ChatGPT. Dans l’UE, la pression réglementaire se renforce (transparence Article 50, initiatives nationales comme l’Espagne et ses amendes jusqu’à 7 % du CA pour absence d’étiquetage) et rend la traçabilité des contenus un prérequis business, et non plus un « nice-to-have ». Morale provisoire de l’été : pour l’instant, l’IA gagne la bataille de la « scalabilité« , pas celle de la crédibilité. La différenciation passe par une « imperfection assumée », et mesurable qui devient rare, donc précieuse, à l’heure où l’algorithme fabrique à la chaîne des fantasmes sans chair.
2. Comment les plateformes imposent une esthétique IA à bas bruit

Depuis juin, des internautes indignés tirent la sonnette d’alarme sur Reddit. Une nouvelle norme visuelle, façonnée par l’intelligence artificielle, s’installe discrètement sur les grandes plateformes numériques. Sur YouTube, des vidéos sont modifiées à l’insu des créateurs : ombres intensifiées, contours anormalement nets, textures artificielles… Cette esthétique lissée, plastique, transforme le contenu original au point de le dénaturer. L’artiste multimédia Mr Bravo constate que ses vidéos à l’aspect VHS « n’ont plus rien à voir avec ce qui a été initialement mis en ligne », tandis que le vidéaste Rhett Shull s’inquiète d’une perte de crédibilité : « Cela va pousser les gens à croire que j’utilise l’IA (…) Cela finira inévitablement par une érosion de la confiance des spectateurs. »
Si Google assure ne pas recourir à l’IA générative, l’entreprise admet employer des technologies d’« amélioration » via apprentissage automatique, notamment sur les vidéos YouTube Shorts. Le tout, sans transparence ni option de désactivation, ce qui alimente les soupçons. « Le fait qu’ils aient introduit ça en douce, sans modifier les conditions d’utilisation, me fait penser qu’ils veulent qu’on ne sache plus distinguer le vrai du faux », alerte un internaute.
Cette uniformisation ne concerne pas que YouTube. Meta encourage la création de chatbots via AI Studio sur Facebook et Instagram, Snapchat propose des filtres génératifs à partir de selfies, TikTok a lancé Symphony Creative Studio, et les smartphones Google Pixel combinent plusieurs clichés pour générer une photo parfaite d’un moment… qui n’a jamais existé. Au-delà de la performance technique, ces outils habituent les utilisateurs à une esthétique standardisée, façonnée par l’IA. Selon The Atlantic, ces plateformes, autrefois conçues pour favoriser les connexions humaines, tendent désormais à diffuser des contenus impersonnels, calibrés par algorithme. Un internaute résume : « Ils n’arrivent pas à rendre l’IA totalement réaliste, alors ils rendent le réel artificiel. »
« Ils n’arrivent pas à rendre l’IA totalement réaliste, alors ils rendent le réel artificiel. »
Cette évolution soulève une question fondamentale : que devient notre rapport à la réalité lorsqu’elle est systématiquement modifiée en amont ? Comme le rappelle la BBC, une part croissante de ce que nous voyons en ligne est désormais « prétraitée » par l’IA avant même d’atteindre notre regard. Pour Samuel Woolley, professeur en désinformation à l’université de Pittsburgh, le risque est clair : « Les gens sont déjà méfiants vis-à-vis de ce qu’ils voient sur les réseaux. Que se passe-t-il s’ils découvrent que les contenus sont altérés par les plateformes elles-mêmes ? » Dans un environnement où tout semble artificiel, la défiance devient réflexe. Le Digital News Report 2025 du Reuters Institute, évoquait déjà que 58 % des répondants dans le monde doutent désormais de leur capacité à distinguer le vrai du faux en ligne — un chiffre en constante progression.
3. L’effondrement du podcast narratif face à la montée des talk-shows
Le podcast narratif est en train de disparaître. Celui qui, dans les années 2010, incarnait l’âge d’or du journalisme audio, porté par le storytelling immersif et l’enquête au long cours, est aujourd’hui relégué au rang “d’artefact du passé”, selon les mots du média Rolling Stones. En face, le talk-show s’impose. Conversations spontanées, interviews de célébrités, formats vidéo facilement recyclables sur YouTube : le public — et surtout les annonceurs — ont choisi leur camp. Dès 2024, Vulture constatait déjà le basculement : « Les podcasts de conversation ont repris le contrôle du média ». Mais la tendance s’est brutalement confirmée cet été, avec une série de fermetures. En juin, Pineapple Street Studios, fleuron du podcast narratif, a cessé son activité. Le studio était considéré comme l’un des piliers de l’ère post-Serial. Son propriétaire, Audacy, n’étant pas parvenu à rendre l’entreprise rentable, a préféré couper les pertes. Quelques semaines plus tard, début août, Amazon annonçait à son tour le démantèlement progressif de Wondery, l’un des studios les plus puissants du secteur, connu pour ses formats narratifs à succès comme Dr. Death ou The Shrink Next Door. L’entreprise, rachetée pour 300 millions de dollars à peine cinq ans plus tôt, s’apprête à licencier 110 employés.
Le ralentissement du marché publicitaire, enclenché en 2023 dans un contexte économique tendu, a largement contribué à cette crise. Produire un podcast narratif demande du temps, de l’argent, et mobilise des équipes sur plusieurs mois, voire années. Un luxe devenu difficile à assumer dans un environnement où les revenus stagnent. Selon les chiffres rapportés par le New York Times, bien que près de la moitié des Américains écoutent des podcasts chaque mois, les marques allouent en moyenne « moins de 2% » de leurs budgets publicitaires à ce format. Trop cher, trop lent, trop incertain : les conditions ne sont plus réunies, même si les podcasts générés par IA arrivent à grands pas. Mais pour l’instant, les talk-shows, peu coûteux, adaptables en vidéo et portés par des animateurs ou invités (humains) déjà célèbres, cochent toutes les cases du podcast “post-2020”. Ce sont ces formats qui dominent aujourd’hui les plateformes, autant audio que vidéo. Les politiques en campagne y défilent pour toucher une audience directe ; les fondateurs de la Silicon Valley et des membres de la Maison Blanche y participent , notamment dans les interviews fleuves de Joe Rogan, dont les épisodes durent parfois plus de trois heures. Celui tourné avec Joe Sanders il y a deux mois culmine à cinq millions de vues. Les sportifs et les artistes, eux, s’en servent pour aborder des sujets personnels comme la santé mentale, notamment dans Armchair Expert witch Dax Shepard. Le ton est généralement détendu, confidentiel, sans contradiction frontale.
C’est d’ailleurs ce type de cadre que Taylor Swift a choisi pour sa dernière prise de parole publique en août. Plutôt que de donner une interview à un média, elle a préféré apparaître dans le podcast New Heights, animé par son compagnon Travis Kelce, pour annoncer la sortie de son nouvel album. La vidéo a cumulé près de neuf millions de vues en douze heures sur YouTube, établissant un record pour l’émission. Près de 1,3 million de personnes ont suivi la diffusion en direct, interrompue par un bug technique. Sa dernière apparition dans un média traditionnel remontait à 2022, pour une interview avec Variety. Le choix du podcast n’est donc pas anodin : il permet aux célébrités de contrôler leur communication tout en s’adressant à leur audience de manière plus “authentique”.
Ces talk-shows sont devenus, de fait, de puissants outils de branding. Comme le note Vulture, « la notoriété des célébrités est une monnaie d’échange centrale, et ces podcasts sont souvent des exercices d’extension de marque personnelle. La majorité cherche à exploiter la célébrité de leurs invités pour renforcer la leur. Chaque épisode est une transaction : le but est que l’animateur devienne la vraie star de son émission ». Loin de l’exigence journalistique des podcasts narratifs, ces formats privilégient la fréquence, la viralité et la proximité. Même si selon le New York Times, 58 % des auditeurs continuent d’écouter uniquement en audio, sans regarder la vidéo, le format conversationnel, lui, s’impose comme la norme — en partie parce qu’il est conçu pour circuler sur les réseaux sociaux.
4. Un monde submergé par les copies low cost
« Vivre entouré de copies est devenu aussi courant que de faire défiler trois publications identiques sur un réseau social », résume The Verge. Aujourd’hui, difficile d’échapper aux versions low cost. Sur internet comme dans la vie quotidienne, la copie s’est imposée : massive, souvent invisible, parfois même revendiquée. Elle prend la forme de “dupes” assumés sur les réseaux sociaux, mais aussi d’une réalité plus insidieuse : celle des faux sites d’information entièrement générés par intelligence artificielle.
Le journaliste d’investigation Jean-Marc Manach tire la sonnette d’alarme face à cette prolifération numérique. En quelques mois, plus de 6 500 sites créés par IA ont vu le jour, conçus pour manipuler les moteurs de recherche et capter les revenus publicitaires. Spécialiste des questions de vie privée et de surveillance, il distingue trois grands types de plateformes : « ceux qui cherchent à “poper” sur Discover avec des articles putaclics voire mensongers, ceux qui traduisent et/ou paraphrasent des articles journalistiques, et des fermes à liens visant à rendre des liens sponsorisés et/ou à profiter de liens partenaires ». Les deux premières catégories copient les codes du journalisme professionnel afin de tromper les lecteurs, comme les algorithmes.
Derrière ces sites, on retrouve principalement des experts en SEO. Leur objectif : apparaître dans Google Discover pour attirer du trafic, ou utiliser le “backlinking” afin de générer des revenus via des liens sponsorisés. « Ces éditeurs de sites GenAI en administrent des dizaines, voire des centaines, ce pourquoi la base de données est passée de 1 000 à plus de 6 500 en seulement huit mois », explique Jean-Marc Manach. Une véritable industrialisation des contenus, qui siphonne les revenus publicitaires au détriment des médias traditionnels. Le tournant, selon lui, a été la découverte de la vulnérabilité de Google Discover face à cette vague automatisée. « L’algorithme de Discover de Google favorise les fausses informations », affirme-t-il. Incapable de distinguer un article rédigé par un journaliste d’un texte généré par IA, Discover a ainsi mis en avant des intox comme la fin des billets de banque en France dès octobre 2025, ou l’interdiction pour les grands-parents de transférer de l’argent à leurs petits-enfants. Certaines de ces fausses informations, crédibles en apparence, ont même été reprises par des journalistes humains, pensant relayer des contenus fiables. Face à cette dérive, en juillet dernier, Reporters sans Frontières a appelé Google à « renforcer les critères d’accessibilité à la fonctionnalité [Discover] pour favoriser les médias journalistiques authentiques ». Pour l’instant, la prolifération des contenus artificiels qui imitent le journalisme ne montre aucun signe de ralentissement.
Mais la copie ne prend pas toujours des allures trompeuses. À l’opposé de ces contenus automatisés qui se déguisent en articles d’actualité, d’autres imitations s’affichent ouvertement. Ce sont les dupes, ces versions low cost revendiquées comme telles — une imitation assumée, presque célébrée, par une communauté de consommateurs. Imiter des produits emblématiques n’a rien de nouveau, mais le numérique a fait basculer cette pratique dans une autre dimension. The Verge illustre cette dynamique avec l’exemple du clip de Taylor Swift pour sa chanson « Fortnight », dans lequel la chanteuse porte la Pirouette Skort, une jupe-short façon tutu avec un short intégré, conçue par la marque Popflex. En quelques semaines, la pièce est copiée à la chaîne et inonde les plateformes de vente en ligne. Un an plus tard, en mai 2025, la marque recense encore 461 annonces violant son brevet de design.
Nous vivons une époque où la reproduction est devenue la norme, non l’exception. Comme le souligne The Verge : « Il n’a jamais été aussi rapide ou facile de copier et vendre quelque chose. Ce qui autrefois se limitait à quelques stands sur Canal Street est aujourd’hui une industrie à part entière. Certaines entreprises semblent même exister dans le seul but de copier des produits populaires, parfois très spécifiques. »
Chez les consommateurs — notamment aux États-Unis — la chasse aux dupes est devenue un réflexe. Sur TikTok, Instagram ou les forums en ligne, des créateurs de contenu ont bâti leur audience sur la promesse de dénicher ces alternatives à moindre coût. Acheter une copie, c’est aussi dénoncer des prix jugés excessifs, prouver qu’il est possible d’obtenir l’équivalent pour bien moins cher. C’est le sentiment d’avoir « déjoué les marques qui vendent trop cher ce qui ne devrait pas l’être ».
5. Nouveaux modèles économiques des médias à l’ère de l’IA générative
Un autre signal marquant de l’été est venu de la Silicon Valley : Perplexity, la start-up qui défie Google sur le terrain de la recherche, a dévoilé le 25 août Comet Plus, une version enrichie de son navigateur déjà disponible depuis quelques semaines. Pour 5 dollars par mois, les abonnés ont accès à la bibliothèque complète de certaines publications partenaires. Particularité du modèle : 80 % des revenus seraient reversés aux éditeurs, une promesse rare dans un écosystème à la quête de nouveaux modèles économiques, et où la publicité a longtemps dicté la loi. Selon le Wall Street Journal, Perplexity financera au départ ce programme via un fonds de 42,5 millions de dollars, appelé à croître avec l’élargissement de la base d’abonnés. Ce montant intègre aussi les formules Pro et Max déjà existantes, dont les abonnés participent automatiquement à ce schéma de partage.
Comme indiqué sur le blog de la startup, le système de rémunération repose sur trois canaux de mesure : les visites humaines, les citations dans les résultats de recherche et les actions réalisées par un agent conversationnel. Perplexity tente ainsi de lancer une économie du web où les médias ne seraient plus soumis ni aux clics, ni au référencement algorithmique, ni aux IA qui aspirent leurs contenus sans contrepartie (comme c’était le cas de Perplexity jusqu’à maintenant). Derrière cette initiative, il y a bien sûr un contexte plus tendu : la start-up a été visée par de multiples plaintes ces derniers mois, accusée de piller les contenus de presse sans contrepartie. Dernier épisode en date : le 26 août, les groupes japonais Nikkei et Asahi Shimbun ont conjointement attaqué Perplexity pour exploitation illégale de leurs contenus. Comet Plus ressemble donc autant à un geste de paix envers les éditeurs qu’à une tentative de refonder les règles du jeu.
Reste à savoir si ce modèle est viable. Comme le souligne Engadget, l’argument des 80 % paraît généreux, mais rapporté à 5 dollars, cela revient à environ 4 dollars pour un accès illimité à une bibliothèque éditoriale, alors que la plupart des journaux facturent entre 20 et 30 dollars par mois pour l’intégralité de leurs articles. Le risque est donc de dévaloriser le contenu plutôt que de le pérenniser. Si l’expérience réussit, elle pourrait dessiner un nouveau cadre économique pour la presse à l’ère de l’IA générative. Mais les interrogations demeurent : s’agit-il d’un modèle équitable ou d’une nouvelle dépendance vis-à-vis des plateformes ? Vision de long terme ou simple habillage marketing destiné à calmer la fronde des éditeurs ?
6. L’enfance comme refuge sur les réseaux
Au milieu du chaos ambiant, une envie d’insouciance enfantine s’est imposée cet été. Des accessoires traditionnellement associés aux enfants ont fait irruption dans les tendances, adoptés avec enthousiasme par des adultes en quête de réconfort. Depuis leur lancement en 2019, les Labubus sont devenus un véritable phénomène mondial, propulsés par les réseaux sociaux et la mode des vidéos d’« unboxing ». Ces créatures, imaginées dès 2015 par l’artiste Kasing Lung comme personnages d’une série de livres pour enfants, ont pris un nouveau tournant lorsque leur créateur a signé un partenariat avec Pop Mart. La société a transformé ces lutins de papier en jouets de collection, inaugurés par une série de figurines. Le premier porte-clés Labubu, baptisé Exciting Macaron, est sorti en octobre 2023. Depuis, la frénésie n’a cessé de croître, portée par des célébrités comme Rihanna ou Dua Lipa.
@alexbarretov #chabubu #labubu #macaroni #peluches #cheburashka #labubumacarons #labubuthemonsters #labubullfamilie #labubucake ♬ sonido original – MOVIES_.LYRICS
Les réseaux sociaux se sont même lancés dans une bataille culturelle avec l’ancêtre russe du Labubu, Tchebourachka…
Vendues dans des boîtes opaques, ces figurines à collectionner, dont le prix démarre à 15 € pour grimper jusqu’à plusieurs centaines, jouent sur l’effet de surprise. Chaque achat dévoile un personnage au nom et au design singuliers. Pour compléter une série, les collectionneurs enchaînent les achats, accumulent les doublons et espèrent mettre enfin la main sur la pièce manquante. Le format de la « blind box » séduit autant qu’il inquiète. Certains acheteurs reconnaissent son caractère addictif. Pop Mart en a tiré un modèle lucratif : l’entreprise a écoulé pour 670 millions de dollars de produits cette année, davantage que des lignes emblématiques comme Barbie ou Hot Wheels. Mais la facture est lourde pour les consommateurs. Beaucoup avouent avoir dépensé des centaines, voire des milliers d’euros, sans véritable satisfaction. Le sentiment dominant est celui de la culpabilité. Une acheteuse interrogée par The Guardian confie : « La culpabilité après chaque achat est énorme. Parfois j’ouvre une boîte et je n’ai même pas envie de garder ce qu’il y a dedans. » En juin, un le journal du parti communiste chinois a d’ailleurs condamné cette mécanique de vente jugée prédatrice.
Sur YouTube, de nombreuses vidéos relaient les critiques : consumérisme effréné, volonté d’entretenir un imaginaire enfantin malgré un monde chaotique, et brouillage des frontières entre jouets pour enfants et objets de collection pour adultes.
Un autre phénomène, également venu de Chine avant d’atteindre les États-Unis, intrigue : les tétines pour adultes. Comme celles des nourrissons, elles sont censées apaiser, aider à supporter le stress ou à trouver le sommeil. Vendues entre 10 yuans (1,40 $) et 500 yuans (70 $), elles sont présentées comme des accessoires « anti-stress » ou « aides au sommeil ». Mais l’illusion a un prix, cette fois sanitaire. Des médecins alertent sur les dangers de ces objets inadaptés à la morphologie adulte. Le docteur Tang Caomin, dentiste au Sichuan, met en garde : une utilisation prolongée peut modifier l’occlusion dentaire, endommager les articulations ou perturber la respiration.
@annieeebellieeee #fyp ♬ Why Am I Like This? – Orla Gartland
Psychologues et sociologues évoquent un « phénomène de régression ». Après la pandémie et dans un contexte international anxiogène, certains adultes se replient vers des gestes ou des objets qui rappellent l’enfance, « refuge d’un temps sans factures ni réunions tardives ». La tétine ou la figurine ne sont pas de simples accessoires : ce sont des raccourcis vers un confort psychologique, une tentative de retrouver l’innocence et la sécurité d’avant. Autre phénomène : La génération Z organise désormais des concours de sosies publics, aux États-Unis comme ailleurs, pour élire le meilleur « mâle performatif ». Loin du cliché du sportif de salle, il cultive une masculinité alternative, douce et ironique : boire du matcha, lire bell hooks, écouter des chanteuses-compositrices, garder des tampons dans son sac… et parfois accrocher un Labubu à son tote bag. Chacun s’essaie à ce rôle de parfait allié, souvent plus costume qu’intime conviction.
@landonsfits nahhh performative male in the gym bro? 😪💔🥀 #fyp #foryoupage #performative #matcha #feminist #feministliterature #malemanipulator #labubu #gym ♬ Lil Phoebe x Melodica – sanilovesmusic
Sur TikTok, les vidéos taguées #performativemale cartonnent, et les recherches du type « Pourquoi le matcha est-il performatif ? » se multiplient. Comme l’a expliqué Malik Marcus Jernigan, gagnant du concours « mâle performatif » de Seattle, la plupart des participants, lui y compris, incarnent la blague avec légèreté. En donnant aux adultes l’occasion de jouer, d’exagérer et de se mettre en scène comme des enfants, ces concours répondent à un besoin plus large de régression et de déconnexion : une manière légère et collective de s’éloigner non seulement du sérieux du quotidien, mais aussi d’un monde où la tension et la violence montent de toutes parts.
7. L’hyper-personnalisation de l’information
L’été 2025 a vu la personnalisation sortir de l’ombre pour devenir un axe stratégique des médias. The Verge a introduit un onglet “Following” qui permet de suivre des auteurs, des rubriques et des thèmes précis, donnant naissance à un fil personnalisé mais conservant la hiérarchie éditoriale, avec l’espoir de retenir les lecteurs plus longtemps dans l’écosystème, et de construire de la fidélité directe, sans dépendance aux plateformes sociales. La rédaction a aussi lancé des résumés quotidiens adaptés aux usages : digest rapide pour le matin, articles plus développés en journée. De son côté, Wired a mis en place une refonte de son expérience abonné : newsletters thématiques plus ciblées, Ask Me Anything (AMA) réguliers avec les journalistes, retour des commentaires modérés et versions audio de ses enquêtes.

Deux initiatives différentes, mais qui traduisent la même bascule : faire de la personnalisation une expérience éditoriale et non plus un simple outil de recommandation. Tandis que la stratégie de The Verge met l’accent sur le produit et l’interface : créer des habitudes de lecture et retenir des audiences volatiles grâce à une UX pensée comme un flux “pour vous” (à la TikTok ou Threads), celle de Wired, au contraire, insiste sur la relation éditoriale : transformer la personnalisation en un dialogue avec les lecteurs, où l’abonné peut choisir ses formats, interagir avec les journalistes et accéder à des contenus enrichis. Là où les réseaux sociaux offrent des contenus « pour vous », Wired promet une personnalisation « avec vous », c’est-à-dire une coproduction de l’expérience avec le lecteur. Dans cette même logique, le Handelsblatt en Allemagne expérimente des formats adaptés au moment de la journée (brief court le matin, contexte en journée, analyse le soir), avec un premier jalon : Smart Search, un bot éditorial qui puise dans les articles et podcasts du titre en citant ses sources et en renvoyant au corpus.
TODAY: Join our "Back to School in the Age of AI" livestream AMA at 1 pm ET on how tech moguls, policymakers, and teachers and students are transforming the classroom.https://t.co/f7BfaJcfMb
— WIRED (@WIRED) August 28, 2025
Discret mais révélateur : Google tente la fonction Preferred sources dans Top Stories, qui permet aux internautes de privilégier certains médias dans leurs résultats. L’écosystème entier glisse ainsi vers un modèle où l’IA ne se limite pas à produire, mais orchestre aussi la distribution en fonction de nos routines, de nos centres d’intérêt et de notre seuil d’attention. Les premiers résultats confirment l’intérêt : les pages d’accueil personnalisées de The Verge affichent un CTR plus élevé de 24 % chez les utilisateurs connectés, prouvant ainsi qu’un agencement individualisé peut générer une croissance de revenu incrémentale lorsqu’il repose sur une offre éditoriale forte.
Le paradoxe final : si chacun a « son » média, à quoi sert le média (comme l’a formulé de façon plus élégante Bruno Patino dans « La Fabrique de l’Information » de François Saltiel) ? L’IA générative rend désormais techniquement possible la personnalisation du contenu lui-même (ton, longueur, contexte, langue, voire même format, ce que certains appellent « le contenu liquide »), au-delà du simple tri d’articles. Exactement ce que décrit le rapport 2025 du Reuters Institute sur les attentes et réticences face à l’info personnalisée (utilité perçue, mais méfiance dès que l’algorithme remplace le jugement éditorial). L’hyper-personnalisation déploie toute sa puissance pour l’accessibilité, avec résumés, audio ou niveaux de lecture adaptés, mais elle devient un risque existentiel dès lors que chacun bascule dans son propre média : dilution d’une compréhension partagée, appauvrissement du débat public et disparition de l’effet-média lorsque la Une n’est plus commune, enfermement dans une bulle emplie de flagornerie où l’on n’est plus confronté qu’à ses propres biais. Tout l’enjeu consiste à imaginer un design éditorial capable d’épouser les usages, en personnalisant l’accès et le rythme, sans jamais perdre de vue les priorités assumées, une hiérarchie lisible et une responsabilité éditoriale clairement revendiquée.
8. Streaming : les regroupements s’accélèrent
Dans un paysage audiovisuel de plus en plus fragmenté, les grandes plateformes de streaming et les chaînes de télévision traditionnelles se rapprochent rapidement. Objectif : proposer des offres groupées pour simplifier la vie des consommateurs saturés d’abonnements, tout en renforçant leur position dans un marché ultra-concurrentiel. L’été 2025 a été celui des rapprochements inattendus. Le 18 juin, TF1 et Netflix ont annoncé un accord majeur : à partir de l’été 2026, les chaînes du groupe TF1 ainsi que les contenus de TF1+ seront accessibles directement via la plateforme Netflix en France. Une intégration qui marque un tournant pour l’industrie, symbolisant la fusion croissante entre télévision linéaire et streaming. Quelques semaines plus tard, France Télévisions a officialisé sa présence sur Prime Video. Depuis le 3 juillet, les abonnés français peuvent accéder aux contenus de france.tv depuis un espace dédié sur la plateforme d’Amazon, sans changer d’interface.
À l’international, la tendance se confirme. Outre-Manche, ITV, le principal groupe de télévision commerciale au Royaume-Uni a signé le 16 juillet un accord de partage de contenu avec Disney sur leurs services de streaming respectifs, ITVX et Disney+. Aux États-Unis, Comcast, propriétaire de NBCUniversal et Amazon ont conclu fin août un accord pour proposer la version sans publicité de Peacock sur Prime Video Channels. Notons que ces accords illustrent une stratégie plus large d’agrégation déjà bien avancée chez Amazon. Prime Video propose des abonnements à d’autres services tels que HBO Max, Paramount+ via son application. Pendant que les géants du numérique affinent leur stratégie d’agrégation, Canal+ opère une offensive dans le monde physique. Le 2 septembre, le groupe a annoncé être en négociation exclusive pour entrer au capital du réseau de salles UGC, avec une prise de contrôle potentielle à horizon 2028.
Face à la multiplication des plateformes et des abonnements, les utilisateurs expriment une fatigue croissante. Selon une étude Nielsen, en 2023, il fallait déjà en moyenne 10 minutes et demie à un spectateur pour choisir un contenu à regarder – contre 7 minutes et demie en 2019. Un symptôme d’un marché devenu illisible. Dans ce contexte, les offres groupées (ou bundles) apparaissent comme une solution naturelle. Une étude de la société Antenna, spécialisée dans les abonnements, révèle que le nombre de nouveaux abonnements pris via des plateformes tierces a augmenté de 40 % en deux ans.

De plus en plus de spectateurs préfèrent centraliser leurs abonnements et leurs paiements sur une seule interface. Une évolution que Jonathan Carson, PDG d’Antenna, n’hésite pas à qualifier de « prochain chapitre des guerres du streaming » : une bataille pour devenir « le nouveau câblo-opérateur » de l’ère numérique. Ces rapprochements ne sont pas sans paradoxe. Il s’agit d’une “coopétition” : les plateformes coopèrent tout en restant concurrentes. Le succès d’une alliance repose sur l’équilibre délicat entre intérêt collectif et préservation des intérêts individuels. L’échec de la plateforme française Salto, projet commun de TF1, France Télévisions et M6, en est la preuve. La transformation en cours dessine les contours d’un nouveau modèle : un retour déguisé au “bouquet” de chaînes, mais à l’ère du streaming.
9. Les nouveaux modèles du monde jouables
On en parle depuis longtemps (vous vous souvenez du « métavers »), mais le progrès technologique rend l’idée de plus en plus concrète : une nouvelle ère de réalités jouables émerge, où l’on ne se contente plus de regarder mais où l’on participe, redéfinissant les frontières du divertissement et de l’expérience numérique. Google, Tencent et les communautés open source conçoivent des mondes virtuels toujours plus réalistes, interactifs et personnalisables, à la croisée du jeu vidéo, de la simulation et de l’intelligence artificielle. Netflix a officialisé ses « immersive experiences« , ces extensions interactives de ses franchises qui transforment l’abonné en participant. Showrunner, présenté comme le “Netflix de l’IA”, met l’utilisateur aux commandes : à partir d’un univers créatif existant, il peut écrire et jouer ses propres scènes, convoquer les personnages de son choix, définir les lieux, orchestrer les dialogues et laisser l’algorithme générer une chute finale. L’expérience ouvre une brèche : la fiction n’est plus un récit figé mais un terrain de jeu collectif où se réinventent les codes du divertissement. Reste à savoir si chacun souhaite passer du rôle de spectateur passif à celui de scénariste en herbe, pour qui la valeur de l’expérience réside autant dans l’interaction que dans le contenu.
La recherche en IA franchit une étape clé : après avoir généré des images, des textes et des vidéos, les modèles savent désormais produire des mondes interactifs jouables. Google DeepMind a présenté cet été Genie 3, un moteur capable de générer en temps réel des environnements navigables à partir d’un simple prompt. L’utilisateur peut intervenir en cours de simulation par commandes textuelles, de type “un orage approche”, et voir l’univers se transformer instantanément. D’autres acteurs avancent vite : Tencent développe Hunyuan Gamecraft, entraîné sur des millions de séquences de jeux AAA pour créer des environnements dynamiques proches des standards commerciaux. Dans le monde de l’open source, SkyworkAI enchaîne les prototypes. Avec Matrix-Game 2.0, l’IA est déjà capable de produire de petites séquences interactives d’une minute environ, animées à 25 images par seconde. Matrix-3D, de son côté, transforme une simple photo ou même une phrase en panorama à 360°, dans lequel on peut se déplacer comme si l’on y était. Quant au projet Yan, encore en phase expérimentale, il vise la création de mondes interactifs en haute définition (1080p, 60 images/seconde). Sa particularité : découper le travail en trois étapes : simulation, génération et édition en temps réel. Dans tous les cas, le principe est le même : l’IA ne produit plus un média figé mais un environnement persistant, réactif et personnalisable.
Ces “modèles du monde” bouleversent les règles du divertissement. Pour les studios, ils offrent un laboratoire de prototypage : la possibilité de créer un décor ou tester une intrigue en quelques minutes, sans équipes de développement. Pour les plateformes, ils ouvrent la voie à de nouvelles formes de monétisation : pass saisonniers, contenus dérivés co-créés avec les fans, licences prolongées par la communauté. Pour les publics, ils sont l’occasion de s’approprier les récits, de les détourner, de les vivre ensemble. On voit apparaître aussi des formats hybrides : podcasts interactifs avec embranchements narratifs, documentaires jouables où les choix du spectateur modifient la trajectoire, programmes TV enrichis de sondages ou de votes en direct. Reste la question des risques : propriété intellectuelle des scènes générées, biais des données d’entraînement, toxicité potentielle des mondes ouverts aux communautés. Mais l’horizon est clair : nous entrons dans une ère où le public devient bâtisseur, où les mondes ne sont plus seulement racontés mais vécus et transformés par ceux qui les habitent.
10. La reconnexion au réel
Et finalement, juillet-août ont aussi été l’occasion de décrocher des écrans, peut-être même davantage que les années précédentes. Pour la génération Z, les émissions de téléréalité qui ont rythmé les soirées estivales sont devenues un prétexte à se retrouver lors de watch parties. Sauf que cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une pratique numérique émergée pendant le Covid, qui permettait de regarder un programme ensemble en ligne, mais d’un retour nostalgique à la vraie vie, qui est d’ailleurs plus « party » que « watch ». De Love Island, aux États-Unis et au Royaume-Uni, à Secret Story en France, le concept est simple : se réunir dans un bar pour regarder un épisode ensemble.
Derrière l’aspect festif, ces rassemblements répondent à un double besoin : rompre avec la solitude et recréer du lien collectif. La génération Z, souvent décrite comme particulièrement isolée, s’inscrit dans ce phénomène que les médias ont qualifié d’« épidémie de solitude ». Ainsi, elle y voit de véritables grands événements, recréant des rituels partagés dans un quotidien fragmenté. Ce retour de l’expérience partagée s’inscrit dans un mouvement plus large : la raréfaction des « tiers-lieux » — ces espaces sociaux entre la maison et le travail — et le désir croissant de se distancier des écrans qui ont marqué l’enfance de cette génération. Des personnalités publiques comme Violette Dorange, benjamine du Vendée Globe, témoignent d’une lassitude face à la « course aux likes ». Son post, fin juillet, sur la pression mentale des réseaux sociaux a déclenché plus de 87 000 réactions… preuve, paradoxe amusant, de la puissance des plateformes qu’elle critique.
Les marques ont vite compris cette aspiration au concret. Polaroid, en particulier, s’est distinguée avec une campagne “outdoor résolument humaine et sensible”. Sur des posters manuscrits et des tirages bruts, la marque propose des slogans simples mais efficaces : « L’IA ne peut pas recréer la sensation du sable entre tes orteils », « Tu te souviens de cette soirée qu’on a passée sur nos téléphones ? Moi non plus », ou encore « Des vraies histoires. Pas des stories. » Tandis que l’univers publicitaire s’agite autour de l’IA, de l’automatisation et du ciblage algorithmique, Polaroid a pris le contre-pied : miser sur le silence et la simplicité dans un monde saturé de bruit numérique. Un pari risqué, mais qui résonne avec la lassitude croissante face à l’écran permanent.

Conclusion
Ces dix tendances tracent le portrait d’un été fragmenté, oscillant entre la tentation du simulacre (IA, avatars, clones numériques) et le besoin pressant d’authenticité (rencontres en chair et en os, échanges imprévus, récits sans fard). Les jeunes générations, de leur côté, ont littéralement « crashed out ». Peut-être est-ce le premier été où l’on a vraiment décroché… sauf sur LinkedIn, royaume des désœuvrés numériques, où une querelle surréaliste a opposé de prétendus experts autour de Luc Julia. Mais ce n’est pas tant le contenu du débat qui compte que ce qu’il révèle : l’ultracrépidarianisme qui prolifère sur les plateformes, où chacun s’érige en spécialiste d’un sujet qu’il maîtrise à peine, à l’aide de son assistant IA. Symptomatique d’un climat plus large, où la cacophonie des opinions peine à masquer le silence d’une culture commune en train de se dissoudre. Entre avatars générés et conversations sans fin, cet été aura surtout mis en lumière la difficulté de retrouver un récit collectif.
Illustration de Une : KB, avec ChatGPT