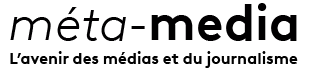Liens vagabonds : Femmes dans les médias, l’égalité toujours en quête de visibilité

Si l’égalité entre les femmes et les hommes a été proclamée « grande cause nationale » en France, cette promesse semble aujourd’hui reléguée au second plan. Elle est remplacée par une instabilité chronique, avec un ministère dédié qui change de mains à chaque remaniement. Cette mise à l’écart se reflète aussi dans les médias. Alors qu’elles représentent 50 % de la population mondiale, les femmes n’apparaissent que dans 26 % d’extraits d’émissions télévisées, de radios ou d’articles de presse, selon les données récentes du Global Media Monitoring Project. Ce chiffre est resté quasiment stable depuis 15 ans. « Les femmes restent presque invisibles dans les médias », souligne l’étude. Ce manque de visibilité a des conséquences, notamment pour les jeunes filles qui grandissent sans modèles ni récits auxquels s’identifier.
Autre constat alarmant : les violences de genre sont à peine couvertes. Moins de 2 articles sur 100 évoquent les abus subis par les femmes, alors que 736 millions d’entre elles dans le monde font face à des violences physiques, sexuelles, économiques ou psychologiques. Or, les attaques doivent être nommées pour exister et pouvoir être combattues. Quand les médias ignorent un phénomène, ils en empêchent l’émergence dans le débat public. Et quand elles sont mentionnées, les femmes sont souvent cantonnées au rôle de victimes, de témoins, de faire-valoirs, rarement comme expertes, malgré leurs qualifications. En France, des outils existent, comme l’annuaire Expertes, qui recense des milliers de femmes compétentes prêtes à être sollicitées par les médias. Ce biais structurel se retrouve également dans la production journalistique : les reportages réalisés par des femmes journalistes citent 29 % de femmes, contre seulement 24 % dans ceux rédigés par des hommes. « Lorsqu’on met sous les yeux des journalistes le défilé des unes, rubriques, pages pleines de photos et propos d’hommes, leur justification première est toujours étonnante : « Ce n’est pas notre faute, nous on montre la réalité. » Une réalité dans laquelle la moitié de la population a disparu et l’autre est devenue complètement blanche ? Non, ils ne montrent pas la réalité », ironise Alice Coffin. La diversité dans les rédactions influence directement la façon dont l’information est construite et diffusée. Comme le théorise Pierre Bourdieu, « la télévision qui prétend être un instrument d’enregistrement devient instrument de création de la réalité ». Les médias ne se contentent pas de refléter le monde. Ils le façonnent, participant ainsi à l’effacement des femmes.
Pour y remédier, il faut se poser des questions simples : qui est au centre des récits ? Qui est interrogé ? Comment et où l’information est-elle diffusée ? Les usages eux-mêmes sont genrés, comme le montre un article de 2021 de La revue des médias sur les « gender editors ». Jessica Bennett, ex-responsable éditoriale chargée des questions de genre au New York Times, témoigne que les femmes utilisent davantage Instagram, et que les mères qui travaillent lisent plus facilement une newsletter envoyée tôt le matin. « Sans la voix des femmes, il n’y a pas de récit complet, pas de démocratie juste, pas de sécurité durable, et pas d’avenir commun », alerte Kirsi Madi, directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes, qui appelle à une refonte radicale du système. « La responsabilité incombe désormais aux gouvernements, aux rédacteurs en chef, aux plateformes, et aux décideurs politiques de concrétiser cette égalité », poursuit-elle.
Quelques signes d’espoir émergent toutefois du côté du streaming. En 2025, 36 % des nouvelles émissions diffusées sur ces plateformes ont été créées par des femmes, contre seulement 20 % à la télévision traditionnelle, selon un rapport de Boxed In sur la représentation des femmes à la télévision. « Un progrès historique dans le streaming », avance même Variety. Les personnages féminins principaux gagnent aussi en présence, passant de 44 % à 49 %. Mais les stéréotypes perdurent chez tous les diffuseurs : les femmes à l’écran restent majoritairement jeunes et rayonnantes, entre 20 et 39 ans, tandis que les hommes sont plus souvent représentés dans la tranche 30-49 ans. Old habits die hard…
CETTE SEMAINE EN FRANCE
- Commission d’enquête TikTok : le rapport préconise l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans (LCP)
- Violences urbaines” : les journalistes encore dans le viseur du ministère de l’Intérieur (Télérama)
- Affaire Thomas Legrand : le journalisme politique malade de son corporatisme (Acrimed)
- France Inter : Thomas Legrand renonce à son émission hebdomadaire, mais reste sur la station (AFP)
- IA : après OpenAI, Anthropic ouvre une filiale en France et va recruter localement (l’Informé)
- « Bloquons tout le 10 septembre » : une activité record sur les réseaux sociaux mais moins forte que lors des « gilets jaunes » (Les Echos)
- Vincent Bolloré en pole position pour racheter “le Parisien” à Bernard Arnault (Nouvel Obs)
- Le média « Brut » racheté par CMA CGM, propriété de Rodolphe Saadé (Le Monde)
- La famille Safa réinjecte un million d’euros dans Valeurs actuelles (La Lettre)
- Après 45 ans d’existence, le magazine du samedi de l’Équipe devient un hebdo d’actualité sportive (L’Équipe)
- Le schéma (très) français de la gouvernance IA :
3 CHIFFRES
- TikTok dépasse les 200 millions d’utilisateurs en Europe, rapporte Reuters.
- Selon une étude internationale réalisée par Equativ, rapportée par Minted, 82% des Français utilisateurs des plateformes IA se disent prêts à accepter un modèle financé par la publicité, mais à condition qu’elle ne soit pas « subie ».
- 95% des utilisateurs de ChatGPT visitent Google, mais seulement 14% des utilisateurs de Google visitent ChatGPT, selon Search Engine Land.
LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Les phrases deviennent plus courtes

Source : The Economist
NOS MEILLEURES LECTURES / DIGNES DE VOTRE TEMPS / LONG READ
- Les influenceurs de droite se tournent vers les affaires étrangères (Wired)
- Roblox, l’application de jeu vidéo la plus populaire au monde est aussi une dystopie hypercommerciale qui fait tourner le cerveau au ralenti (NY Mag)
- Comment Apple apprend à son intelligence artificielle à s’adapter à l’ère Trump (Politico)
- Quelque chose ne tourne vraiment pas rond en ligne. Le cycle de la violence continuera tant que le média, lui, restera inchangé (Charlie Warzel, dans The Atlantic)

DISRUPTION, DISLOCATION, MONDIALISATION
- Microsoft renvoie officiellement les employés au bureau. Lisez la note de service (Business Insider)
- L’IA provoque un étrange regain de spiritualité (Usermag)
- Comment lisent nos enfants (et comment ça les transforme) (Le Figaro)
Vingt-huit minutes de lecture contre cinq heures sur les écrans : pour séduire les jeunes, Dom Juan de Molière se lit désormais en écho à la série Adolescence, Booktok remplit les rayons des librairies, et sur Wattpad, les lecteurs influencent directement les intrigues en cours en proposant la suite des chapitres…

DONNEES, CONFIANCE, LIBERTÉ DE LA PRESSE, DÉSINFORMATION
- Au moins 19 morts lors des manifestations de la « génération Z » contre l’interdiction des réseaux sociaux au Népal (The Guardian)
- Le verrouillage médiatique en Guinée (rfi)
LÉGISLATION, RÉGLEMENTATION
- Chat Control : le projet de surveillance des messageries a (encore) du plomb dans l’aile (Next)
- La justice fédérale rejette l’accord à l’amiable d’Anthropic avec les auteurs pour 1,5 milliard de dollars (Fortune)
- Le Sénat américain étudie un amendement pour limiter les exportations de puces vers Pékin (New York Times)
- Un standard technique pour faciliter la négociation des droits pour les contenus utilisés par les IA, soutenu notamment par Yahoo, Reddit, Medium, O’Reilly, Ziff Davis, Fastly, Quora, Adweek… (Tech Crunch)
JOURNALISME
- 6ᵉ rapport sur l’IA de la WAN-IFRA : la valeur de l’intelligence artificielle vue par les éditeurs (WAN-IFRA)
- Les éditeurs saluent la décision de l’UE visant à démanteler le monopole de Google dans la publicité technologique (Press Gazette)
- Dave Jorgenson se lance en solo sur TikTok avec Local News International (NiemanLab)
- Reach va réduire ses effectifs rédactionnels de 186 postes dans la « plus grande réorganisation » à ce jour (Press Gazette)
- Les médias ont-ils encore besoin de la critique culturelle ? (New York)
- Financer le journalisme en taxant les plateformes : RSF appelle les États à suivre les recommandations du Forum sur l’information et la démocratie (RSF)
- Lachlan Murdoch, le prince des médias qui voulait devenir roi (New York Times)
STORYTELLING, NOUVEAUX FORMATS
- Comment l’anime a conquis l’Amérique (New York Times)

ENVIRONNEMENT
- Comment la guerre de Trump contre la science du climat affaiblit la recherche scientifique (Bloomberg)
RÉSEAUX SOCIAUX, MESSAGERIES, APPS
- La transparence alimente une hausse des tarifs de sponsoring des créateurs (Digiday)
- Les TikToks de Planet Money ont inspiré l’un des films d’animation les plus brillants de l’année (The Verge)
- Les vidéos des assassinats de Charlie Kirk et d’Iryna Zarutska ravivent le débat sur la modération des réseaux sociaux (CNN Business)
STREAMING, OTT, SVOD
- Espagne : Disney+ et Atresmedia signent un accord de diffusion de leurs contenus (Deadline)
- TelevisaUnivision déclare la guerre à YouTube (Axios)
- Les séries créées par des femmes augmentent fortement, mais uniquement sur les plateformes de streaming (New York Times)
AUDIO, PODCAST, BORNES
- 5 000 podcasts. 3 000 épisodes par semaine. 1 $ par épisode — Le plan d’une start-up d’IA dévoilé (The Hollywood Reporter)
- Les AirPods Pro 3 peuvent traduire en temps réel des conversations (TechCrunch)
Apple just announced its new real-time language translation for AirPods Pro 3.
— Alvaro Cintas (@dr_cintas) September 9, 2025
It looks insane 🤯 pic.twitter.com/rfdPEISpjT
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DATA, AUTOMATISATION
- Des musiciens d’Amérique latine affirment que l’IA vole leurs écoutes (ou leurs revenus en streaming) (Rest of World)
- Business Insider a retiré 40 articles aux signatures suspectes. Sont-ils liés (par l’IA) ? (Washington Post)
- OpenAI soutient un film d’animation réalisé par l’IA (The Wall Street Journal)
- Les chercheurs peuvent-ils empêcher l’IA de fabriquer des citations ? (Nature)
MONÉTISATION, MODÈLE ÉCONOMIQUE, PUBLICITÉ
- Les annonceurs se projettent déjà sur la Coupe du Monde de l’année prochaine (Digiday)
Par Kati Bremme et Alexandra Klinnik