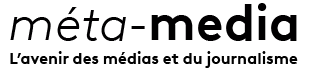#IA – Cauchemar d’éditeur: le moteur de réponses remplace le moteur de recherche
« Nous nous dirigeons vers un monde où plus personne n’aura besoin de visiter des sites web et donc de voir des publicités d’éditeurs qui financent des trucs comme le journalisme », a averti il y a quelque jour un journaliste dans un podcast du New York Times.
Car en ce moment le monde de l’IA dans la Silicon Valley ne parle que d’un site : Perplexity.ai ! Ce service n’est pas un agent conversationnel, mais un mélange très séduisant combinant search et IA. Et préfigure … la mort possible des revenus tirés des liens vers les contenus des éditeurs.
En gros, à votre question, Perplexity fournit, à partir de multiples contenus du web, un résumé instantané parfait, un article à la volée bien présenté, avec des encadrés pertinents et à jour. Une sorte de Wikipédia dynamique et personnalisé, sans passer par le search classique.

Certes les principales sources sont affichées en haut de la page, mais rares sont ceux qui creuseront davantage le sujet, car la réponse proposée, synthèse intelligente de nombreux contenus soigneusement choisis, suffit et fait gagner du temps. Mais, pour l’instant, ces sources – souvent des éditeurs de presse– ne sont pas rémunérées, au nom du fameux « fair use », le principe de citation du monde universitaire.

Perplexity, fondée par un ancien d’OpenAi et de DeepMind de Google, revendique 10 millions d’utilisateurs mensuels actifs et une durée moyenne de visite de 21 minutes. La version pro coûte 20 $ par mois, comme pour GPT-4. Et Jeff Bezos est un des actionnaires.
Face aux éditeurs terrifiés, le CEO et fondateur de Perplexity, Aravind Srinivas, estime que son moteur de réponses offre un meilleur référencement, une meilleure visibilité que Google, et permet d’accroître la notoriété des sources. Il reconnaît toutefois qu’il faudrait mieux monétiser cette notoriété.
« Nous devrions pouvoir dire au New York Times le nombre fois qu’un de ses extraits a été utilisé dans des réponses de Perplexity cette semaine ».
“Notre but est de devenir le lieu de facto de l’information sur Internet (….) l’appli ultime de la connaissance, le TikTok du savoir!”, a-t-il indiqué dans deux récents podcasts.

« Aujourd’hui vous perdez beaucoup de temps à obtenir une réponse qu’une dizaine de commerciaux essaient de vous donner », précise-t-il. « Google, qui travaille d’abord pour les annonceurs, n’a aucun intérêt à vous faire gagner du temps ».
Il réfléchit ainsi à des modèles d’abonnements groupés avec des médias. Mais sa diversification de revenus passera à terme par les APIs et la publicité, a ajouté il y a quelques jours Srinivas.
Sur Perplexity, explique Srinivas, « la compétence N°1 est de poser de bonnes questions ».

La recherche peut être affinée et se concentrer uniquement sur des groupes de sources, comme par exemple les seules vidéos YouTube, ou les posts Reddit. Les erreurs existent mais sont bien moins nombreuses que sur les plateformes d’IA générative.
Evidemment, le roi du search, Google, pourrait faire la même chose que Perplexity. Il le fait d’ailleurs discrètement depuis plusieurs années dans des encadrés brefs. Mais son modèle d’affaires basé sur des liens sponsorisés – déjà partiellement cannibalisé par son IA Gemini- serait en grand risque. Wall Street ne manquerait pas de sanctionner tout recul des revenus publicitaires du géant de Mountain View.
Le « search génératif » de Google (dopé à l’IA) qui a déjà fait chuter le trafic de plus d’un tiers vers les sites d’infos d’Amérique du Nord n’est pour l’instant pas disponible en Europe. Il pourrait toutefois y arriver sous une forme intégrée au search classique d’ici moins d’un an, selon des contacts pris auprès de Google.
Les prochaines étapes chez Perplexity ?
Des notifications de news (« Perplexity Push ») et « des résultats encore plus fiables, des questions et des réponses sous forme audio et vidéo (dire « multimodales » !), un meilleur raisonnement et plus de personnalisation », promet Srinivas.
D’autres offres semblables se multiplient comme l’appli « Arc Search » sur iPhone ou « Consensus » et peut-être bientôt via Reddit, qui vient de signer un accord important avec une firme d’IA.
Demain, nos smart phones, nous donnerons à la volée les cinq infos importantes du moment. Et peu d’entre nous se soucieront des sources !
ES
ps : ah j’oubliais ! Perplexity fonctionne aussi en Français !
Le chemin de la narration, par Alessandro Baricco…
Par Hervé Brusini, Président du Prix Albert Londres, ancien rédacteur-en-chef de France Télévisions
Vous vous souvenez, Les Barbares, ou The Game ? Les deux ouvrages ont marqué par leur pertinence d’approche du monde numérique.
Alors quand, leur auteur, Alessandro Baricco, dit : « De façon extrêmement synthétique et la plus claire possible, j’ai rassemblé les principales choses que j’ai pu comprendre à propos de la narration. Il me semblait utile, de faire en quelque sorte, un point de situation… » Voilà qui est prometteur. Mieux, cela ne se rate pas.
D’abord, il y a cette déclaration de guerre à la vision hollywoodienne des récits
C’est une toute petite plaquette, qui en 25 points, éclaire ce que le romancier/théoricien de la modernité digitale appelle « La via della Narrazione », autrement dit « Le chemin de la narration ».
Une des questions cruciales de notre temps (on serait tenté d’écrire depuis « le début des temps ») – le mot étant prononcé, presque proféré à tout bout de chant – est donc ici exposée en quelques lignes. Un pari qui s’annonce surprenant comme toujours chez Baricco…

D’abord, juste préciser qu’au beau milieu du fascicule, il y a ce que Baricco appelle un bref essai consacré à Christopher Vogler et son « Voyage du héros ».
En fait, c’est une déclaration de guerre. Vogler est cet écrivain, scénariste, théoricien américain dont l’influence est forte sur nombre de productions d’Hollywood. La conviction principale de ce dernier est que toutes les histoires du monde dérivent d’un modèle unique. Un même archétype immuablement valable, que l’on raconte une guerre intergalactique, ou la vie d’un petit garçon dans l’Angleterre rurale du 19è siècle, souligne l’écrivain italien.
Ainsi. Au début de l’histoire, selon Vogler, « le héros » passe par des stations bien définies. Il commence par vivre une existence normale. Puis, il reçoit un appel, qu’il refuse dans un premier temps. Il rencontre ensuite « Un Mentor ». Il part enfin pour accomplir sa mission et passe un nouveau seuil qui le plonge dans une deuxième partie de l’histoire…
Bien sûr les variantes de ce schéma sont innombrables, mais elles s’inscrivent indique Baricco, dans un fascinant système de boîtes chinoises où pratiquement tout ce qui est racontable est prévu, ajusté, fixé...Voilà qui est naïf et réducteur critique l’auteur des Barbares. Cette approche a un côté « bon sens », griffe l’italien, qui selon lui donne ce sentiment de maison inhabitée, comme passage artificiel de pièce en pièce d’un magasin de meubles suédois.
Les règles de Vogler, assène Baricco, ne sont pas la conséquence d’une vie, mais la substitution de la vie. Qui plus est, ajoute le critique qui se fait virulent, c’est dangereux. Vogler prononcerait une énormité. Il ne décrit pas une habile façon de structurer un récit, insiste Baricco, il affirme que cette construction relève, et provient de l’inconscient collectif. Autrement dit, nous serions tous des héros avec un voyage à accomplir. Et le narrateur serait le récitant de nos vies à toutes et tous.
Bref, raconter l’histoire de tous: le rêve du cinéma hollywoodien. Et Baricco de claquer la porte au nez du scénariste, théoricien.
Et puis, il y a la poésie lumineuse qui vous emporte
Ayant porté l’estocade à l’adversaire théorique, Baricco développe son approche. D’emblée, la langue singulière de celui qui écrivit aussi « Soie » ou « Novecento : pianiste » déploie son monde. Son pouvoir d’attraction vous parle. Sa rationalité est poétique. De fait, elle ne vous est pas étrangère parce qu’elle sait décrire le fonctionnement de la narration, et ce qu’elle provoque en soi et en nous.
Écoutez plutôt le point numéro Un : « Il arrive que d’étonnantes cartes du réel sortent du bourdonnement blanc du monde, et se mettent à vibrer avec une intensité particulière, anormale. Parfois, comme un agréable bruissement d’ailes… Là où se vérifie cette vibration, est générée une sorte d’intensité qui, lorsqu’elle dure – allant ainsi au-delà du statut de pure et simple merveille – tend à s’organiser et à devenir une figure dessinée dans le vide. On dirait que pour obtenir une certaine permanence, elle crée autour d’elle un champ magnétique, qui a sa propre géométrie. Nous, nous donnons un nom particulier à ces champs magnétiques. Et ce nom est « histoire ».
Bien sûr, vous êtes surpris par cette façon d’aborder la question. Assurément, Baricco parle ici d’inconscient, de concepts psychanalytiques. Mais, de grâce, surtout, ne lâchez pas la rampe. Vous allez le constater, même si elle suppose un petit effort, la lumière est à portée de main.
En tout cas, déjà des mots clés sont apparus, retenons ces deux-là : Intensité et histoire. Avec cette précision donnée au point numéro 3 : « Une Histoire n’est jamais une ligne, mais toujours un espace.»
Vous voudriez des exemples ? Les voici présentés par l’auteur en quelques catégories avec des commentaires explicatifs.

Il y a Le trou noir. L’illiade d’Homère, Don Juan de Molière, ou Dracula de Bram Stoker en sont les représentants. Ce sont des dynamiques contradictoires où les forces en présence semblent se donner pour mission le fait de détruire l’obscure source de vie qui les génèrent et les terrorisent, affirme Baricco.
Ensuite, il y aurait La réparation. C’est Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle, L’Amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, ou Le Grand Passage de Cormac Mc Carthy.
Explication de l’auteur : c’est l’ordre du monde qui subit des altérations et rien ne s’atténue jusqu’à ce qu’une force patiente et déterminée finisse par réussir à remettre les choses en ordre.

Le Tourbillon. C’est l’odyssée d’Homère, le Voyage au bout de nuit de L.F Céline, ou La recherche du temps perdu de M. Proust.
Le commentaire de l’auteur précise que dans ce Tourbillon, Il existe une seule chose : un mouvement circulaire qui obsessionnellement tourne autour d’un même point. Mais le résultat n’est pas égal à zéro. Dans sa démarche, il crée ou il consume le monde, en altérant tout ce qui compose l’existant.

Qu’y a-t-il de commun entre L’attrape-cœurs, Hamlet et Les Évangiles ?
Il y a enfin,la désertion avec Hamlet de Shakespeare, L’attrape-cœur de J.D Salinger, ou Les Évangiles.
Et l’auteur de décrire : De l’alignement de la matière un morceau se détache, apparemment devenu fou, qui met en péril la séquence entière des choses réelles. Le résultat final est la régénération du système, ou le réalignement de la cellule en désertion.Façon singulière de relire cette diversité d’œuvres. A la relecture, apparaît la pertinence. Tel est l’autre manière de décrire les histoires.

La liberté est au cœur de la narration
Mais attention, ne pas confondre ces quelques exemples avec la tentation d’établir une classification finie des Histoires. Vogler ne doit plus rester qu’un mauvais souvenir. Les formes des champs magnétiques chers à l’auteur, doivent rester illimitées. Cet aspect est fondamental, prévient Baricco, car il garantit « le lien entre histoires et liberté. »
Autre mise en garde, les histoires sont comme des courants marins qui s’entrelacent, affirme Baricco. Certainement pas un assemblage de personnages. Pour mieux lire ces courants, les humains leur ont donné une apparence anthropomorphique. Les personnages, les caractères, les héros sont toujours la traduction anthropomorphique d’une énergie, d’un courant, d’une section du champ magnétique.
Et Baricco de préciser :…Invisible, l’histoire demeure dans les esprits, collectif ou individuel. Et de là, elle ne peut sortir. Il faut l’imaginer comme une sphère d’énergie qui repose sur elle-même, inaccessible… Proust a pu la comparer avec ces personnes qui après avoir fait des photos, gardent la pellicule dans un coffre, sans jamais la développer.
Bien tout cela est bien beau direz-vous, mais comment les connait-on ces « étrangetés intenses et magnétiques, ces histoires » ?
La réponse est toute simple. Vous allez le voir, l’atterrissage se fait en douceur éclairante : Ce qui fait venir au monde l’histoire, c’est le geste de raconter…Pour accéder à la forme de récit, l’histoire doit perdre beaucoup d’elle-même. Car, le récit est bidimensionnel, alors que l’histoire vit dans une infinité de dimensions. C’est une sphère et elle doit devenir une ligne. C’est un espace qui doit devenir une séquence temporelle…L’expédient technique grâce auquel on réduit une histoire au format de récit s’appelle « la trame ».
Mais attention, ne jamais confondre trame et histoire
Le point numéro 10 est un avertissement sans appel :
Il n’y a pas pire erreur que de confondre trame et histoire.
La trame est un voyage linéaire dans une histoire, précise Baricco… C’est comme une voie ferrée qui traverse un continent… Qui voyage ainsi ne pourra pas dire qu’il a vu l’ensemble du continent mais il l’aura habité, senti…
Et nous voilà parvenus aux points 13, 14 et 15, et vous êtes toujours là, c’est formidable. Alors, nous avons vu que les histoires sont des champs magnétiques, espaces d’intensité, que le fait de raconter rend lisibles, selon une trame. Mais il manque encore quelque chose de magique dit l’auteur à savoir :
Le style. On ne peut l’enseigner. On l’a ou pas… Ce n’est pas un marteau qui servirait à frapper. Tout au contraire, c’est une respiration.
Baricco rapproche le style de la voix. A l’instar de cette dernière chaque style est unique, Le big bang qui l’a généré est un pur mystère, ajoute l’auteur, le style c’est toujours de la lumière.
18, 19, 20, nous arrivons bientôt au bout ce chemin de la narration. D’insidieuse et tendre manière, Baricco plante ses balises sur cette voie du récit que nous empruntons tous sans l’avoir ainsi décrite.
Et Baricco qui se fait notre guide sur ce chemin de la narration, ajoute : Avec le style, l’histoire et la trame prennent corps.et deviennent la terre, et en définitive la réalité. Avant l’intervention d’une voix (entendez, le style), ils sont comme un événement interrompu, un instrument musical parfait dont personne ne joue… Pour ainsi dire, le style est ce qui rassemble le ciel et la terre. Le ciel des histoires et la terre du réel.
Donc, souligne Baricco, raconter c’est l’art de laisser aller une histoire, une trame et un style dans un seul et même mouvement. Son but c’est de rassembler ciel et terre.
Nous voici arrivés à la fin de cet étrange voyage. Métamédia aura ici fait un grand pas de côté, via l’une des voix fortes qui accompagnent la modernité numérique.
Ce sont les ultimes stations, les dernières paroles d’un styliste du récit :
Il arrive souvent que l’histoire, l’intrigue et le style s’entremêlent complètement, dans l’exercice en or de ce que nous appelons la narration. Dans un nombre limité de cas, leur fusion est si ronde qu’elle efface tout signe de suture et toute trace de construction. La narration atteint alors des sommets où elle apparaît comme de la magie, et non comme le processus chimique qu’elle est à la base. Cette illusion d’optique, ce glissement vers le mythe, en fait un événement quasi mystique, et c’est là qu’il entretient avec la vérité la relation particulière qu’on lui a parfois attribuée.
VÉRITÉ, le grand mot est donc lâché en toute fin de parcours. ÉDUCATION est son corollaire pour Baricco.
On peut enseigner à reconnaître les histoires, affirme l’auteur qui lui-même enseigne la narration dans son université de Turin. On peut aussi enseigner la trame, mais pas le style. C’est ainsi que le geste de raconter se transmettra de génération en génération, et rien ne sera perdu de ce que l’homme peut faire pour donner un son à certaines vibrations du monde.
« Mettre tout au service de la fringale des nouvelles » (1923)
Par Hervé Brusini, Président du Prix Albert Londres, ancien rédacteur-en-chef de France Télévisions
Pour les baby-boomers, les 50 ans du journal Libération respirent la nostalgie. Celle d’une autre époque. Une époque de kiosques, de petite monnaie, d’encre de presse, du froissement de papier déplié, replié, du café crème et du bistrot. Une famille de rituels et de surprises en voie de disparition.
Et avant ?
Paradoxalement, c’est sur l’ordi qu’on s’en va chercher les traces d’un passé de papier. Il nous a si vite échappé. Et l’on tombe sur une perle de l’histoire de la presse…
Quand une féministe déclare son amour pour le journal papier

Oui, c’est elle, et c’est un pur hasard. Mais le plaisir est souvent le fruit du pur hasard. Le web en est l’un des moteurs, il sait se faire machine à remonter le temps. Et voici la rencontre. Une grande dame qui se faisait appeler par un simple prénom nous attend.
On l’ignorait. Un clic et Caroline Rémy, alias Madame Séverine a surgi. C’est une journaliste, écrivaine aussi. Indéniablement, une reportrice à la force de conviction aigüe. Elle est féministe, libertaire, ajoutent les bios qui lui sont consacrées. Elle a fait partie de l’expérience éditoriale de La Fronde. Pas étonnant. Ce quotidien aimait à se définir, journal politique, littéraire, dirigé, administré, rédigé par des femmes. Sa parution fut chaotique de 1897 à 1930. Marguerite Durand, la fondatrice mettra toute son énergie à tenir à bout de bras cette singularité historique de la presse. Droit à l’avortement, droit de vote, office du travail pour les femmes… Durand et son équipe sont de tous les combats. Et Madame Séverine en est l’une des figures de proue. Tel est le contexte, en somme, l’enveloppe qui recouvre la perle.
Ce 4 octobre 1923, un nouveau journal lui a demandé une sorte de profession de foi, un texte-proclamation qui sache le représenter. Avec en prime le portrait de l’autrice en Une.
Madame Séverine s’est exécuté, son article s’intitule : « la chanson du soir. »

La feuille qui l’accueille, s’intitule Paris-Soir et son fondateur est Eugène Merle, un marseillais militant anarchiste qui fait l’objet d’une attention soutenue de la police. Le dossier de cet antimilitariste, internationaliste monté à Paris est long comme le bras.
Très vite, le journal va accumuler les déficits. Et Merle de devoir céder le titre à tout son contraire, un capitaliste, Jean Prouvost, industriel du textile, fils d’une dynastie propriétaire des lainières de Roubaix. Paris-Soir deviendra l’un des plus forts tirages de la presse parisienne. Pierre Lazareff fait partie de l’équipe de direction. Il inventera les magazines d’information à la télévision. Stop, voilà pour le futur…passé. Mais revenons à Séverine.
Au début, elle parle de ce soir qui « n’a pas les grâces voluptueuses de la nuit ». « Il a l’espèce de fatalisme d’un dieu éphémère », ajoute la journaliste volontiers poète. Mais là n’est pas son propos. Madame Séverine veut nous parler du journal.
Oui, c’est cela, du journal en papier. Vieille sensation tactile, odorante. Car le soir serait ce moment idéal pour se le procurer, mais pourquoi donc Madame Séverine ? Parce que le soir, nous dit-elle, c’est par définition la fin de la journée, le moment où l’on retrouve ses esprits, surtout dans la capitale…

Autrement dit, on sort du boulot. Car, à l’époque le boulot avait une fin. Le télétravail n’était même pas une idée. Et que se passe-t-il ?

Le crieur de journaux se fait entendre. Un JT de 20 heures avant l’heure, en quelque sorte. Et 20 heures c’est bien mieux que 8 heures du matin.

« Mettre tout au service de la fringale des nouvelles », bref une sorte de web sans la toile, rien qu’avec du papier. Même envie insatiable, mais sur 5 ou 6 feuilles. Une tyrannie, dit madame Séverine. Nous employons aujourd’hui le même mot.

« La faculté de l’enthousiasme », « la puissance de comprendre », selon Séverine, telles seraient les vertus de ce public avide d’information. Et pourquoi pas encore aujourd’hui ? Mais la journaliste pose une condition d’une redoutable actualité.

Ne pas trop se haïr, éviter l’insulte, Séverine évoque une situation qui lui pèse. Elle la décrit longuement. Elle parle de sexe, de générations…
Actualité du propos !?! Laissons à cette perle venue du passé, 100 ans d’âge, le mot de la fin. Elle y parle d’un idéal dont serions sevrés depuis si longtemps. Actualité encore.

« Alors ce sera si beau, le journalisme se sera si perfectionné qu’il n’y aura plus de journalisme »
Par Hervé Brusini, Président du Prix Albert Londres, ancien rédacteur-en-chef de France Télévisions
Si l’on osait la paraphrase, on dirait ceci : un redoutable dérèglement informatique est aujourd’hui constaté. Il a pour nom de domaine IA, intelligence artificielle. Le degré de dépendance à l’égard de cette famille de logiciels s’élève si dangereusement que d’aucuns préconisent une pause dans sa mise en œuvre. Autrement dit, l’avenir immédiat fait peur.
Parmi les victimes annoncées de ce scénario aux allures de Terminator, le journalisme serait assurément l’une des premières…

La technologie ou le progrès du journalisme
D’autres voix tranchent avec cet avenir préjugé funeste. Elles parlent de progrès.
Il est vrai que leur proximité avec l’actuelle issue cauchemardesque est d’un autre ordre. C’est en 1883 que dans son livre intitulé « XXe siècle, La vie électrique » le dessinateur et écrivain Albert Robida évoque un « téléphonoscope » qui permettra à tous de communiquer par le son et l’image. En 1889, « La journée d’un journaliste américain en 2890 » parle d’un journalisme téléphonique. C’est Michel, le fils de Jules Verne qui rédige cette courte nouvelle. Elle met en scène Francis Bennett qui active son « phonotéléphote » pour converser de visu avec sa femme de l’autre côté de l’atlantique dans un hôtel des Champs Élysées Puis, il s’en va inspecter la salle des journalistes de son journal le « Earth Herald ».
Et le fiston Verne de poursuivre : « Ses 1.500 reporters, placés alors devant un égal nombre de téléphones » ont reçu pendant la nuit les nouvelles des quatre coins du monde. Il précise : « L’organisation de cet incomparable service a été souvent décrite. Outre son téléphone, chaque reporter a devant lui une série de commutateurs, permettant d’établir la communication avec telle ou telle ligne téléphotique. Les abonnés ont donc non seulement le récit, mais la vue des événements, obtenue par la photographie intensive.»
Une autre vision d’avenir saisit par sa justesse. En 1892, Eugène Dubief rédige un ouvrage intitulé « Le Journalisme ». L’auteur se présente comme un « ancien secrétaire général de la direction de la presse au ministère de l’Intérieur ». Mais gare aux réflexes conditionnés. Dubief n’a rien d’un ennemi de la presse. Tout au contraire. Il est aussi secrétaire de la ligue française de l’enseignement. Et voici ce qu’il écrit, tout en vous assurant que vous n’avez pas la berlue.
Sentiment que vous pourriez éprouver à cette lecture : « Un épervier (Ndr un épervier est une sorte de filet) indicible de conduits électriques enserrera le globe. Par eux , de partout, les nouvelles afflueront au cabinet du journaliste, comme par autant de filets nerveux ; d’autres filets nerveux les transmettront au même instant chez tous les abonnés ou les emmagasineront dans leur phonographe. Puis, qui sait ! Nos neveux ayant trouvé enfin l’art de voir à distance, l’image, les gestes, le jeu des acteurs, des orateurs, des personnages célèbres suivront la même voie qui aura transmis leurs actes ou peurs paroles. Moyennant l’abonnement le plus minime, le citoyen du XXe siècle pourra évoquer devant lui, à volonté, un diorama vivant de l’Univers et être sans cesse en communion avec tout le genre humain… Alors ce sera si beau, le journalisme se sera si perfectionné qu’il n’y aura plus de journalisme… Le téléphone et le phonographe supplanteront le Journal »
Confondant, non ? Le web avant l’heure. Tout y est ou presque : l’électricité, l’aspect planétaire, le singulier et le collectif, le temps réel et jusqu’au téléphone, pas encore smart mais presque.

L’intelligence artificielle : défi d’une autre nature lancé au journalisme
Pourtant, l’enthousiasme de Dubief néglige un point crucial.
A ses yeux, la nouvelle existe en soi. Sa recherche, sa collecte, son traitement semblent n’avoir aucune importance puisque seul compte le moyen de transmission. De fait, cette vision où le journalisme est réduit à sa technicité de diffusion est largement répandue.
Pour beaucoup, les inventions de l’imprimerie, la radio, le cinéma, la vidéo, et désormais le numérique semblent être bien souvent les seules balises de l’évolution du journalisme. Avec évidemment, toutes les atteintes des différents pouvoirs à la liberté de la presse.
Mais, l’information, elle, serait un intangible des sociétés humaines, un intangible susceptible de se dissoudre dans la technique.
Or, jusqu’ici, il n’en est rien. Il y eut bien un « avant » le journalisme, mais pas encore un « après », malgré les inventions successives. De plus, pour l’heure aucune technologie de transmission n’a tué la précédente.
Mais, cette fois, le péril serait d’une autre nature. Car, l’IA vise l’écriture même du journalisme qui existe bel et bien. En s’appuyant sur la statistique des répétitions de mots, d’expressions, de séquences images, l’intelligence artificielle produit de l’information très copie conforme. Depuis de nombreuses années déjà, des articles sont rédigés par des robots pour rendre compte des résultats qu’ils soient électoraux ou sportifs. Le chiffre renvoyant aux chiffres. Idéal. Et puis, la capacité des logiciels s’est fortement sophistiquée. L’ampleur du spectre du balayage des connaissances s’est amplifiée. Les séries se sont affinées. Un pseudo réel professionnel basé sur le répétitif s’affiche à présent de plus en plus, toujours plus difficile à distinguer. Parfaitement crédible.
L’intelligence artificielle lance un défi au journalisme. Il serait finalement, comme tant d’autres activités, automatisable. L’uniformité tant reprochée aux médias apparaît alors comme une preuve supplémentaire de cette répétition.
Voici donc le journalisme renvoyé à lui-même, contraint de définir son exigence, obliger de se considérer au-delà de ses modes de transmission. Reportage, enquête, questionnement des faits peuvent constituer quelques garanties de préservation d’une information « made in humanity« .
Retour aux fondamentaux. Sinon, comme le dit Dubief, de façon devenue terriblement grinçante avec le recul, « le journalisme se sera si bien perfectionné qu’il n’y aura plus de journalisme ».
Guerre en Ukraine : le retour du reportage…et des reportrices
Par Hervé Brusini, Président du Prix Albert Londres, ancien rédacteur-en-chef de France Télévisions
Ils — elles, surtout désormais — sont aujourd’hui aux avant-postes des médias d’information.
Par leur truchement, les séquences se succèdent, auprès des populations, des combattants, des officiels. Tantôt visions d’horreur, tantôt moments d’humanité. Reportrices et reporters accompagnent, témoignent de la guerre en Ukraine, au long cours. On connait mieux qu’hier leur nom. On les salue, conscients que nous sommes des difficultés de leur métier. Certains y laissent d’ailleurs la vie. C’est la guerre, avec ses centaines de milliers de victimes…Le reportage est de retour, avec en première ligne les femmes journalistes…
Le reportage : L’enseignement de l’antiquité

Raconter la guerre, la montrer, en somme la faire vivre à celles et ceux qui sont au loin, voilà bien le travail des reporters.
Dans leur périlleux exercice, ces femmes et hommes de l’info, s’inscrivent dans l’histoire du long parcours des narrations. Car l’art du récit est bel et bien étroitement lié à l’art de la guerre. Dès les premières lignes de son récent livre intitulé « La part d’ombre, le risque oublié de la guerre », l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau évoque cet enracinement dans l’antiquité.
« C’est en grande partie pour dire la guerre, la guerre des grecs contre l’empire perse, au début du Vè siècle – qu’en occident tout au moins, le genre de récit apparu sous la plume d’Hérodote a pris le nom d’« histoire » au sens où nous l’entendons encore aujourd’hui… »
Et l’auteur de citer Thucydide et Homère dans la même perspective. Le journalisme, et singulièrement le reportage appartiennent à cette histoire de l’histoire. Les enseignements en sont bien connus : pour qu’un récit soit crédible, il faut voyager, regarder, vérifier. Juste un dernier mot que l’on doit à un inconnu du nom de Lucien de Samosate. Dans « l’Histoire véritable », un ouvrage truculent, il affirme que tous ces grands noms, conteurs de guerre, sont autant de menteurs et tricheurs, et donc que nul n’est innocent en matière de vérité. Voilà, pour le reportage en soi
On cherchera en vain hélas quelque apport féminin venu de cette période. Mais avec le temps…

Naissance de la presse : Un monde d’hommes

Presque deux mille ans plus tard, voici le journalisme triomphant.
Fin XIXè, début XXè, une industrie de l’information de masse vrombit au rythme des rotatives. A eux 4 ou 5, les grands quotidiens nationaux tirent à des millions d’exemplaires. Les feuilletons attirent le lecteur qui est passé par les bancs de l’école obligatoire depuis 1882.
Les « publicistes » ou « nouvellistes » comme on disait alors, sont en écrasante majorité des hommes. Avec les feuilletons, Ils font aussi bouillir la grande marmite des ventes par d’horribles récits de crimes, catastrophes, et autres faits divers. Ces « petits reporters », sont les habitués d’autres milieux essentiellement masculins, les bistrots, bas-fonds, hôtels borgnes, commissariats ou prétoires.
Le mot « reporter » qui les désigne a fait son entrée dans les grands dictionnaires en 1875-1879, non sans souligner l’origine anglaise de l’appellation. Le « grand reportage » lui, naît véritablement avec précisément, la guerre. Encore une affaire d’hommes.
Les occasions ne manquent pas : les conflits de Crimée, La guerre franco-prussienne, ou turco-russe… Dans son livre « les journalistes en France, 1880- 1950″ , Christian Delporte écrit : «mêlé directement au conflit qu’il décrit, le journaliste risque sa vie et se transforme en héros ».
L’information côtoie l’aventure. On parlera même de « reporterisme », sous la plume de Pierre Giffard avec son « Sieur de Va-Partout, Souvenirs d’un reporter en 1880″. C’est un « Sieur », il ne viendrait à l’idée de personne qu’il puisse être aussi « Dame de Va Partout». Et pourtant…

Femmes journalistes, de haute lutte
Pourtant elle va tenter d’infiltrer ce monde de la presse en pleine effervescence.
Car une autre effervescence secoue nombre de pays, le féminisme. A titre d’exemple, un premier pas est tenté entre autres par la formation. La première école de journalisme en France a bien été créée en 1900 par une femme, Jeanne Weill. Son pseudonyme était Dick May, consonance masculine, sonorité anglaise, de quoi se garantir un certain laisser passer en ce territoire hostile. Dreyfusarde, très proche du courant sociologique, et du socialisme, La fondatrice de l’École Supérieure de Journalisme va subir les pires railleries. Machisme et antisémitisme associés.
« Le métier ne s’apprend pas, il est affaire d’un talent inné », chantent en chœur les opposants qui se recrutent chez Barrès ou Drumond.
L’école n’y survivra pas. Soit. Mais le courant féministe a ses militantes, il inspire des femmes combattantes, intrépides. Évoquons quelques-unes de ces pionnières, qui le méritent bien.
Madame Durand avec son journal La Fronde fait pour des femmes, avec des femmes, et rien que des femmes, en sera le flamboyant oriflamme.
Et la reporter Séverine le plus ardent des reporters. Ses textes pour défendre le droit à l’avortement sont étonnants de modernité. Autre figure, Marcelle Tynaire qui écrit dans le Petit Journal. En pleine guerre mondiale, elle marquera par ses conférences sur la femme française en Italie, en Angleterre…
Mais il y a aussi ses écrits dans la revue pétainiste Voix Françaises… Et que dire de Titaÿna ? L’intransigeant, Le Petit Parisien feront connaître ses exploits. Pilote d’avion, globe-trotter, Titaÿna s’enivre de son amour du risque. Elle basculera du côté sombre de la guerre, celui de la collaboration.
L’immense écrivaine Colette est également du nombre de ces femmes engagées dans l’écriture de terrain. Elle se cachera souvent derrière des pseudonymes. Le Journal, ou Le Matin sont ses employeurs. Pendant la grande guerre, elle est à Verdun, et rédige des articles sur l’état de la Bataille.
D’ailleurs, elle précise :« LA journaliste écrit-elle, est généralement un reporter, un moins bon chroniqueur, un critique un peu myope, un excellent directeur de rubrique.».
Pas de doute, elles sont résolues à forcer les portes par tous les moyens. La reporter Simone Téry ira jusqu’à la grève de la faim, un séjour en asile psychiatrique pour défendre ses écrits. Elle incarne la jonction entre féminisme et grand reportage.
En 1929, elle constate : « Il n’y a pas bien longtemps en France que les femmes ont pris d’assaut la forteresse escarpée de la presse… ». Il est vrai que la jeune femme a de qui tenir…

Sa mère se nommait Andrée Viollis. En 14-18, elle était infirmière ET journaliste.
Le Petit parisien la fait connaître en publiant « ses impressions de guerre». Puis, la voilà en Irlande en pleine guerre civile. Ce sera ensuite l’URSS, l’Afghanistan, l’Inde, le conflit sino-japonais… Elle, qui fit un portrait d’Albert Londres pour lui attribuer le titre de Prince des reporters, fut en réalité son égal. Et sa notoriété de l’époque parfois même plus importante.
Londres lui rendit la pareille avec un papier admiratif. Dans les nouvelles littéraires, il reconnait : « Parmi les malandrins que nous sommes, une femme, un jour demanda place. Nous la rencontrâmes dans le train. A la frontière, elle défendit victorieusement ses droits de reporter. Elle devait avoir trop d’argent dans son sac et pas assez de visas sur son passeport. Elle s’appelait Andrée Viollis et les jours où la bascule était généreuse, elle pouvait peser 47 kg. Du fait que cette femme voyageait sans malle et sans carton à chapeaux, nous comprîmes tout de suite qu’elle avait la vocation. »Derrière le salut se cache encore une vision très masculine. La consœur semble estimable parce qu’elle ressemble aussi furieusement à un homme.

Un péril commun la censure

Mais qu’ils soient reportrices ou reporters, tous font face à un péril commun : la censure, le bourrage de crâne.
Avec son festival de grands espaces blancs dans les colonnes des journaux ou des trop plein de mensonges. Difficile de se déplacer, de vérifier quoi que ce soit, la propagande vendait ses fariboles. Les reporters, enfin certains, un temps obéissant, firent entendre leur désaccord. Les poilus aussi, qui étaient écœurés par les mensonges des grands journaux. Ils ont publié leurs propres quotidiens avec leurs textes et leurs photos.
La mort omniprésente sur le champ de bataille, s’afficha bientôt de façon particulièrement spectaculaire dans les magazines comme Le Miroir, J’ai Vu, Sur Le Vif, l’Illustration. Ils bravèrent les interdits. On payait cher pour le cliché hors-norme du massacre.
Une mission de la presse fut mise en place. Elle était composée de reporters , exclusivement des hommes, des « embeded », qui accompagnaient l’armée mais surtout que l’armée accompagnait au plus près. Albert Londres qui en fit partie, en sera exclu. Une « mauvaise tête » ont dit les gradés. Alors il est allé « voir ailleurs » dans les Dardanelles, Grèce, Turquie.
Le conflit s’y enlisait, Londres est revenu en France en juillet 1917, et au début d’un article pour le Petit Journal, il écrivit : « Aussi que ceux qui n’aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre parce qu’il leur est trop familier ou qu’ils en sont trop loin, viennent avec moi. Je vous emmène, suivez le nouveau débarqué : nous allons voir ».
Voir, encore et toujours, exigence du reportage plus forte que l’interdit. Condition de vérité du récit de guerre comme aux antiques débuts. Au sortir du conflit, la presse connut une défiance d’importance. Et l’on parla de déontologie et d’éthique pour tenter de rétablir un peu de lien avec le public. Une charte vit le jour. Pour « un journaliste digne de ce nom » sont ses premiers mots, ils viennent d’une guerre. Valables pour les hommes comme pour les femmes.
Seconde guerre mondiale : les reportrices intrépides

Qu’on nous permette ce bond dans le temps. Avant d’évoquer notre période actuelle, comment ne pas adresser ce salut aux formidables reportrices de guerre du second conflit mondial.
Pour ne prendre que les grands noms étrangers, pour l’image comme pour l’écrit, les Gerda Taro, Margaret Bourke – White, Clare Hollingworth ou encore Martha Gellhorn et son fameux « J’ai vu les bombardiers arriver, et larguer leurs livraisons… J’ai entendu les explosions et j’ai applaudi comme tous les autres imbéciles ».
Toutes furent grandes reportrices, lucides sur ce métier du journalisme… qui restait encore principalement celui des hommes.
Le reportage entravé

L’image est verte, vision nocturne, des points tillés blancs traversent les écrans. Un peu plus tard, cette fois le spectacle est en noir et blanc. C’est un viseur, une croix semble désigner une cible. Un nuage apparaît soudain. On a compris. Un bombardement par avion vient de toucher droit au but.
De longues colonnes de fumée noire ont jeté le désert dans l’obscurité. On aperçoit la puissante flamme de puits de pétrole. Début 1991, l’opération « Desert Storm » est lancée par les États-Unis et ses alliés contre Saddam Hussein qui vient de tenter d’envahir le Koweit. Et ces quelques séquences résument à peu de choses près une guerre encore fraîche dans les mémoires. Une sorte de triste jeu vidéo, diront les abondantes critiques.
Une journaliste de télévision, Martine Laroche Joubert est à Bagdad. La direction lui donne l’ordre de rentrer. Elle en concevra longtemps un souvenir amer… Les hommes envoyés sur le terrain constituèrent l’essentiel des troupes journalistiques. Mais les quelques femmes présentes ouvraient la voie aux reportrices en zone dangereuse.
Un vrai changement. De fait, c’est le reportage lui-même qui était à nouveau menacé. Au fil des jours, malgré les coups de gueule des reporters, ce conflit ne laissait quasiment rien voir des combats. A nouveau « embeded » avec les armées en présence, les journalistes travaillaient sous la coupe de la « com » américaine. On en était réduit à indiquer à l’antenne par qui et comment les images étaient visées, filtrées. Mentions indispensables dans ce vide organisé de l‘information. L’essentiel du grand show se jouait en studio, avec cartes et spécialistes militaires à la retraite. L’information sur cette guerre aura été à l’unisson du grand mensonge qui l’avait déclenchée.
Le reportage retrouvé

Avec les affrontements en Ukraine, pour les chaines d’info en continu, le dispositif est globalement le même. Mais là s’arrête la comparaison. En réalité tout est différent.
Et d’abord, il y a bien sûr la nature même de la guerre : la résistance de tout un peuple face à l’agression du voisin russe. Certes, sur les plateaux, les gradés sont fidèles au poste, mais leur parole n’a plus l’exclusivité des explications. Ils sont confrontés à d’autres experts, justement des journalistes de terrain connaisseurs d’un conflit qui hélas, ne date pas d’hier : la guerre du Dombass et son démarrage en 2014. Et puis surtout, il y a l’image. Contrairement à ce qu’il se passait 20 ans auparavant, elle montre les destructions, les horreurs. La mort massive occupe les écrans. Et ce sont les reporters qui font ce travail de témoignage. Principalement des reportrices.
Femmes journalistes aux avant-postes

L’histoire l’a montré. La lutte féministe a permis aux femmes de commencer à progresser dans l’accès aux métiers jusque là réservés aux hommes. Et le journalisme n’y a pas échappé. En la matière, même si cette ascension ne date pas d’aujourd’hui, le regain actuel du combat des femmes a accéléré le processus. Presse écrite, radio, télé, les reportrices sont bel et bien aux avant-postes de la guerre en Ukraine.
Des récits au plus près des populations, en forme de portrait de famille, mais aussi au plus près des combats, à l’écoute du moral des troupes, tentative d’en savoir un peu plus.
Des femmes sont sous casque lourd et gilets pare-balles, la mention « Presse » barrant leur torse. Comme on dit à présent, elles et ils documentent. Femmes de terrain à l’unisson de leurs collègues hommes, à moins que ce ne soit le contraire. Fait unique dans un conflit, on instruit pendant les combats, les crimes de toute nature, assassinats, viols, enlèvements. Aspirations à la justice. Ces scènes ne sont pas sans rappeler les terrifiantes atrocités de l’ex-Yougoslavie qui vit un tribunal pénal international agir. Une guerre de siège qui fut couverte par des grands reporters exposés au danger des sniper, des hommes, quelques femmes, de la française Mémona Hinterman à l’américaine Christiane Amanpour pour ne parler que de la télé.
Le reportage est un combat permanent
Mais en Ukraine aussi, l’exercice journalistique a ses limites.
Le front demeure inaccessible. Ici également, on est peu ou prou embeded, en tout cas « autorisé » ou pas à suivre tels ou tels soldats, ou escouades.
Côté russe, la messe est dite. Mais les reporters tentent de rendre compte de cette réalité-là . C’est leur devoir. Ils parviennent parfois à se faufiler entre les mailles de la propagande, du contrôle.
L’unique contre-exemple d’une guerre offerte au regard le plus large, le plus proche, le plus cruel, fut celle du Vietnam. Le documentaire « La section Anderson » constitue la référence du genre. Comme des icônes de la guerre, GI’s à la dérive, combats contre un ennemi invisible. Et par-delà, les violences extrêmes infligées aux femmes, aux enfants… Napalm, colère mondiale, les images de terrain eurent de lourdes conséquences politiques.

Autre différence notoire, les journalistes s’installent dans la durée en Ukraine.
Mission longue, on connait mieux le terrain, les personnes, le danger. Et l’on ne renvoie plus forcément les femmes à « leurs conditions physiques fragiles ou leur qualité de mère de famille », pour entraver leur pratique.
Fait absolument remarquable, à côté des professionnels de l’info, qu’ils soient ukrainiens ou venus d’autres pays, il y a cette multitude de vidéos qui montre la guerre. Qui les tourne ?
Y-a-t-il des femmes vidéastes qui tournent les images de la plateforme Telegram grande pourvoyeuse de vidéos ? Une sorte de classement de confiance s’est d’ailleurs plus ou moins mis en place du côté des grands médias. Un peu comme à l’époque de ces vidéastes syriens devenus citoyens journalistes, témoins cruciaux de la barbarie des troupes de Bachar. Dans le grand affrontement des images, la vérification chère à l’ancêtre Thucydide est plus que jamais indispensable.
Le reportage et l’épreuve de vérité de la guerre

Reportrices ou reporters, sont donc plus que jamais au centre de ce qu’est fondamentalement la guerre : une épreuve de vérité.
Dans cette épreuve la présence enfin acquise par les femmes est un gage de progrès, d’assurance collective.
Dans son récent livre « Pourquoi la guerre ? » le philosophe François Gros apporte sa vision. Il rappelle l’injonction radicale que provoque le conflit. Il faut choisir, se déterminer. Voilà qui accroit singulièrement l’importance de la fonction du journalisme de terrain. Car savoir ce qu’il se passe, permet aux citoyens de mieux comprendre les raisons de leur choix.
Une citation souvent rabâchée, vient ruiner tous les espoirs de clarté dans la confusion des affrontements. « La première victime de la guerre, c’est la vérité »
Elle n’est ni de Kipling ou de Churchill. En fait, elle est signée Philip Snowden, en introduction d’un ouvrage intitulé « Guerre et vérité » paru en 1916.
Snowden qui fut le premier Chancelier de l’Echiquier travailliste, autrement dit ministre des Finances ajoute: « Ignorer les faits, ne pas vouloir entendre la vérité, cela devient un péché, pour lequel la pénalité devra certainement être payée tôt ou tard… »
Il parle avec les mots de son temps. Mais on peut en tirer la conclusion qui s’impose. En donnant à voir, lire et entendre, le reportage et les reportrices enfin retrouvés, aident les démocraties à franchir l’épreuve de vérité que constitue la guerre.
Courte pause pour le Cahier de Tendances
Difficile, très difficile, de percevoir dans le bruit actuel, des signaux du monde des médias et du journalisme d’après Covid. Chacun voit évidemment l’effondrement de la publicité qui ne parvient plus à rémunérer les rédactions et les journaux, qui, sachant déjà leur modèle d’affaires non viable à moyen et long terme, découvrent effarés, qu’il ne l’est désormais plus à court terme non plus. Chacun voit bien aussi se renforcer les logiques de domination des plateformes renforcées par la crise, et de plus en plus de médias vouloir retrouver leur indépendance numérique.
Mais il est trop tôt, nous semble-t-il, pour dire quelque chose d’utile et de perspicace, qui risque dans la tourmente d’être dépassé en quelques semaines; et de plus en plus difficile de donner un sens aux infos contradictoires qui déferlent. Avec l’équipe Méta-média, nous avons donc décidé de continuer à observer de près et à décortiquer la mutation tout en faisant une pause dans la publication de notre Cahier semestriel de Tendances.
Et côté télévision, de finalement nous référer à ce que nous disions, il y a juste cinq ans, en présentant 10 enjeux de transformation qui n’ont pas beaucoup vieilli !
1Les jeunes ne reviendront pas
2Le mobile est devenu le 1er écran
3TV à la demande et personnalisée
4Les nouveaux formats de l’info
5Fiction, séries, magazines, jeux, sports : des millions de nouveaux concurrents
6Business model à réinventer dans un marché en croissance mais instable
7Une mondialisation inévitable
8Les données, oui, mais aussi la confiance
9L’innovation, facteur clé de succès
10L’immersion est le nouvel engagement
En résumé, écrivions nous, « Confrontée donc à la plus grande transformation de son histoire, la TV bascule –-et pourrait bien se dissoudre– dans l’Internet vidéo mondial qui explose et est en train de l’absorber », avions nous prévenu en 2015.
« Des plaques tectoniques bouleversent le paysage et modifient les frontières de ce qu’on appelait jusqu’ici la télévision, redéfinie désormais par la manière dont on la regarde.
Du PAF au PAP, le paysage audiovisuel personnalisé. La télévision devient une expérience personnelle sur écrans individuels où les attentes, en matière de découverte, d’accès et d’expérience se transforment aujourd’hui très vite. »
Ce sont toujours nos défis !
Journalisme : révolte dans les rédactions et tentation de l’activisme #BLM
L’évènement #BlackLivesMatter est en train de tout dominer dans les rédactions en Amérique et rapidement en Europe. Sous la pression des jeunes générations, l’incandescence du mouvement social #BLM y fait émerger actuellement une tentation, voire une revendication d’activisme, qui dépasse désormais les frontières des Etats-Unis.
Là-bas, le débat fait rage depuis la publication en fin de semaine dernière par le New York Times d’un op-ed d’un sénateur républicain appelant à la fermeté absolue contre les manifestants. La rédaction s’est révoltée, le responsable des pages édito a démissionné. D’autres titres US ont fait partir des cadres dirigeants. Le Washington Post se pose des questions.
 (Reddit pics)
(Reddit pics)
La traînée de poudre a immédiatement gagné le Canada. En quelques jours chez eux, la colère des journalistes afro-américains, amérindiens, autochhtones, d’origine asiatique a éclaté pour réclamer une modification des normes et pratiques journalistiques, notamment dans les médias anglophones.
« Ils veulent casser la baraque », nous disait cette semaine une dirigeante de l’info d’un grand groupe de médias.
Car il ne s’agit pas seulement, pour les journalistes des minorités de s’exprimer davantage ou d’avoir plus de visibilité dans les rédactions trop peu inclusives, mais bien de favoriser une couverture activiste et engagée contre l’immoralité. Certains journalistes et animateurs n’hésitent plus à « vider leur sac à l’antenne » des radios ou des télés. Les journalistes posent un genou à terre sur les réseaux sociaux.
 (Reddit pics)
(Reddit pics)
Les responsables éditoriaux essaient de comprendre, tentent de lutter contre cette tentation de l’engagement et de changement des règles déontologiques, voire de risque de marginalisation si des prises de position sont prises. Mais tout le monde n’est pas sur cette ligne.
La pdg de CBC/Radio Canada, Catherine Tait, s’est engagée par exemple à ce que 50% des nouvelles recrues de la rédactions de l’audiovisuel public canadien viennent désormais des minorités.
Les directives en matière de vocabulaire éditorial y changent aussi (au moins en anglais) :

« Au lieu de faire comme d’habitude, les journalistes doivent mettre de côté leur longue histoire d’amour avec l’objectivité et apprendre à se situer par rapport à leur histoire sociale, leurs relations et leurs obligations. Les journalistes doivent reconnaître que ce qu’ils pensent être un fait est profondément lié à qui ils sont et d’où ils viennent au sens large et spécifique du terme.
En outre, les journalistes doivent employer ce que nous appelons un journalisme systémique qui couvre les événements et les questions non pas comme des événements ponctuels, mais comme des intersections de systèmes et de structures sociétales qui ont une histoire. Cela signifie qu’ils doivent enquêter sur des histoires que beaucoup n’ont pas apprises et ne connaissent pas. », écrivent cette semaine deux professeurs émérites de journalisme au Canada.
Vous l’avez compris, il n’est donc plus question pour les insurgés de présenter « de manière neutre », pire « objective », des faits ou des points de vue opposés, mais bien de prendre position au nom de la morale. L’éditorialisation des reportages n’est pas loin. Aux Etats-Unis, la polarisation de la société, déjà très marquée par l’opposition idéologique des grandes chaînes d’infos, se renforce.
Les jeunes, qui nous reprochent, souvent avec raison, notre mollesse sur les grands sujets de l’époque (climat, racisme, inégalités sociale, genres, …) et nos ratages sur tout ce qui n’est pas « mainstream », sont à la manœuvre. Y compris désormais sur TikTok. Tout simplement car ils sont bien plus confrontés 24/7 dans les réseaux sociaux à l’âpreté des débats. Et Ils n’ont pas tort non plus de nous rappeler que dans les années 30 les grands correspondants de la presse internationale installée à Berlin n’ont pas su alerter le monde.

(Reddit pics)
La tension semble gagner l’Europe.
Des prises de positions inhabituelles de journalistes européens, notamment en Belgique, se multiplient sur les réseaux sociaux (genou à terre, etc…) qui s’enflamment.
Les pays où se fait entendre « la colère » de nos consœurs et confrères connaissent tous d’ailleurs avec grande acuité, une question communautaire de longue date. Tous connaissent historiquement des lignes de fracture, d’opposition, de tensions entre les groupes qui les constituent institutionnellement, linguistiquement, culturellement. La tragédie George Floyd a exacerbé chez eux ces tiraillements qui pour certains (Canada, Belgique) sont en capacité de remettre en cause l’unité des pays concernés.
« Nous passons décidément de crise en crise, avec sans cesse une montée en puissance dans leur intensité. Ce qui est remarquable, c’est peut-être leur caractère global, planétaire, du dérèglement climatique, au mouvement Metoo, et actuellement BLM. A chaque fois, ou presque, l’incarnation est remarquable : Greta Thunberg, les différentes femmes victimes avec Adel Haenel, et George Floyd. L’image jouant également un rôle crucial, avec le logo qui va bien pour les réseaux sociaux », note Hervé Brusini, journaliste, ancien rédacteur en chef du 20H00 de France Télévisions et prix Albert Londres.
« Sur le fond. Les revendications de ces journalistes-révoltés peuvent apparaître alarmantes au premier regard. Elles peuvent sembler balayer les devoirs qui sont les nôtres, non pas d’objectivité mais de vision pluraliste de l’information. A titre d’exemple, une présentation qui tienne compte de la diversité des points de vue. Cette exigence de diversité, n’est d’ailleurs pas encore satisfaisante dans nos rédactions. Tant dans les recrues, visibles ou pas, que dans les contenus où un mainstream de la pensée laisse sur le côté nombre de nos concitoyens qui ont même trouvé un nom au fil des années, on les appelle les invisibles », estime Brusini.
« Le fameux problème de la représentation en démocratie touche à présent donc jusqu’au paroxysme les médias, l’information. Nos avancées sont par trop lentes. De fait, la question est complexe. Depuis les réunions avec Hervé Bourges, les choses ont réellement évolué mais il reste encore tant à faire. Il faut y aller maintenant massivement, fortement, c’est une carte évidente pour le service public », ajoute-t-il.
Faudra-t-il livrer bataille ?
Les enjeux sont donc bien de plus en plus importants pour les journalistes, souvent discrédités et qui doivent faire face désormais à des critiques en temps réel et à un feedback permanent de l’audience pour leur éthique, leurs reportages et leur pertinence.
« Le monde vit avec la parole de l’homme le plus puissant de cette planète qui chaque jour nie la réalité des faits. Les journalistes sont devenus pour des dizaines de millions d’Américains les fake news. La simple ambition d’avoir, de garder les pieds sur terre se renverse un peu plus chaque jour. La violence est là. Le journalisme doit justifier chaque jour son existence. Que l’on se mette à la place de ceux qui se sentent niés, sans existence aucune face à cette lutte où le réel est une dimension quasi évanescente. Que fait un afro-américain sur une terre plate, avec des journalistes qui s’évertuent à prouver que la terre est ronde? Il a envie de tout faire exploser, il peut vouloir lui aussi balayer ces discours qui lui semblent vains, de part et d’autre. Le moment et en ce sens éminemment périlleux.
 (Reddit pics)
(Reddit pics)
« Le journalisme est engagé dans la bataille du réel. De sa compréhension, de son questionnement. Alors il s’interroge sur sa mutation. Que faire face à cette négation permanente ? L’immoralité fondamentale est de nier les faits qui sont la raison d’être du journalisme. Lui aussi veut respirer. Alors peut-être faudra-t-il directement livrer bataille. Faire entendre les points de vue, mais aussi choisir. Ce qui est particulièrement dangereux. La seule réponse est de renouer avec nos fondamentaux de rigueur, d’interpellation, de pluralisme, mais guidé par un choix. Un choix de valeurs déontologiques affirmés comme le blason de l’indispensable indignation. Le choix du service public au plein sens du terme, aux ordres d’aucune idéologie, d’aucune puissance, si ce n’est celle de son rapport honnête, claire avec le public », ajoute Brusini.
L’heure est-elle donc à un journalisme d’impact, plus engagé ?
Vous en pensez quoi ?
ES
La peur, l’urgence, et l’information
Par Alain Wieder (journaliste, ancien redchef France2 & Capa) et Hervé Brusini (journaliste, ancien redchef France Télévisions, prix Albert Londres)
On parle souvent de l’accélération des événements. Il en va de même pour les paradoxes.
Il y a un mois, qui aurait imaginé assister au consentement collectif de tout un peuple – en l’occurrence, le français – à rester cloîtré, enfermé -confiné est le terme adéquat- chez soi ?
Qui aurait pu croire, que sur injonction, chaque citoyen prendrait soin d’éditer, remplir, signer un formulaire lui donnant la capacité de quitter son assignation à résidence ?
Qui aurait prévu que la poignée de mains, l’embrassade n’auraient plus cours dans la quotidienneté des échanges sur recommandation des pouvoirs publics ?
Qui aurait songé entendre un ministre de l’Intérieur lancer au plus grand nombre : « On ne part pas en vacances de Pâques » ?
Qui aurait pu songer que les familles se seraient soumises à des funérailles sans témoins, sans effusion ?
Quelle clairvoyance aurait conçu la possibilité d’une pareille discipline consentie, allant jusqu’au plus intime ?
Même si cela ne fut pas immédiatement le cas, tel est pourtant bien ce que nous vivons à présent. Le vide, et le silence de nos rues en témoignent.
Or, c’est bien ce même peuple, et l’idée est acquise depuis longtemps, qui considère avec une défiance toujours confirmée, les politiques comme les élites. Ce constat constitue d’ailleurs une antienne des analyses politiques de notre société. Régulièrement, les sondages le vérifient. Et donc malgré cette distance -sans jeu de mots-, cette suspicion, voire cette colère à l’endroit de ceux d’en haut, de la capitale, des privilégiés, des sachants, citoyennes et citoyens se sont peu ou prou conformés aux règles tout nouvellement édictées, et cela massivement.
Mais par quel mystère ?
De toute évidence, parce qu’ils ont cru ce qu’on leur disait. A savoir, une alerte, une urgence sanitaire, décrétée pour cause de virus potentiellement tueur.
Le doute qui taraude, a alors subi comme une pause pour laisser la place à une « sorte de confiance ». Un crédit, soudainement, presque brutalement, retrouvé qui s’explique par la force des choses, cette peur que ressent tout un chacun face à « l’ennemi invisible ». Une peur d’autant plus puissante que notre société moderne si prompte à l’habitude pour résoudre les difficultés les plus complexes, semble ici sans réponse immédiate. Sans remède, serait-on tenté d’ajouter.
Dès lors, gestes barrière, distanciation sociale, confinement, la check list du tout faire pour éviter de transmettre ou d’attraper la maladie s’est mise en place, intégrée au quotidien. L’angoisse provoquée par la survenue, qui plus est mondiale d’un virus et de son cortège de morts, a su faire cela.
Vérité et confiance restaurées ?
Réminiscence de la vieille grippe espagnole ? En tout cas, c’est de l’inédit, du paradoxalement inédit. Car la vérité tant décriée, mise à bas, assassinée ici et là, déclarée post-mortem, vient d’être restaurée en quelques jours. Une « sorte de vérité » accompagne une « sorte de confiance ».
Certes, les réseaux sociaux fourmillent de désinformations, et autres fausses nouvelles en tous genres. Bien sûr, il y a toujours la tentation nauséeuse de faire du Covid-19 une arme concoctée par quelques puissances de l’ombre. Les conflits du moment, l’antisémitisme, nourrissent comme à l’habitude les théories du complot qui traversent la grande conversation numérique. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Évidemment il y a ces sondages qui persistent à mesurer les chiffres en berne de la crédibilité des uns et des autres. Mais il n’en reste pas moins que « les gens » sont bel et bien chez eux, confinés. Comme il se doit. Tout ouïe, les yeux grands ouverts devant leurs écrans à la recherche, osons-le, de la valeur information en pleine « redécouverte ».
Jamais nous n’avons vu aussi longuement et autant, ces hommes et femmes en blouses blanches, médecins, personnalités scientifiques, répondre aux interrogations les plus diverses, élémentaires ou complexes. Allez, dites-nous… Dois-je craindre la durée de vie du virus sur les surfaces comme le carton, et l’arrivée imminente de la « vague » ?… Chacun contribue, apprécie, explique, tranche… Désormais, les sachants, une partie de l’élite, hier agonie, parlent et même se confrontent sur un vaccin ou des tests. Jusqu’à évoquer l’issue même de « cette crise » : Quid de l’économie ? de la marche du monde ?
La demande confiante de vérité déborde, précipite comme une solution chimique stupéfiante. Récemment Interrogé par France Inter Frédéric Worms évoquait « des temps de vérité en construction ». Autrement dit, la vérité est bien là, mais en cours d’élaboration, en temps réel, au vu et au su de tout le monde, et dans la diversité des registres concernés. Demi-vérité comprise. Et même parfois plus grave.
La science, sa pédagogie et ses discussions occupent puissamment l’espace. A ses côtés, la politique envieuse du crédit ravivé des sociétés savantes.
Car la chose publique est aussi, plus que jamais convoquée à la barre de la crédibilité. Après tout ce sont les gouvernants qui décident. Alors, la puissance publique réagit comme elle le peut. Prises de parole répétées pour les uns, plus ciblées pour le sommet de l’État depuis l’Élysée, ou à proximité d’une tente militaire. En toile de fond, voici qu’on évoque les questions de masques et de tests.
« Transparence, confiance », répond Édouard Philippe dans sa ‘conférence de presse’ du 28 mars dernier. Un dispositif de vérité s’est ainsi exposé en construction à la télé. Les codes sont connus. Il faut un studio. Un décor est dressé au sein même de l’Hôtel Matignon. C’est ainsi, une antenne qui va tenir un discours doit avoir les accessoires indispensables : une paroi pour assurer un fond blanc, deux drapeaux français et européen. Deux pupitres, deux écrans pour projeter l’infographie nécessaire à l’examen du sujet. Des intervenants experts et ministre. La science et la politique mises en avant. Avec un Premier ministre, à la fois passeur de parole et pôle d’une autorité inflexible.
Hors champ, se tient le journaliste. Puisqu’il est l’information, troisième élément du dispositif, il appartient à l’AFP et va, dit-il « tâcher d’être le relais le plus scrupuleux des questions de ces consœurs et confrères ».
La télé revient
Précisément, le média télé qui est son support est lui aussi « retrouvé » en la circonstance. Le public est nombreux devant les sessions d’info qui se vivent justement à son service, avec ce fil conducteur qui s’impose, une conversation sous forme de questions/réponses, réelle interactivité antenne/numérique. Plus que jamais une logique de service public est requise. D’ailleurs, force est de constater que la « conversation » virtuelle se banalise à très grande vitesse avec l’usage des écrans petits ou grands.
Apéro live, lecture partagée, recette de cuisine en temps réel, ou plus gravement consultation en mode télémédecine, le virus aura aidé comme jamais à la numérisation de la population. Et les laissés pour compte de ce nouvel espace de « rencontre » n’en sont que plus amers. Il leur reste, comme on l’a dit, les journaux télé. Plus longs, ces derniers racontent des morceaux de réalité grâce au reportage revigoré. Livreurs, caissières, personnes âgées et, toutes celles et ceux du monde de la santé sont autant de sujets de récits. L’incarnation n’est pas seulement celle du journaliste équipé de son micro désormais protégé, elle est celle de toute cette population qui il y a peu encore était invisible.
L’image aussi
Une incarnation par les corps des victimes, des soignants, des aidants. L’image est réinvestie par une force qu’on ne lui connaissait plus au quotidien. Des reporters deviennent la Chine, l’Italie… Comme toujours, lors des grandes catastrophes ou des conflits lointains ou au coin de la rue, tous ces chocs évocateurs de vie et de mort, le journalisme renoue avec sa fonction d’aller y voir, de décrire.
D’abord savoir ce qu’il se passe. Il explique aussi, se fait l’interprète des préoccupations des uns et des autres, il questionne, enquête. Et cela vaut – quand les circonstances le leur permettent- pour tous les arts de faire : presse, radio, web, tout le monde est sur le pont. Car l’inquiétude est la plus forte. Et avec elle la volonté de savoir…via les médias.
Via une « sorte de confiance », pour une « sorte de vérité » à nouveau partagée. Mais l’adhésion pleine et entière à cette même « sorte de vérité » reste problématique.
Étrange, redoutable et précieux moment que celui de ces retrouvailles. Ce moment de « l’urgence » a été finement analysé par Alessandro Baricco dans un de ces récents entretiens filmés par le journal La Repubblica. Et l’on voit que cette réflexion venue d’un pays qui paye actuellement un lourd tribut au Coronavirus 19, n’est pas sans écho pour la France.
« Cette urgence, c’est un moment où se recompose une alliance entre politiques, experts et médias. Face au niveau élevé du danger, le public n’ose plus avec la même intensité, l’individualisme de masse, propre au numérique… Cela pourrait pousser les démocraties à se mettre en état d’urgence quasi permanent », prévient l’auteur de The Game.
Et là pour le coup, on ne pourra pas dire que l’on ne savait pas, que l’on n’ a pas vu les signes avant-coureurs du mal qui pourrait s’annoncer.
A. Wieder et H. Brusini
COVID-19 : coopération inédite des rédactions de l’audiovisuel public européen et canadien
Le groupe audiovisuel Radio Canada a rejoint cette semaine la task force européenne de l’UER* créée pour armer davantage les rédactions des audiovisuels publics dans leur mission de diffusion d’une information équilibrée et précise sur une urgence de santé publique qui se développe rapidement.
Mis en place fin janvier à l’initiative de France Télévisions pour suivre la situation en Asie et le début de la propagation du coronavirus en Europe, un groupe de messagerie permet depuis à une vingtaine de rédactions européennes (dont celles de la BBC, France Télévisions, RAI, RTBF, France24, RTVE en Espagne, ZDF/ARD en Allemagne, RTE en Irlande, TV baltes, nordiques, etc…) d’échanger tout au long de la journée sur les breaking news, les déploiements, les protocoles de sécurité des équipes, les sujets d’intérêt, les échanges d’images, les exclusivités, et de s’entre-aider pour lutter contre la désinformation.
Les angles et plans de couverture sont échangés dans un univers non concurrentiel où sont déjà partagés les images d’actualité broadcast (Eurovision). Aujourd’hui, près d’une centaine de responsables éditoriaux peuvent aussi y demander des vérifications aux autres membres éloignés et partager des articles et analyses intéressants du monde entier.
« En temps de crise nationale ou internationale, le public se tourne par millions vers les médias de service public, à la télévision, à la radio et en ligne. Lorsqu’il s’agit de santé publique, le public veut une source d’information fiable et digne de confiance. Et l’épidémie de coronavirus montre que les journalistes de ces organisations vont plus loin que jamais pour obtenir les meilleures infos le plus rapidement possible », a souligné Liz Corbin, directrice de l’information de l’UER.
Le défi consiste aussi pour les participants à relier différents silos pour aider le public à comprendre le flot d’informations (mais aussi de fake news) : couverture locale et sociétale, contexte politique et économique, couverture scientifique, etc…
Une animation graphique, produite à Genève par l’UER, est également actualisée régulièrement sur les cas signalés sur le vieux continent et mise à disposition des membres.
Cette initiative coïncide avec des records de trafic sur les sites et offres numériques de nombreux audiovisuels publics européens liés à l’actualité sur le coronavirus, comme à de hauts niveaux d’audience pour les JT, notamment en France.

« Avec un tel sujet, avec un virus qui ne respecte pas les frontières et qui fait courir le risque aux journalistes qui le couvrent de l’attraper et de propager la maladie, le journalisme collaboratif est absolument crucial. L’UER, particulièrement bien placée pour faciliter cette collaboration, a été un point de convergence pour tous ses membres », a ajouté Liz Corbin.
« Les journalistes sont compétitifs par nature, ils veulent des scoops et du matériel exclusif. Mais dans la communauté de l’UER, les journalistes comprennent aussi que plus ils contribuent, plus chacun en profite. Et surtout, le public obtient la meilleure qualité d’information au moment où il en a le plus besoin ».
ES
*L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) est la plus grande alliance de médias de service public (MSP) dans le monde.

Fallait-il aussi disrupter la démocratie ? (#DLD20)
Sale ambiance ce week-end à Munich, lors de la conférence DLD sur l’innovation. En pleine crise mondiale du climat et de concentration abusive des richesses, la communauté numérique internationale, réunie comme chaque année avant Davos, est en train d’admettre ce qu’elle ne voulait pas voir : la tech, qui devait sauver le monde, a aggravé les problèmes. Et personne ne fait rien.
Non seulement, la révolution numérique sert plus à envoyer des photos de cappuccino qu’à lutter contre le réchauffement de la planète; à monopoliser le pouvoir qu’à le partager; mais elle est surtout en train de saboter la démocratie, pilier d’une Europe qui se sent de plus en plus isolée et en retard face à l’Amérique et la Chine.
« Notre présent aux Philippines sera demain votre avenir », a prévenu la journaliste Maria Ressa, journaliste et personnalité de l’année en 2018 du Time. Critique du président philippin Duterte, elle a été arrêtée et emprisonnée plusieurs fois. Aux Philippines, « où Internet c’est Facebook, un mensonge répété un million de fois devient un fait ». « Sans fait, pas de vérité. Et sans vérité pas de confiance ».
Trois autres grands pays ont déjà fait les frais d’un détournement des plateformes Internet, lors d’élections où le populisme l’a emporté grâce à la désinformation : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil. « Pourquoi les employés de Google ou de Facebook ne disent-ils rien? », a demandé Roger McNamee, ancien mentor de Mark Zuckerberg, devenu son principal critique.
Utilitarisme vs. droits de l’homme
Laisser les clés du camion aux ingénieurs et aux experts, qui n’écoutent personne, a donc été une erreur. Car leur système de valeur impose à la société la notion d »efficacité au dessus de tout le reste. Au dessus du libre arbitre. Au dessus des choix individuels. Et au bout, de la démocratie.
Au nom de l‘utilitarisme qui vise à maximiser le bien-être collectif au détriment des individus, la fin a justifié les moyens. Nous avons laissé privilégier l’efficacité sur la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme, nos valeurs, la déontologie, ont été oubliés, dégradés. Il faut vite remettre de l’humain dans la tech, avant que l’intelligence artificielle, summum de l’utilitarisme, ne prenne toutes les décisions pour nous, ont estimé plusieurs universitaires.
Veut-on d’ailleurs aussi vivre dans une économie complètement dominée par quatre firmes ?Google et Facebook ont déjà plus d’utilisateurs qu’il n’y a de croyants dans l’Eglise catholique. Tout le monde sait qu’après les médias, c’est désormais au tour de la finance, de l’automobile et de la médecine d’être visées par les géants du web. Si personne ne fait rien, il leur arrivera la même chose. Ils vont coopérer au début, puis se feront avaler.

« Si on continue comme cela, l’Europe va devenir une colonie numérique des Etats-Unis et de la Chine », a averti le député européen Axel Voss.
« Je pense que la technologie est trop importante pour être laissée aux gens qui en sont aujourd’hui à la tête (…) « Mark Zuckerberg aurait pu être le héros de quelque chose, mais il a choisi une voie différente », a déclaré Roger McNamee.
Quelques pistes pour rendre la démocratie plus résiliente ?
- S’appuyer bien plus sur les valeurs et l’éthique, qui comptent encore en Europe. La protection de la vie privée doit rester un droit de l’homme. Les données personnelles, monopolisées aujourd’hui par 4 firmes, doivent être protégées au même titre, estime McNamee.
- « Interdire l’amplification algorithmique », ajoute-t-il. Il y a 30 ans la haine et le racisme existaient, mais personne ou presque n’amplifiaient les messages. Le modèle d’affaires publicitaire de Google et Facebook entraine les algorithmes à mettre en avant l’émotionnel, le sensationnel, le bidon, et favorise la polarisation de la société. Nous sommes hélas dans un environnement où le mal est optimisé.
- « Ne pas les croire, mais vérifier » et donc contraindre les géants du web à nous laisser regarder sous le capot de leurs algorithmes, exhorte Marietje Schaake, de Stanford et ancienne parlementaire européenne. « Sans cela nous sommes aveugles et la démocratie est en danger ».
- Des dirigeants politiques qui prennent la mesure de la situation. Mais leur expertise numérique reste faible. Ce qui n’est pas le cas du nouveau commissaire européen Thierry Breton venu dire à DLD : « soyez persuadé que nous ferons tout pour ne pas rater la deuxième vague des données. Celle de l’Internet des objet et de l’industrie. L’Europe n’est d’ailleurs pas en retard ».
- Arrêter pendant qu’il est temps ce capitalisme de surveillance, financer de la tech humaniste, faire comprendre comme la tech déforme la société, assurer un design qui tienne compte des vulnérabilités de l’être humain, propose Tristan Harris, l’ex ingénieur de Google, qui estime qu’on ne pourra résoudre la crise climatique que si on prend de vraies mesures pour empêcher la techno de dégrader l’humain.
- « On a pourtant les technologies pour résoudre tout ça, mais on les utilise mal », a estimé, plus soft, le chairman de Siemens, Jim Snabe.
Réponse de Facebook ?
Au bout du compte, « le positif l’emporte sur le négatif (…). Vous ne reconnaissez jamais les progrès que nous faisons », a déploré Nick Clegg, le patron des Affaires publiques, et ex vice-premier ministre britannique, qui assure que 99% des contenus de Daech ou d’Al Queda sont bloqués avant d’atteindre le public avec l’aide de l’IA et de 35.000 modérateurs.
« Attention, si le grand public commence à penser que vous êtes un danger pour la civilisation, vous allez finir par avoir un problème de marque », a prédit Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia.
A Münich, ce week-end, deux interventions (sur plus de 200) ont provoqué des standing ovations: celles de Maria Ressa, qui a fait pleurer nombre de participants, et celle de Roger McNamee.
Deux interventions à charge contre le rôle de Facebook dans le dérèglement de nos démocraties.
ES
Crédit photo : dldconference – flickr