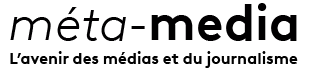Cahier de Tendances Automne-Hiver : À la recherche des humanités numériques – Chroniques d’une insurrection
« Le numérique » n’est pas un tuyau, un simple nouveau canal de diffusion, ou une vulgaire technologie, c’est une insurrection qui, en se passant des médiations, change notre rapport au monde et dessine une nouvelle civilisation.
Sans doute fallait-il un écrivain pour le démontrer.
Car c’est la thèse convaincante du romancier, musicologue et homme de théâtre italien Alessandro Baricco si bien exprimée dans son dernier livre « The Game » paru cet automne chez Gallimard. Nous en faisons une synthèse pour ouvrir notre nouveau Cahier de Tendances Méta-media, et en avons extrait la chronologie des grandes étapes du soulèvement.
Cette cartographie aide à comprendre bien des signaux des transitions désordonnées que nous sommes en train de vivre. A commencer, bien sûr, par celle du monde chahuté des médias et du journalisme où « celui qui gagne n’est pas celui qui crée, mais celui qui distribue ».
Et puisque cette révolution est menée essentiellement en forgeant de nouveaux outils, nous avons cherché à voir comment ils pouvaient nous aider à accéder aux indispensables nouvelles humanités … numériques. Des pistes sont explorées, pour nous, médias : modifier nos systèmes de valeurs, réinventer notre relation avec le public, faire un bon usage de ces nouvelles technologies. Et évidemment renouveler vite nos formats dépassés.
Le meilleur indicateur reste celui de l’évolution des usages. Nous les avons une nouvelle fois épluchés, en France comme à l’étranger, et vous proposons aussi, en forme de guide des années streaming, un petit glossaire inédit pour vous y retrouver.
Mille mercis à nos contributeurs extérieurs, témoins ici ou en Chine, de cette insurrection. Nous aussi sommes fiers d’une édition automne-hiver où sont publiés nettement plus d’articles écrits par des femmes que par des hommes.
Merci à Barbara Chazelle et Laure Delmoly du MédiaLab, pour la coordination de ce beau travail d’édition, et sincère gratitude au fidèle et habile Jean-Christophe Defline qui sait si bien illustrer nos intuitions.
Enfin, vous trouverez, comme toujours, notre sélection de livres recommandés pour la période plus calme des fêtes de fin d’année.
Très bonne lecture et excellente entrée dans les années 20 à toutes et tous !
ES
Comme celle-ci, les précédentes éditions semestrielles sont toutes disponibles gratuitement en pdf dans la colonne de droite de ce blog.
Embeddé dans la manif des retraites
« Monsieur, vos lunettes sont par terre ». Nous sommes Place de la République, jeudi 5 décembre dans l’après-midi, au cœur de la manif parisienne sur les retraites, et le jeune « Black Block » me donne un coup de main sous les lacrymos.
C’est qu’il n’est pas si facile, pour un vieux journaliste de salon, de parvenir, en courant, à lire ses textos pour retrouver l’équipe mobile de France Télévisions, tout en gardant fonctionnel autour du visage son encombrant équipement de protection. D’autant que je sors à peine d’une petite situation compliquée ; isolé, piégé, un court instant, contre une façade d’immeubles par une colonne de CRS qui remonte, caillassée, le boulevard de Magenta.
J’ai perdu le contact avec le reporter, le JRI, et nos deux gardes du corps.

Les caméras de surveillance de la préfecture de police sont incendiées, tout comme une baraque de chantier devant la Bourse du Travail. Des pavés volent, les grenades lacrymogènes s’abattent sur la foule, des affrontements éclatent.
Est-ce donc ainsi qu’on couvre un conflit social au 21ème siècle ? Comment faire son boulot de journaliste dans ces conditions ?
Mon statut ?
Observateur. Un peu comme Benalla à la Contrescarpe ! J’accompagne une des équipes mobiles de la rédaction, assignée de midi à minuit à la manif, qui s’annonce dense.
Reporter : Clément Le Goff, qui interviendra en direct dans le 20H et plus tard dans l’émission politique « Vous avez la parole » ; JRI : Loup Krikorian ; plus deux motards FTV, qui gardent à l’écart notre matériel de transmission, et deux gardes du corps. Nous sommes tous équipés de masques à gaz, lunettes de piscine, casques, bouchons d’oreille et liquide pour les yeux.

Mon objectif ?
Tenter de ressentir le rapport des manifestants et des forces de l’ordre à notre équipe, et voir comment travaillent les médias. « Embeddé » cinq heures avec l’équipe, dans et hors du cortège, mon témoignage est forcément limité, ponctuel, et n’a évidemment pas valeur de généralisation.
Ecouter les manifestants : la colère l’emporte sur les retraites
Nous sommes en tête de cortège, composée surtout de gilets jaunes, de manifestants divers (personnels hospitaliers, étudiants, pompiers, …) et de petits groupes de black block très mobiles. Ça sent parfois la bière, les joints et quelques barbecues improvisés sur les côtés. Bloqué par les black blocs qui veulent en découdre, le cortège prendra des rues secondaires, empêchant le comptage indépendant du cabinet Occurrence.
Très vite nous remarquons, en leur parlant, que le sujet des retraites est, pour ces manifestants, secondaire. Nous ne sommes pas placés, il est vrai, dans les rangs CGT ou Sud. Mais l’essentiel des témoignages évoquent un raz-le-bol, une colère contre une situation générale, une politique, et un homme, le Président de la République.

C’est d’ailleurs le thème de l’émission politique de France2 du soir « Pourquoi tant de colères ? Les Français face au pouvoir », qui sera très regardée. C’est aussi le résultat du sondage Ipsos donné en début d’émission :

Clément Le Goff le dira clairement en y intervenant en direct vers 21h30. Il couvre ce jour-là sa 16ème ou 17ème manif gilets jaunes, et avait perçu, avant novembre 2018, des grondements en régions, notamment autour du sujet sensible des fermetures de maternités.
Le service public est respecté
J’arbore un brassard « Presse » (j’en ai même deux, un à chaque manche !), Clément a mentionné aussi sa branche professionnelle sur son casque qu’il enfile quand ça chauffe, et au début de la manif, Loup porte à l’épaule sa grande caméra TV. Mais le nom de notre média n’est pas identifiable.
En nous présentant, nous essuierons parfois des refus polis d’interviews et quelques remarques peu agréables sur notre profession, mais le plus souvent les mots « France2, France3 ou FranceInfo » serviront, ici, de sésame. Et la bienveillance sera présente dans les échanges. Ce n’est pas toujours le cas, souligne Clément. On nous demandera ainsi pourquoi nous ne sommes pas en grève, avant de reconnaître le besoin de témoigner et d’expliquer.
D’ailleurs, hormis Russia Today et ses micros verts, je n’ai vu dans la manif aucun nom ou logo de média. Des équipes et des photographes se contentent des brassards et casques « Presse ». Ou pas. Et autant le dire clairement, je suis content de ne pas travailler pour BFM TV, chaîne honnie ouvertement par les manifestants qui lui accolent un parti-pris idéologique (mais qu’ils regardent aussi beaucoup).

Dans l’après-midi, Loup préfèrera tourner avec une caméra légère. Il pourra être plus discret, mais nous serons, pour les protagonistes, moins identifiés « télé ». D’ailleurs, nos gardes du corps devront s’intercaler quelques fois pour calmer des radicaux, mécontents de se voir filmer, par exemple, en train de casser des plaques de ciment en bas de la statue de la République et empocher des morceaux, futurs projectiles.
L’objectif des éléments les plus radicaux, qui cassent et brûlent ouvertement, semble être de profiter de la masse des manifestants non violents pour y provoquer une intervention des forces de l’ordre, et des dérapages où les CRS ne feront plus nécessairement la différence.
Correction des forces de l’ordre

Pour transmettre régulièrement des images, qui serviront aux éditions du soir et à Franceinfo, nous franchissons sans grand problème les cordons de CRS qui encerclent les places parisiennes (Nation et République) pour rejoindre les motos. Il faut montrer nos cartes de presse, et j’ai certes reçu d’elles un éclat – et donc un bon bleu sous le genou, mais les forces de l’ordre ont, à chaque fois dans nos cas, été très correctes et professionnelles.
Et une fois hors de la zone de guérilla urbaine, une des choses les plus étranges de cette immersion fut de vivre, à quelques dizaines de mètres, la coexistence d’une vie de grande ville normale (courses, badauds, bistrots, restaus, …). Comme si de rien n’était.
Eric Scherer
ps : En tous cas, c’est clair, nous ne sommes pas en 1995…

Les grandes étapes de l’insurrection numérique : comment en est-on arrivé là ?
On l’a vu : « D’abord la révolution mentale, puis la révolution technologique (…) Habituez-vous à considérer le monde numérique comme un effet, et non une cause », nous a dit Alessandro Baricco.
(cf. billet précédent)
1978. « L’expérience qui change de consistance »
Pour Baricco, la vertèbre zéro symbolique de ce nouveau monde surgit en 1978 avec l’invention du jeu vidéo Space Invaders, « une des premières traces géologiques d’un tremblement de terre ».
« La séquence est la suivante : baby-foot, flipper, Space Invaders ».

« L’écran qui n’existait pas au baby-foot et qui, au flipper, servait à compter les points, a désormais tout dévoré, DEVENANT le terrain de jeu. Tout est immatériel, graphique, indirect. »
« Le corps ? Disparu. »
« Un jour quelqu’un a stocké numériquement un fragment du monde et ce fragment nous a fait basculer pour toujours dans l’ère numérique. »
« Au lieu d’inventer un coup génial, quelqu’un a modifié l’échiquier : c’est ce qu’on appelle un changement de paradigme. »
1981-1998. Du Commodore 64 à Google. L’âge classique. Presque 20 ans pour préparer le terrain de jeu :
« Le vrai génie n’était peut-être pas d’inventer les ordinateurs, mais d’imaginer qu’ils pourraient devenir un outil personnel et individuel. » Alors « le monde était véritablement en train de basculer ».
Puis le premier CD musical est commercialisé.
1988 : le premier appareil photo numérique voit le jour.
Décembre 1990 : « Un ingénieur en informatique anglais, Tim Berners-Lee, inaugure le World Wide Web et change la face du monde ». « C’est ce qui sous-tend notre nouvelle civilisation » qui naît donc en Europe.

1993 : un groupe de chercheurs invente le MP3 en Europe.
1994 : Cadabra, premier nom d’Amazon, naît à Seattle. IBM sort le 1er smart phone.
1995 : le premier DVD est mis en vente. Bill Gates lance Windows 95. Naissance d’eBay.
1998 : « Grand Finale. Deux étudiants de Stanford, âgés de 24 ans, Sergey Brin et Larry Page, lancent un moteur de recherche au nom stupide, Google. »

️ « La révolution numérique naît de trois gestes significatifs qui dessinent un nouveau terrain de jeu :
- Numériser les textes, les sons et les images. Réduire la trame du monde à l’état liquide ;
- Créer l’ordinateur personnel ;
- Mettre en relation tous les ordinateurs.»
Les travaux sont alors terminés. « À la fin des années 1990, toutes les pièces étaient sur l’échiquier. Quelqu’un a alors appuyé sur Play. »
1999-2007. De Napster à l’iPhone. La colonisation. À la conquête du Web
1999 : Napster permet d’envoyer gratuitement de la musique à une autre personne équipée d’un ordinateur.
2000 : la bulle dot.com explose. « Assez joué, la fête est finie, retour à la bonne vieille économie. »
2001 : attentat contre les Twin Towers (les frontières de la guerre disparaissent mais « les Américains partent à la recherche d’une guerre à l’ancienne »). Naissance de Wikipédia.
2002 : naissance de LinkedIn, premier concept de réseau social. « C’est la première fois que les hommes font une copie numérique d’eux-mêmes et la déposent dans le deuxième monde (…) Désormais, ils s’y rendent en personne et y existent ». MySpace, prédécesseur de Facebook, voit aussi le jour.
2003 : succès de commercialisation du Blackberry. « La posture homme-clavier-écran n’est plus liée à la fixité de l’ordinateur. Elle était liée à lui et se promenait avec lui ». Ce n’est pas une médiation, mais une extension de soi. Les premières addictions sont signalées (« crackberry »). « Mort en 2016, c’est une sorte de Gorbatchev de la téléphonie ». Skype naît en Suède.

2004 : Facebook est lancé. « Peut-être le phénomène de colonisation le plus massif que nous puissions enregistrer. » Naissance de Flickr. C’est la seule fois où une femme, Catarina Fake, figure sur la liste des inventeurs. Invention de l’expression Web 2.0, marqué par une interactivité généralisée. ABC diffuse le 1er épisode de « Lost » : les séries, sorte de cinéma natif numérique et mariage entre un vieux média, la télévision, et un nouveau, l’ordinateur, « deviennent l’expression artistique la plus aboutie de l’insurrection numérique ».
2005 : naissance de YouTube.
2006 : naissance de Twitter. Et de YouPorn.
2007 : Amazon lance le Kindle.
« Et bouquet final : Steve Jobs annonce qu’il a réinventé le téléphone ».

Pour Baricco, « le moment fondateur est la présentation de l’iPhone par Steve Jobs, le 9 janvier 2007 à San Francisco. Ce jour-là, il n’a pas exposé des théories, il a montré un outil. »
« Le passage dans le deuxième monde devient un geste presque fluide, absolument naturel et virtuellement ininterrompu. » « C’était amusant (…) Steve nous dit que c’est un jouet (…) Il a été conceptuellement pensé comme un jeu vidéo (…) Toute l’insurrection numérique était portée par la revendication tacite que l’expérience puisse devenir un geste dédié, beau et confortable. Pas la récompense d’un effort, mais le résultat d’un jeu. »
Dans la période de la colonisation, nous avons donc « étendu le jeu né à l’époque précédente, avant tout dans deux directions : les réseaux sociaux et les smartphones ».
« Porteurs d’au moins deux mouvements telluriques :
- « Les réseaux sociaux signifiaient la colonisation PHYSIQUE de l’autre monde. Les personnes s’y sont transférées PHYSIQUEMENT. » « C’est avec cet outil particulier que l’insurrection numérique a enrôlé pour de bon la grande majorité des participants. »
- « Ce mouvement a été accéléré et facilitée par l’autre totem de l’époque : le smartphone, technologie partagée par une majorité de personnes. »
2008-2016. Des applis à AlphaGo. The Game. Le monde dans lequel nous vivons
2008 : Lehmann Brothers fait faillite. Crise financière. « Mais les principaux acteurs du Game ne semblent guère perturbés. » De manière incroyable, une start-up suédoise se glisse parmi les géants US : Spotify. Netflix commence à vendre ses films en ligne. Spotify et Netflix n’ont rien inventé de bien nouveau, mais « sont des déductions logiques et technologiques de la décennie précédente ».
Apple ouvre une nouvelle boutique en ligne : on y vend des produits appelés applications. « Depuis que les programmes sont devenus des applis, nous les aimons, les utilisons, nous leur faisons confiance et jouons avec eux. » Avec elles, « nous avons ouvert une quantité astronomique de petites portes vers le deuxième monde ».
Naissance d’AirBnb. « Vous possédez un logement, placez-le dans le deuxième monde et louez-le. »

Barack Obama est élu Président des Etats-Unis. Il est le premier à utiliser le monde numérique pour gagner. « Il l’a choisi comme système nerveux de sa campagne. »
2009 : naissance de WhatsApp et d’Uber. Le Game commence à faire des petits.
Création en Italie du « Mouvement 5 étoiles ». « Première fois que l’insurrection numérique donne directement le jour à une formation politique qui se propose d’attaquer les palais du pouvoir. » Notamment en amenant les gens à intervenir directement dans le débat politique grâce aux outils numériques.
2010 : naissance d’Instagram.
2011 : Apple lance iCloud. Nos fichiers ne sont évidemment pas dans les nuages mais « stockés dans des millions d’endroits absurdes ».
L’utilisation des applis dépasse celle du Web. « Ce sont des hangars, parfois immenses mais fermés ». Le deuxième monde n’est plus un espace ouvert.
2012 : la télévision devient officiellement numérique.
Naissance de Tinder. « Sorte de jeu vidéo élémentaire, subtilement érotique et très facile à utiliser. »

2016 : AlphaGo, logiciel développé par Google, affronte et bat le n°1 mondial du jeu de Go. C’est l’arrivée de l’intelligence artificielle.
Mais aussi de Trump et du Brexit.
ES.
À la recherche des humanités numériques – Chroniques d’une insurrection
Il faut faire confiance aux écrivains pour nous faire comprendre le monde.
Qui mieux que Zola ou Dickens a saisi l’essence de la révolution industrielle ? Qui a mieux décrit la Vienne fin-de-siècle que Stefan Zweig, ou Theodore Dreiser l’Amérique immorale et puritaine du début du XXème ?
Ce sont souvent les génies humanistes touche-à-tout les plus universels, les plus polyvalents, les plus éclectiques – Leonard de Vinci, Alexander von Humboldt, voire maintenant Bruno Latour — qui nous expliquent le mieux le monde.
Éloignons-nous donc des geeks, pour une fois, et prenons de la hauteur.
Aujourd’hui, 50 ans après l’invention d’Internet, 30 ans après celle du Web, c’est le romancier, musicologue et homme de théâtre italien Alessandro Baricco qui propose une très convaincante « cartographie de l’insurrection numérique ». Une plongée dans ce soulèvement qui change notre rapport au monde, et nous fait basculer dans une nouvelle civilisation.
Il l’a appelée « The Game », titre de son nouvel essai publié, cet automne, chez Gallimard. J’avais déjà admiré et chroniqué il y a quelques années le discernement avec lequel il analysait dès 2006 (avant même Facebook et l’iPhone) l’invasion, ou plutôt la mutation provoquée par des « Barbares » (nous-mêmes essentiellement), des « agresseurs qui étaient en train de remplacer un paysage par un autre et d’y créer leur habitat ». En gros, de redessiner nos cartes et nos existences.
Voici donc notre lecture de cette sorte de « tome 2 des Barbares ».
1Causes et éléments fondateurs
Nous avons connu de grands virages : l’Humanisme, les Lumières, le Romantisme, par exemple.
Pour Baricco, la profonde mutation que nous connaissons aujourd’hui a d’abord « été un geste presque instinctif en réaction à un choc, celui du XXè siècle » et son cortège d’horreurs. Afin de rendre impossible sa répétition.
Elle n’est donc pas seulement le fait d’une révolution technologique impliquant des outils inédits, mais avant tout le résultat d’une insurrection mentale occidentale consistant à « fuir une civilisation désastreuse » et à court-circuiter des élites coupables et immobiles.
Elle naît dans les années 60/70 en Californie, où une contre-culture produite par des « ingénieurs, informaticiens, hippies, militants politiques et brillants nerds, impatients vis-à-vis du monde tel qu’il était », cherchait des éléments de libération dans une révolte collective. Ils l’ont trouvée dans les premiers laboratoires informatiques et n’ont eu qu’une idée fixe : mettre un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque foyer.
En d’autres termes, « démanteler le pouvoir et le distribuer au peuple ».
(En gagnant beaucoup d’argent au passage. Mais cela on ne le découvrira qu’après.)

« Cette intelligence technico-scientifique d’inspiration hippie, précise Baricco, n’a ni idéologie, ni structure théorique, ni esthétique » mais s’appuie sur « une somme de solutions pratiques. D’instruments. D’outils. »
Et sur une méthode…
Cette méthode est résumée par Stewart Brand, idole de Steve Jobs et créateur du fameux Whole Earth Catalog, humus d’où vient cette insurrection :
« Beaucoup de gens croient pouvoir changer la nature des personnes, mais ils perdent leur temps. On ne change pas la nature des personnes. En revanche, on peut transformer les outils et les techniques qu’elles utilisent. C’est ainsi qu’on changera le monde. »
Sans expliquer leur projet, et probablement « sans en deviner les conséquences sur nos cerveaux et nos comportements », ces pionniers, explique Baricco, vont donc « repérer les points d’appui de la culture du XXè siècle puis entreprendre de les miner un par un ».
En y instillant la plus grande dose de mouvement possible pour mettre les élites sur la touche, « ils ont creusé des tunnels autour des grandes forteresses du XXè siècle, en sachant que tôt ou tard, elles s’effondreraient ».
Résultat, note l’écrivain, « elles s’effondrent l’une après l’autre ».
2Comment le monde a changé: quelle est cette nouvelle civilisation ?
Il faut le redire : ces pionniers « n’étaient donc pas en train de construire une THÉORIE sur le monde, ils instauraient une PRATIQUE de celui-ci. Si vous cherchez les textes de base de leur philosophie, les voici :
- l’algorithme de Google ;
- la 1ère page Web de Tim Berners-Lee ;
- l’écran d’accueil de l’iPhone ».
Sans projet précis d’humanité, mais fuyant une civilisation en ruine, « ils résolvaient les problèmes en choisissant systématiquement la solution que boycottait l’ennemi, c’est-à-dire qui favorisait le mouvement et se passait des médiations ».
Et « lorsque les premiers capitaux sont arrivés – vite-, l’insurrection véritable s’est mise en marche ».
« Une révolution technologique a donc eu lieu, due à l’avènement du numérique. En peu de temps, elle a entraîné une évidente mutation dans le comportement des êtres humains et dans les mouvements de leur cerveau. Personne ne peut dire comment cela se terminera. »

(La 1ère page du Web)
Pendant ce temps, les pionniers ont créé « un deuxième monde fait de pages Web dans lequel n’importe qui pourrait gratuitement circuler, créer, partager, gagner de l’argent, s’exprimer ».
Il s’agit bien d’une révolution irréversible, qui s’est installée en 20 ans, « une insurrection qui devient civilisation » et qui modifie nos gestes, nos priorités, nos expériences. Révolution aussi « nécessaire », estime Baricco, afin de corriger des erreurs qui nous ont coûté cher.
« Nous lui reconnaissons la capacité à générer une nouvelle idée d’humanité », résume-t-il. C’est sans doute un peu exagéré…
Mais, il est vrai que chaque jour qui passe, nous déléguons un peu plus de nos décisions et de nos choix à des machines. « La prochaine colonisation électrisante ? », demande l’auteur italien : assurément les progrès stupéfiants de l’intelligence artificielle.
« Dans les cent prochaines années, alors que l’intelligence artificielle nous éloignera encore plus de nous-mêmes, il n’y aura nul bien plus précieux que tout ce qui permettra aux hommes de se sentir humains (…) Le besoin le plus répandu sera de sauver l’identité de l’espèce. »
Pas forcément hâte d’y être car à force d’appliquer les caractéristiques des outils à des êtres humains, on s’éloigne de notre identité.
3Les grandes caractéristiques de l’insurrection numérique
Voici donc les empreintes laissées par ces hommes lors des dernières décennies :
Tout vient du jeu vidéo
C’est le fondement, le bouillon de culture, le schéma fondateur de l’insurrection numérique. Les pionniers ont généré le changement en produisant des outils qui, « même s’ils ne sont pas des jeux, y ressemblent ». « À partir d’un certain point, assure Baricco, plus rien n’a eu de chances de survie sérieuses qui n’ait dans son ADN le patrimoine génétique des jeux vidéo ».
Dérivé du jeu « hot or not » des étudiantes d’Harvard développé par Zuckerberg, « Facebook est né avec une évidente composante de jeu : l’environnement est volontiers confortable, pratique, amusant. » Twitter est « une orgie amusante et ininterrompue de gagnants et de perdants. » Idem pour Spotify ou l’iPhone.
Les mécanique et esthétique de jeu sont appliquée à ces outils. Sans propos final. On les utilise jusqu’à ce qu’on se lasse.
C’était la terre promise des hackers : « Un jeu vidéo unique, libre et ininterrompu. The Game ».
Le logo de notre civilisation ? La position « homme-clavier-écran »
C’est une des positions dans lesquelles nous passons le plus de temps (rappelez-vous, pendant des siècles, ce fut « homme-épée-cheval », voire « homme-faux-fléau »).
Une posture qui n’est sans doute qu’une étape vers une informatique ambiante plus « invasive » du corps et de l’esprit (voix, interfaces de réalités altérées vers des mondes virtuels).

Conséquence : la fusion de l’homme et de la machine
Il fallait donc réduire à néant la distance entre les trois éléments homme-clavier-écran.
La seule médiation qu’ils ont acceptée fut celle des machines, non pas un intermédiaire dans la relation de l’homme aux choses, mais des « prothèses presque organiques », une extension de soi, de notre ego.
De véritables « articulations de son être-au-monde », « une extension artificielle de nos compétences naturelles », explique le romancier italien.
L’effacement des médiations et la destruction des élites
Ces hommes sautent les étapes et surtout les intermédiaires, « préférant être en prise directe sur les choses ». Avec Google, qui cherche constamment à remplacer les humains, « il n’y avait plus cette caste de sages qui savaient où se nichait le savoir, elle était désormais remplacée par un algorithme. » On sait depuis que cet algorithme est souvent biaisé.
Ces hommes se déplacent aussi et laissent des traces ; ils font attention à ne pas les effacer. Ce sont les fameuses données.
« Puis ils ont commencé à les utiliser, à leur donner de la valeur. » Pire : « Un nombre significatif de personnes en arrivent à croire que l’on peut se passer de médiations, d’experts, de passeurs : beaucoup en concluent qu’elles se sont fait avoir pendant des siècles. »
Ainsi, « depuis son époque fondatrice, classique, la colonne vertébrale de la révolution numérique porte le signe d’organismes qui tendent indistinctement à mettre en place un monde à traction directe, en sautant toutes les étapes possibles et en réduisant au minimum la médiation entre l’homme et les choses ou entre deux hommes ».
« A l’issue de ce processus, l’homme fait donc l’expérience d’une vie dans laquelle il peut se passer d’intermédiaires, d’experts et de pères. Il la trouve belle. Il en tire une vision revigorée de lui-même. »

Barrico l’expliquait bien, fin octobre, dans l’hebdomadaire « Le 1 » :
« Le Game a abattu des barrières psychologiques vieilles de plusieurs siècles ».
« Aujourd’hui, avec un smartphone à la main, les gens peuvent entre autres faire ces quatre gestes :
- Accéder à toutes les informations du monde ;
- Communiquer avec n’importe qui ;
- Exprimer leurs opinions devant un large public ;
- Exhiber des objets (photos, histoires, tout ce qu’ils veulent) qui représentent leur vision de la beauté.
L’apparition d’une nouvelle élite
« Nous ne sommes pas tous égaux devant le Game », constate justement Baricco.
« Certains jouent mieux que d’autres. » Ils savent « utiliser les avantages d’un système de réalité à deux moteurs (les deux mondes), voyageant sans effort entre le premier et le second ».
D’autant que « la plupart des institutions, à commencer par l’école, ne préparent pas au Game ». « Un large fossé s’ouvre de nouveau entre les élites et les autres, entre les riches et les pauvres, entre les inclus et les exclus. »
Et attention, cette nouvelle élite n’est pas formée que de développeurs, d’ingénieurs ou de milliardaires du Web.
« C’est une élite intellectuelle d’un genre nouveau, vaguement humaniste, où la discipline de l’étude a été remplacée par la capacité à relier des points, où le privilège de la connaissance s’est dissous dans celui de l’action et où l’effort de penser en profondeur s’est inversé en plaisir de penser rapidement. »
Un mot encore sur les riches. On pourrait, note Baricco, « faire passer l’insurrection numérique pour une gigantesque opération commerciale ». Mais, ajoute-t-il, dès les années 2000 « le résultat économique a commencé à représenter d’une certaine manière le score visible communément accepté, pour comprendre qui était en train de gagner la bataille entre l’ancien et le nouveau ». On retrouve le jeu !
Comme si Zuckerberg, Bezos, Jobs, Brin ou Page, « brillants nerds, étaient occupés à jouer à un jeu paranoïaque qu’ils ont inventé eux-mêmes, en l’absence de tout concurrent ou presque, plus ou moins seuls, sans réel besoin d’écraser des rivaux, avec pour seule obsession de franchir des niveaux ». Toujours le jeu…
Mais avec un risque évident : celui « d’un renoncement global aux motifs premiers de l’insurrection ». C’est donc à ce moment-là, estime l’auteur, que « l’insurrection numérique s’est arrêtée (…) Elle a abandonné le nomadisme, planté la tente et pris possession de cette terre promise. »
La dématérialisation généralisée
C’est une époque de réalité sans friction, de fluidité des gestes, de « dissolution du monde en fragments légers ». « Des zones de plus en plus vastes du monde réel sont devenues accessibles grâce à une expérience immatérielle. » Mais ne se rencontrent pas nécessairement. Voire jamais.
C’est l’origine de la fameuse grande fragmentation qui caractérise cette révolution. Fragmentation des outils, des sources, des publics. Y compris du phénomène de « nichification » qui touche les médias et où le service public a un rôle majeur à jouer pour préserver un espace commun. Y compris numérique.
« La numérisation a démembré les données, les rendant légères, nomades, immatérielles (…) Les ordinateurs dématérialisent pratiquement le monde, ramenant tout à un écran (…) Le Web lui-même, comme Internet avant lui, était et demeure comme une entité perçue comme fondamentalement immatérielle ».
Voyez la page Web et le lien hypertexte. Tim Berners-Lee nous dit : « Cette chose est une façon de penser, pas un instrument qu’on acquiert et qu’on utilise tout en continuant de penser comme avant. C’est une façon de faire bouger l’esprit et il appartient à chacun de choisir sa façon de le faire bouger. »
Sur le Web, « l’impression en y voyageant, c’est que nous bougeons, NOUS, pas les choses ». Le Web « a dématérialisé les humains ! ».
C’est donc un homme différent qui apparaît, observe Baricco. « Un homme qui n’est pas contraint d’être linéaire (…) de se faire dicter par le monde la structure de sa pensée et les mouvements de son cerveau. »
La création d’un deuxième monde
Le Web, lui, « a créé une copie numérique du monde. (…) Une version compressée du monde (…) Il l’a obtenue en en additionnant les mille petits gestes de ses utilisateurs ». « Ainsi il a irréversiblement altéré le format du monde (…) produisant un système de réalité à deux forces motrices. » Une expérience.
« C’est le nouveau décor dans lequel nous vivons actuellement » : « Un système dans lequel le premier et le deuxième mondes tournent l’un dans l’autre, formant une expérience, dans une sorte de création infinie et permanente. » « En cela, nous constituons véritablement une humanité nouvelle », note Baricco.
L’obsession du mouvement
C’est le monde de la vitesse, du tournis, de l’ouverture. En opposition à celui de « l’obsession de la frontière, l’obsession pour toute ligne de démarcation, l’instinct de diviser le monde en zones protégées et non communicantes. »
Il faut donc « diaboliser l’immobilisme, mettre en place un système ouvert unique dans lequel tout serait appelé à circuler ». « Les hommes, les idées et les choses devaient être entraînées à l’air libre et placés dans un système dynamique où la friction avec le monde serait minime, et la facilité de mouvement élevée un stade supérieur, but ultime et seul fondement. »
« Nous avons donné au mouvement la priorité sur le reste (…) Nous venons de cette décision », observe Baricco.
Depuis, beaucoup de choses se sont refermées, hélas.
La superficialité l’emporte sur la profondeur
C’est aussi le monde de la superficialité.
Une simplicité vantée par Steve Jobs quand il présente l’iPhone en 2007 et qui cachait une autre réalité : « L’essence de l’expérience était sortie de sa tanière, choisissant la surface comme milieu naturel. »

L’iPhone est un iceberg, comme la 1ère page de Google : « Une structure énorme qui disparait sous l’eau alors que son cœur minuscule flotte à la surface ». « La récompense au-dessus, l’effort en dessous. L’essence remontée à la surface, la complexité cachée quelque part. »
Tous sont faits ainsi : Facebook, Spotify, WhatsApp, YouTube…
C’est exactement l’inverse de la représentation mentale qui a dominé le XXè siècle où « le sens authentique des choses était caché » : « L’idée que le noyau de l’expérience était enfoui en profondeur, accessible seulement par l’effort et avec l’aide d’un intermédiaire ».
Il s’agit donc désormais de « rejeter les profondeurs comme lieu de l’authenticité et placer le cœur du monde, son essence, en surface. » On privilégie donc la qualité de l’expérience à celle de la médiation intellectuelle.
La post-expérience : une conscience de soi renforcée
C’est l’expérience enrichie, nouvelle, démultipliée, née de l’utilisation des nouveaux numériques. « Vous profitez du fait qu’il n’y ait pas d’intermédiaires pour vous les briser et vous réalisez le seul geste que ce système semble vraiment suggérer : tout mettre en mouvement. Vous croisez. Vous reliez. Vous juxtaposez. Vous mélangez. » « Vous n’avez besoin que de vitesse, de légèreté et d’énergie », explique Baricco.
Mais, ajoute-t-il très vite : « La post-expérience est fatigante, difficile, sélective et déstabilisante ». C’est « une version intelligente du multitâche. Une façon d’utiliser la superficialité comme fondement du sens. » Parvient-on à le trouver ainsi ?
« L’expérience telle que le XXè siècle l’imaginait était un épanouissement, une plénitude, une rondeur, un système accompli. Au contraire, la post-expérience est un fractionnement, une exploration, une perte de contrôle, une dispersion ». « Elle engendre de l’instabilité, de la stupéfaction, du trouble. » Mais, assure Baricco, cet aller-retour permanent entre les deux mondes « enrichit aussi la vie ».
Elle permettrait une refondation, voire même une restitution de l’ego. « La tendance générale à développer les possibilités de l’individu s’est consolidée à l’ère du Game (…) dans toutes les directions : voyager, jouer, s’informer, aimer … »
Et « beaucoup se sont soudain aperçus qu’ils pouvaient penser directement ». « Les graines d’une conscience de soi renforcée » ont été semées, nous dit l’essayiste.
L’individualisme de masse
« Le Game n’admet pratiquement que des joueurs individuels, il a été conçu pour des joueurs individuels, développe les compétences de joueurs individuels et affiche le score de joueurs individuels », note Baricco. « Même Trump et le Pape envoient des tweets.»
Nous l’avions pressenti en évoquant depuis plusieurs années, dans notre industrie, l’effacement progressif des mass média (ces médias qui bombardaient tout le monde avec les mêmes contenus à la même heure), remplacés de plus en plus par des médias de précision, voire de personnalisation de masse.

« Ainsi, le Game est devenu le plus formidable incubateur d’individualisme de masse que nous ayons jamais connu, une tendance que nous ne savons pas traiter et qui nous prend fondamentalement au dépourvu », dit Baricco.
En conséquence, « cet individualisme de masse génère des millions de micro-mouvements et désamorce le métier de guide ». Ajouter à cela « le triste phénomène d’individualisme sans identité qu’on observe souvent ». C’est-à-dire l’anonymat sur les réseaux sociaux.
Mais attention, rappelle-t-il, « l’individualisme est toujours, par définition, une posture contre : c’est le sédiment d’une rébellion ».
Rébellion qui peut aussi venir de nouvelles communautés, voire de bandes numériques, qui se forment autour des polémiques du jour pour jouer ensemble contre les « ennemis » virtuels. Le Game est sans doute aussi parfois un jeu multi-joueur où pour réussir il faut s’allier, comme dans Fortnite.
En économie, c’est la redécouverte du TOUT
Avec le numérique, « le TOUT devient une mesure sensée, une quantité normale et un terrain de jeu raisonnable, voire le seul terrain sur lequel la partie vaut la peine d’être jouée », selon Baricco.
Explication : Amazon peut vous procurer TOUS les livres du monde, Google archive et indexe TOUT le Web, Spotify vous propose TOUTE la musique, etc. Et surtout, « on ne paie pas pour avoir un morceau, on paie pour avoir accès à toute la musique du monde ». « Le tout devient une marchandise. » Avant, il était très hypothétique.
Conséquence : les acteurs veulent aussi être le TOUT. Google est LE moteur de recherche, Facebook LE réseau social, Amazon LE livreur en ligne, etc. Dans ce monde-là, « un bon business est un business à une place. » Autrement dit : « The winners take all ». Et l’innovation des plus petits est tuée dans l’œuf.
« Par le passé, faire du business consistait à composer avec un jeu de cartes préexistant : le vainqueur était celui qui avait la meilleure main. Désormais, faire du business consiste à inventer un jeu de cartes qui n’existait pas auparavant et avec lequel on ne peut jouer qu’à un seul jeu : celui qu’on a soi-même inventé. »
D’où cette question : « L’écosystème du Game, qui a une certaine tolérance pour les monopoles et a d’une certaine façon besoin d’eux, a-t-il développé dans le même temps des anticorps qui l’empêchent de dégénérer en un terrain de jeu bloqué, contrôlé par quatre ou cinq joueurs ? ». Notre droit de la concurrence est-il adapté au Game ?
Probablement pas.
4Contre-Réfome, backlash et inquiétudes
Inévitablement, les résistances sont apparues.
Progressivement. D’abord de la part des vétérans du XXème siècle, puis des puristes des origines, enfin des nouveaux perdants de cette civilisation.
Oui, nous avons commencé par nier cette mutation fulgurante, mais sans la boycotter, car nous utilisions ses outils ! Nos gestes ont changé rapidement, mais nos pensées sont restées en retard. Et puis nombreux sont ceux qui y ont vu, non sans raison, une agression.
Au début, s’amuse Barrico, ce furent surtout « des manifestes pour défendre les drogueries », les diligences.
« Le tir de barrage — naturellement dirigé par les élites qui sentaient la terre se dérober sous leurs pieds _- était plutôt confus, résolument arrogant et, en définitive, aveugle. » « Le Game semblait voler l’âme du monde », mais « elles voyaient les traces de l’ennemi, jamais l’ennemi lui-même. »
Mais rapidement, on s’est aperçu que « nous roulions dans le noir tous feux éteints ».
« Sommes-nous certains qu’il ne s’agit pas d’une révolution technologique qui impose aveuglément une métamorphose anthropologique sans contrôle ? », demande l’auteur italien. C’est surtout « une civilisation festive, alors que l’Histoire ne l’est pas », souligne-t-il. « En démantelant notre capacité de patience, d’effort et de lenteur, ne finira-t-on pas par engendrer des générations incapables de surmonter les revers du destin ? »
C’est aussi une révolution sans diversité.
La grande majorité des héros de cette révolution sont des ingénieurs, scientifiques, hommes blancs, californiens.
D’ailleurs le phénomène #MeToo n’a pas épargné non plus ce secteur de soi-disant libertaires.

« Nous avons besoin de culture féminine, nous avons besoin de connaissances humanistes, nous avons besoin d’une mémoire non américaine, nous avons besoin de talents qui ont grandi dans la défaite et nous avons besoin de talents qui viennent des marges. », estime justement Baricco. Une Europe qui s’appuierait davantage sur ses valeurs humanistes et sa diversité culturelle aurait probablement des atouts à faire valoir.
Autre important dommage collatéral du Game, et non des moindres : la vérité. Elle est devenue « une étoile filante ».
La vérité devient de plus en plus insaisissable dans un Game où la règle est le mouvement et la qualité de l’expérience, et qui comporte autant de milliards de joueurs, donc de visions du monde, plus ou moins floues.
Pour Baricco, « le Game — étrange matériau à basse densité — est trop instable, dynamique et ouvert pour constituer l’environnement agréable d’un animal sédentaire, lent et solennel, comme la vérité ». « La déplacer semble être à la portée de n’importe qui, et la produire un jeu d’enfant. »
Mieux, « nous sommes allés plus loin que la post-vérité : nous avons dépassé les faits, nous agissons sur la base de convictions improvisées à partir de rien, voire de données clairement fausses. » Parfois, l’opinion est devenue un fait comme les autres.

Mais attention, avertit Baricco, « Le Game n’est pas si simple, ni si puéril. Dans le Game, il n’y a pas d’un côté les gens intelligents qui respectent les faits et, de l’autre, les méchants qui savent raisonner uniquement avec leurs tripes ».
« En étant brutal, on pourrait dire ceci : post-vérité est le nom que nous, élites, donnons aux mensonges que racontent les autres, mais pas à ceux que nous racontons. En d’autres temps, on aurait appelé ça des hérésies. » Ou, dit plus tranquillement : « La théorie de la post-vérité est le produit d’une élite intellectuelle apeurée, consciente de ne plus contrôler la production quotidienne de vérité. »
Le Game a donc « changé le design de la vérité », dit-il. « Il a fait à la vérité ce que Steve Jobs a fait au téléphone, pour ainsi dire. » Il a produit notamment une « vérité-minute ».
Pour atteindre la surface du monde — c’est-à-dire pour devenir compréhensible au grand public et être portée à l’attention des gens — la vérité est ainsi « redessinée de manière aérodynamique, perdant de sa précision et de son exactitude en cours de route, mais gagnant en synthèse et en vitesse. »
C’est d’ailleurs « le schéma qui guide tous les outils numériques. C’est l’histoire du MP3 : moins de sons, mais plus transportables. C’est l’histoire de la transition vers le numérique : un peu d’imprécision en échange d’une immense agilité. C’est l’histoire de la superficialité qui remplace la profondeur. C’est la forme du Game. »
L’ère de la vérité-minute
La vérité-minute l’emporte « si elle peut remonter à la surface avant et mieux que les autres (…) La fermeté de son point d’appui sur la réalité des faits n’a guère d’importance : c’est sa structure aérodynamique qui décide de son destin. »
Et la meilleure structure pour cela dépend désormais du storytelling, « qui devient une partie de la réalité », précise Baricco. D’où le succès de la viralisation. Rappelez-vous : mouvement, rapidité, etc.
Dans la monde politique, la gauche, dit Baricco, a aujourd’hui « des solutions immobiles, donc mortes », tandis que « les populistes au contraire sont très forts en design ». Aujourd’hui, « les idées doivent naître aérodynamiques ou elles ne le seront jamais ».
Sans compter pour de nombreux d’entre nous, la priorité donnée au court terme mais aussi « le cauchemar de la superficialité : le soupçon tenace que la perception du monde dictée par les nouvelles technologies omet toute une partie de la réalité, sans doute la meilleure : celle qui palpite sous la surface des choses, là où seul un cheminement patient, laborieux et raffiné peut nous mener ».
Là encore, le service public a un rôle crucial à jouer dans l’éducation aux médias, dans l’apprentissage des outils de production et de diffusion, comme dans le partage de formats longs (enquêtes, décryptages, entretiens contextualisés).
Les nouvelles élites se mutinent aussi
Car si l’insurrection n’a pas été étouffée par le pouvoir écrasant des institutions et des élites traditionnelles, « des enfants du Game, parfois issus des nouvelles élites » ont aussi commencé à se rebeller pour avoir « constaté une sorte de dégénérescence du système : ils luttent moins contre le Game qu’au nom du Game, des valeurs pour lesquelles il avait été fondé ». Certains, de plus en plus nombreux, s’en sont même retirés complètement.
« Ce contre-mouvement fascinant » surgit car il dénonce la trahison des idéaux de base, la confiscation du Game par une poignée d’acteurs surpuissants, leur enrichissement sidérant, leur appropriation de l’innovation, la violation de la vie privée, leur absence de contribution fiscale, leur effet narcotique, le creusement des inégalités, le génocide des auteurs, musiciens, journalistes. « Celui qui y gagne n’est pas celui qui crée, mais celui qui distribue. »
Mais toutes ces objections, observe Baricco, « sont des conséquences de l’ère du Game, résultats de sa culture, et ne le remettent pas sérieusement en cause ». « La rancœur qu’ils éprouvent à l’égard des grands joueurs semblent avoir anéanti la possibilité pour eux de se souvenir qu’ils vivent dans un monde auquel ils ont largement contribué. »
Pire : ils sont aujourd’hui parfois « techniquement soumis et psychologiquement dissidents. »
Et en général, aujourd’hui, si les distributeurs sont en train de l’emporter sur les créateurs et les producteurs, il n’y a pas grosso modo « de volonté rationnelle de tout envoyer valser et de sortir du Game », observe-t-il. « La quantité d’outils augmente, la capacité à les utiliser se multiplie, la vigilance contre les risques inhérents s’accroît, les techniques pour amortir de leurs effets secondaires s’affinent. »
5Impact politique fort. Et égoïsme de masse
Tout n’est pas rose dans le Game. Loin de là
Si « le Game a redistribué le pouvoir, ou du moins les possibilités, il n’a pas redistribué les richesses », précise, lucide, Baricco dans l’hebdo « Le 1 ».
« Il n’y a rien dans le Game qui redistribue la richesse. La connaissance, les possibilités, les privilèges, oui. La richesse, non. À long terme, il ne pouvait que susciter une colère sociale qui s’est répandue en silence, telle une immense flaque d’essence. La crise économique y a alors jeté une allumette. En feu. »
« Le Game a grandi dans les plis de leur pouvoir (des élites), puis les a peu à peu délégitimées, les livrant à la foule quand elles n’ont plus eu la force de se défendre ».
Le malaise des déclassés et la montée du populisme ne sont pas sans lien non plus avec le creusement de la fracture numérique.
« Si vous vous demandez comment nous en sommes arrivés à un retour du nationalisme et à la réévaluation des frontières, oubliant les désastres d’il y a seulement deux générations, vous pouvez entrevoir une explication : c’est parce que vous êtes au beau milieu du Game, que la gueule de bois de l’humanité augmentée est passée, et que vous avez soudain l’impression de flotter dans un jeu dont vous n’avez pas appris les règles, auquel vous perdez, qui peut-être ne vous plaît pas e, tout ce que vous pouvez faire, c’est marcher à reculons jusqu’à ce que vous rencontriez un mur contre lequel vous appuyer en étant sûr qu’il n’y aura personne dans votre dos », écrit Baricco.
« Un processus de libération, se demande-t-il dans son livre, peut-il désorienter les hommes au point de les pousser à retourner volontairement dans des cages ? »
« Dans un domaine largement surestimé, la politique, le penchant actuel des électeurs pour une forme de leadership populiste qui tend à se passer des partis traditionnels et aussi de leurs raisonnements donne une idée fort claire du raisonnement. »
Comme beaucoup, il remarque en tous cas « deux points où l’insurrection numérique et le populisme de droite peuvent se rencontrer et vivre ensemble : l’un réside dans la haine viscérale des élites, l’autre dans le penchant instinctif vers l’égoïsme de masse ».
Il est aussi curieux, note-t-il, que le Mouvement 5 étoiles soit né et ait gagné en Italie, pays très peu numérique.
Mais ce qui est sûr, estime-t-il, c’est que « le parti politique du XXè siècle, massif, carré, fermé, stable, gigantesque et durable, n’est pas adapté aux règles du Game. Il s’agit à l’évidence d’un vestige d’une civilisation antérieure. »
Autre rigidité inadaptée : l’école. « Croyez-moi, dit Baricco, tout va y passer. »
En forme de conclusion
Maîtrisant comme personne les codes, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire du monde numérique, l’écrivain Alessandro Baricco, cartographe, dessine pour nous avec sagacité le profil de notre civilisation, et nous fait découvrir ses nouveaux continents.
C’est vrai, nous avons donné « le gouvernail de notre libération à des ingénieurs » et des techniciens, et permis que l’insurrection soit essentiellement « menée en forgeant des outils ».
« L’utilisation de ces outils, précise-t-il, a créé des scénarios complètement nouveaux et imprévisibles, porteurs d’une véritable révolution mentale : la dématérialisation de l’expérience, la création d’un deuxième monde, l’accès à une humanité augmentée, un système de réalité à double force motrice, la posture Homme-Clavier-Ecran ».
Mais c’est loin d’être la première fois que l’humanité est ainsi défiée, avant de s’adapter, tout en stimulant les râleurs. Goethe écrivait ainsi en 1825 :
« Personne ne sait plus rien, personne ne comprend l’élément dans lequel il flotte, agit et sur lequel il travaille. Les jeunes sont surexcités beaucoup trop tôt, puis emportés dans un tourbillon temporel. Richesse et vitesse sont désormais admirées et recherchées par tous ; chemins de fer, malles-poste express, bateaux à vapeur, et toutes sortes de moyens de communication possibles sont ce que les gens instruits se proposent de dépasser, et donc de rester ainsi dans la médiocrité. »
Aujourd’hui, les pionniers de la révolution numérique, qui ont eux aussi rompu avec des « décennies de systèmes bloqués, lents et sélectifs », ont donc « choisi systématiquement la solution qui coupait l’herbe sous le pied de la civilisation qu’ils voulaient fuir (…), une civilisation en équilibre sur la certitude d’une élite sacerdotale à qui était confié un système rassurant de médiations. »
Cette mutation, issue d’une « revendication collective » et d’inspiration libertaire, a vite mis hors-jeu les médiateurs existants. « Elle l’a fait à la manière d’un braquage, férocement, très vite, avec une bonne dose d’urgence, de mépris et même un désir de vengeance ».
« La meilleure façon de se débarrasser d’un passeur ou d’un prêtre, observe Baricco, est de permettre à tous de faire des miracles. »
« Cette redistribution des possibilités fut aussi une redistribution du pouvoir », constate-t-il. « Se moquer des centres de pouvoir (écoles, parlement, églises), envahir le monde par le bas, le libérant de façon presque invisible » a eu une conséquence énorme : « Les vieilles élites ont été laminées (…) et « le monde en est sorti complètement différent ».
Bon…Disons aussi que la faillite de nos vieilles élites n’est peut-être pas entièrement liée à l’effacement des médiations : leur insuffisance, voire parfois leur médiocrité, en est peut-être, aussi responsable. La redistribution du pouvoir semble aussi avoir débouché aujourd’hui sur un capitalisme encore plus brutal qu’auparavant. Et le pouvoir inédit qu’ont désormais les géants du Web est probablement au moins aussi effrayant que leur intrusion dans nos vies privées.
C’est d’autant plus inquiétant que Baricco, même s’il intitule son dernier chapitre « Humanités Contemporaines », ne nous donne pas de clés pour la suite ou de pistes pour nous aider à percevoir ce que nous pouvons encore faire pour améliorer notre sort. Encore une fois, les médias de service public devraient prétendre à un rôle ambitieux dans ce tissu social éclaté. Notamment autour de la nouvelle participation citoyenne.
Toujours est-il qu’en passant d’un système analogique à un système numérique, notre mode de vie, nos réflexes se sont trouvés profondément modifiés. Une certaine façon d’être au monde aussi. D’«une aube illuminée par un instinct précis de révolte », mouvement de libération, de rupture, d’espoir, de redistribution de pouvoir, le Game s’est évidemment modifié, mais il semble irréversible.
Car « poussés par l’utilisation d’outils qui leur montraient le chemin (…) la plupart des humains ont migré vers ce monde et s’y sont installés (…) Au fil du temps est arrivée une première génération de natifs, qui n’avaient pas migré là, mais qui y étaient nés (…) C’est dans leurs comportements, que le Game oublie progressivement ses racines insurrectionnelles (…) Ce n’est plus un mouvement contre quelqu’un mais vers quelque chose. »
« En soi, ce sont des outils simples, résume Baricco, mais comme l’a dit Stewart Brand, changez les outils et vous bâtirez une civilisation. »
A suivre !
Eric Scherer
——————
Ps 1 : Ces 5 chapitres ne sont pas ceux du livre de Baricco.
Ps 2 : Ce texte sert d’ouverture à notre Cahier semestriel de Tendances qui sera ici, sur Méta-Media en PDF gratuitement mi-décembre.
Ps 3 : De nombreux autres ouvrages racontent cette révolution numérique, ses origines, ses premiers pas. Nous en donnons des fiches de lecture à la fin de chaque Cahier de Tendances.
Trois importants livres parmi d’autres :
- “What The Dormouse Said. How the Sixties Counter-culture Shaped The Personal Computer Industry”, par John Markoff.
- « Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies”, par Reid Hoffman etChris Yeh
- “The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power”, par Shoshana Zuboff.
Au bagne, la télé affranchie
SAINT-LAURENT-DU-MARONI – Même habitué depuis des années, j’ai encore été surpris, ici en Guyane, par le profond et irréversible changements des usages médias.
A plus de trois heures de route –à travers la forêt amazonienne– de la préfecture Cayenne, je pensais que les lycéens de 1ère et Terminale, qui souffrent réellement de la fracture numérique (4G faiblarde, Internet fixe et wifi défaillants), avaient encore un petit attachement pour notre bonne vieille télé. D’autant que notre dynamique station Guyane la 1ère, chaîne de TV généraliste publique de proximité domine le PAF local de la tête et des épaules.
« Qui a regardé la télé hier ? » demandai-je donc.
– Aucune main levée.
« Qui a regardé son smart phone ? »
– Foret de bras tendus.
« Qui a Netflix ? »
– Quasi tout le monde !
La télévision libérée
Autant vous dire que, dans les murs restaurés du « Camp de la transportation » à Saint-Laurent-du-Maroni, qui a accueilli, trié, souvent gardé, et parfois exécuté pendant près d’un siècle les forçats du bagne de Guyane, j’ai surtout échangé sur la télévision libérée !

Une télévision désormais affranchie de son vieux vocabulaire de coercition : grille (de programmes), cases (de magazines), chaînes (de télévision). Pas vraiment les mots de la liberté ! En tous cas pas ceux des nouvelles habitudes (« atawad ») de l’ère numérique.
La terre est creuse
L’autre surprise de ces master class, données dans le cadre du Fifac, le 1er festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes, fut l’extension de la défiance vis-à-vis des médias traditionnels et l’extension du complotisme chez ces jeunes qui s’apprêtent à préparer Sciences Po.
« Vous ne dites pas la vérité. Regardez cette affaire de fausse arrestation en Ecosse. Et surtout, vous ne dites pas tout ».
Il a fallu expliquer, montrer, parler de nos confrères envoyés en Syrie pour eux, rappeler que c’est Albert Londres qui, par ses enquêtes et ses articles, a permis de fermer le pénitencier de Guyane, tandis que leur professeure m’alertait, inquiète, de la nouvelle rumeur à la mode, parmi ses élèves, d’une planète Terre, creuse et peuplée en son coeur de dinosaures dominants !
Définitivement ringard
Ramer donc, jusqu’au prochain étonnement :
« Monsieur, non, Tiktok c’est fini. Nous on utilise Triller ».
Contrit, dépassé, j’ai du faire épeler le nom de cette nouvelle appli, bourrée d’IA et qui fait d’eux des vedettes de clip musical.
Le doc de qualité

Mais j’ai aussi pu partager ma conviction : celle que le nouveau genre qui monte aujourd’hui, après les séries, sur les plateformes de streaming est bien celui du documentaire de qualité.
Palmares
Le palmarès du jury 1er Fifac, en témoigne : c’est le très beau film « Douvan Jou Ka Leve » de la cinéaste haitienne Gessica Généus abordant les questions de santé mentale en Haiti, qui a remporté le Grand Prix du jury du Festival, présidé par l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau.
Modernité
En Guyane, l’acte colonial et le marronnage sont toujours omni-présents dans les esprits. Mais la modernité est bien arrivée sur les rives du beau fleuve Maroni qui la sépare du Surinam.
« Tu regardes encore la télé, toi ?
Le gamin de la rue me rassure enfin :
– oui ».
« Et que regardes-tu ?
– Netflix ».
Bon…
ES

Edward Snowden et l’« Utopie déchue »: quand Internet est devenu un appareil de surveillance
Par Hervé Brusini, journaliste d’investigation, Prix Albert Londres
Le hasard de l’édition fait bien les choses. Deux livres font office de miroir, se renvoyant l’un à l’autre. Miroirs de papier pour la critique de l’univers numérique.
Il y a d’un côté « Mémoires Vives » (Seuil), pas seulement un témoignage mais la pédagogie d’une lente prise de conscience, celle d’un lanceur d’alerte qui bouscula le monde par ses révélations. C’est ainsi que la planète put découvrir l’existence d’un dispositif de surveillance de masse made in USA. Pas à pas – sans s’épargner – Edward Snowden livre toutes les étapes d’une lucidité décillée aussi attendrissante que rageuse.
Il y a de l’autre côté, l’ouvrage qui fait écho. Autant Snowden est un acteur du « drame » numérique, autant Félix Tréguer avec son « Utopie déchue » en est le théoricien/historien. La tentation de n’apercevoir que la modernité informatique de l’américain, est ici battue en brèche par le membre fondateur de « La Quadrature du Net ». Ce qui se présente comme une contre-histoire d’Internet, du XVe au XXI siècle est plus que salutaire pour comprendre la portée du geste accompli par l’homme réfugié à Moscou.
Alors prêt pour le voyage d’Orphée ? Invitation à explorer ce jeu de miroirs où se joue (ou pas) la mort d’un espoir démocratique.
« Mémoires Vives » a, de prime abord, quelque chose du récit d’un pirate.
Mais qu’on ne s’y trompe pas. Ici, le mot est à prendre au sens très répandu, chez les parents, mi fâchés, mi admiratifs, face à l’insolence de leur chère tête blonde. Banlieue de Washington. Papa est garde-côtes, et maman travaille dans une société d’assurances dont les clients sont salariés à…la NSA. Autrement dit, l’agence nationale de la sécurité qui a son siège à Fort Meade. C’est l’un des 17 organismes chargés du renseignement aux États-Unis. Son domaine : espionner tous les échanges d’origine électromagnétique à travers le monde.
Le petit Edward n’apprécie guère l’heure à laquelle on l’envoie au dodo. Alors à l’âge de six ans, il va retarder toutes les horloges du foyer, y compris celle du micro-ondes. Histoire de s’accorder quelques prolongations… COMODORE 64, puis NINTENDO, et surtout « LE » COMPAQ – l’équivalent d’un frère dit Snowden- les machines apportées par le père aiguisent la curiosité d’Edward au fil des ans.
« Ma curiosité était aussi grande qu’internet », précise-t-il. Mais aux yeux de l’enfant, rien que de très normal dans tout cela. Pire, dit-il, « Si vous étiez moi, vous étiez myope, maigre, en avance sur votre âge… et à 10 ans vous vous êtes intéressé à la politique ». Bref, Eddy le petit pirate va bientôt se lancer dans le piratage informatique.
A 13 ans il se crée un emploi du temps calculé, courbes statistiques à l’appui, sur ce qui rapporte ou pas sur le carnet de notes : exercices écrits, interro surprise à l’oral, présence… On ne le voit plus vraiment au lycée mais ses résultats restent dans la bonne moyenne. Stupéfait, un prof salue « la beauté » du stratagème et change sa méthode de notation. « Comme tous mes camarades, confie Snowden, je n’aimais pas les règles, mais j’avais peur de les enfreindre ». La suite a prouvé que cette peur a bel et bien été vaincue.
Déception d’un jeune patriote, édifiant constat de pratiques contraires à ce qu’il croyait être les valeurs du pays, cynisme et mensonges des gouvernants prêts à tout au nom de la sécurité pour mettre en place un appareil légal qui réduit toujours plus les libertés… Le parcours relaté par Snowden sonne, au fil des étapes de sa montée en puissance dans l’agence, comme autant de stations le conduisant vers sa « disparition professionnelle et personnelle ». Un « c’en est trop, il faut parler » qui s’installe peu à peu au risque de sa vie privée, rupture avec le quotidien d’une famille, d’un amour… Au risque de sa liberté… Franchir le miroir c’est ici fréquenter une sorte de mort.
Un événement déclencheur ? Parmi d’autres ce que lui-même appelle une vision de science-fiction. Glaçante.
Edward Snowden a 29 ans Nous en sommes en 2013, l’année même de son « départ ». Le voilà dans son bureau de la banlieue de Washington. Sa mission du jour consiste à tout savoir d’un universitaire indonésien. Ciblé par la NSA, l’homme a d’ores et déjà été mis à nu par le service. En parcourant son dossier, Snowden découvre la vie numérique du « suspect », ses centres d’intérêt, sa correspondance… Un dispositif de « gardiennage virtuel » permet même de savoir si l’inconnu qui n’en est plus un, s’éloigne trop de son domicile. Mais c’est une vidéo familiale qui va attirer toute l’attention d’Edward, l’homme est avec son fils.
« le Père essayait de lire quelque chose mais le gosse passait son temps à gigoter. Le micro interne de l’ordinateur captait son petit rire, et j’étais là à l’écouter … L’enfant s’est redressé…Le père a regardé directement vers la webcam de l’ordinateur. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir le sentiment que c’était moi qu’il regardait. Je me suis soudain rendu compte que je retenais mon souffle… »
Snowden raconte qu’il a fermé brutalement sa session, et s’est précipité vers les toilettes. S’il fallait être convaincu, il l’était définitivement. L’intrusion de son service dans la vie privée de chacun n’était pas un fantasme. Il le savait déjà depuis longtemps. Il était dévasté.
Tout dans cette scène lui rappelait son histoire à lui. Une histoire qui lève le voile, mieux, démystifie le fonctionnement d’un service perçu jusque-là comme le symbole de l’hyper-puissance. L’aspirant Snowden, le futur recruté parle des hôtels misérables qu’il a fréquentés tout au long de sa formation. Un jour, un escalier va même s’effondrer et sa réclamation portée par lui aux autorités lui vaudra un rappel à l’ordre bien senti. Snowden va vivre la condition de nombre d’employés de la NSA : être un « Homo contractus ».
L’État 2.0 sous-traite massivement ses tâches à des sociétés privées, accuse l’auteur. De sorte que l’agent, « loin d’être un fonctionnaire assermenté, est un travailleur temporaire, dont le sentiment patriotique est motivé par le salaire… Le gouvernement fédéral représente moins l’autorité suprême qu’un gros client ». La foi dans la cause en prend ainsi un rude coup aux yeux du jeune homme.
Et pourtant, Il y a bien cette séance d’endoctrinement qui sera l’une des étapes de ce qui peu à peu devient une odyssée. « Elle visait à nous faire comprendre que nous étions l’élite, grince Snowden. Et d’ajouter, « rien ne rend aussi arrogant que le fait de passer sa vie à superviser des machines dépourvues de sens critique… On finit par s’en remettre à sa tribu, plutôt qu’à la loi. »

Voilà pour le cadre selon l’auteur/acteur de l’histoire. Mais il reste à découvrir le personnage de l’ombre, surnommé Frankenstein par Snowden.
Et c’est à Tokyo cette fois que se transporte le récit. Un mystérieux rapport atterrit sur le bureau du jeune administrateur système en place dans la capitale japonaise. Il contenait « les programmes de surveillance les plus secrets de la NSA… Il décrivait des manœuvres si foncièrement criminelles qu’aucun gouvernement ne pouvait le rendre public sans l’avoir expurgé au préalable ». De fait, Snowden a sous les yeux le dispositif de « la collecte de grande ampleur » de la NSA, le Frankenstein de « la surveillance de masse ».
Et défilent les acronymes de la grande machinerie qui observe, écoute, enregistre tout un chacun, du plus petit au plus grand nombre…
« Il y a PRISM qui permet à la NSA de collecter les données auprès de Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, You Tube, Skype, AOL, et Apple… » Il y a Upstream Collection, qui grâce à TURBULENCE collecte des données, cette fois sur les infrastructures d’internet. « L’une des armes les plus puissantes de la NSA », affirme Snowden.
L’idée de lancer l’alerte va bientôt s’imposer au jeune homme. Mais comment faire dans ce lieu du virtuel où chaque geste laisse une trace indélébile, pour sortir les documents accusateurs ? Un vieil ordinateur, des cartes SD habituellement réservées pour le stockage des photos, feront l’affaire. Le wistleblower va méthodiquement capturer des images par milliers, et attendre, attendre encore et toujours que les cartes se remplissent peu à peu de ses pièces à conviction. Ultime procédé utilisé, les facettes du fidèle compagnon de Snowden, un Rubikscube, idéal pour héberger les cartes SD… On connait la suite.
A Hong Kong celui qui est alors devenu un défecteur a donné rendez-vous à des journalistes. Non sans malice, Snowden affirme que ces derniers sont souvent prêts à tout pour un scoop, mais qu’ils ne comprennent rien à l’informatique. Or, son scoop, c’est de l’informatique. D’où l’impérieuse nécessité d’être pédagogue. Et c’est d’une chambre d’hôtel que les vagues du grand scandale ont déferlé. Devant la télé Snowden fut le premier spectateur de ce qu’il avait provoqué. Satisfaction mais aussi et surtout angoisse. Désormais, le monde ne pourrait plus dire, comme la célèbre formule le martèle, « on ne savait pas !». Les réactions furent innombrables.
Pour ne parler que d’eux, les services français furent eux aussi effarés par l’ampleur de l’intrusion américaine. De fait, les affirmations du lanceur d’alerte avaient été vérifiées. Un responsable du renseignement partit rencontrer la chefferie de la NSA. On affirma que l’on ne recommencerait plus. Entre amis cela ne se fait pas, leur avait dit l’émissaire français. Ce dernier eut droit à la visite d’un lieu là encore stupéfiant. Une salle énorme, aux murs couverts d’écrans de télévision. « Vous voyez, lui a dit son guide, ici on peut observer le monde… Et où est la France ? interrogea le visiteur… Il eut pour toute réponse : Ah ça…. (silence).
L’autre livre: « L’utopie déchue ». Cette fois, le miroir prend des allures de « Retour vers le futur ».
Avec « L’utopie déchue » parue chez Fayard, Félix Tréguer, le voyage s’inscrit dans le temps. Il visite l’utopie d’internet.
« Pour une génération entière Internet s’est donné à penser comme une force historique capable de démocratiser la liberté d’expression, de promouvoir la transparence des institutions, de s’édifier en bibliothèque universelle… Pourtant ce projet émancipateur a été tenu en échec », affirme l’auteur qui rejoint ainsi Snowden dans son constat. Et l’ouvrage d’interroger « comment en est-on arrivé là ? ».
Nous voici propulsés en 1440. Un certain Johannes Gutenberg vient d’inventer l’imprimerie « typographique à caractères mobiles métallurgiques ». Tréguer est homme de précision. Très vite le procédé apparaît comme « instrument de contestation politique » affirme l’auteur. Mais les monarques européens ne vont pas rester sans réaction. Une notion va permettre la remise en ordre qui, à leurs yeux, s’impose : la raison d’État. C’est ainsi que la censure pourra s’appliquer. La révélation d’éventuels secrets d’État par la chose imprimée étant qualifiée de crime de lèse-majesté. Or le secret va devenir années après années, une « véritable obsession pour les théoriciens de la raison d’État qui tentent de refonder les arts de gouverner ».

Voilà qui n’est pas sans évoquer nombre d’actuels débats concernant Internet, les médias et la fameuse question de la transparence. Car à l’époque déjà, les tenants du « secret » tiennent là un moyen redoutable. Il assure stratégiquement « la prééminence de l’État face aux pouvoirs concurrents ». Il revêt une fonction d’efficacité, en permettant « au pouvoir monarchique d’échapper à l’impératif de justification ».
Savoir, pouvoir, police. Tréguer s’appuie sur les travaux du philosophe Michel Foucault dans son écriture de contre-histoire. Selon l’auteur, ce travail « archéologique » éclaire la situation que nous connaissons aujourd’hui, à savoir, toujours selon Tréguer, l’échec de l’utopie numérique.
Cette dernière n’aurait pas échappé aux problématiques de puissance/surveillance. « La gouvernance par les données sert de nouveau mode de gouvernement, dit-il, les protections juridiques associées à l’État sont tendanciellement dépassées, la technologie informatique continue sa marche en avant au service du pouvoir. »
Et le chercheur historien de conclure sur un constat des plus amers. Les premiers hackers – bonjour Snowden – ont fondé beaucoup d’espoir sur un découplage entre pouvoir et technologie, constate l’auteur. Mais le grand jour se fait désirer.
Tréguer écrit : « si l’on admet qu’il n’adviendra pas dans un futur proche, alors il est urgent d’articuler les stratégies classiques à un refus radical opposé à l’informatisation du monde ». Bref, il faudrait « arrêter la machine ».
Et que dit Snowden, lui qui a déjà d’une certaine manière tout arrêté ? Comment, nous, simples utilisateurs, pouvons-nous résister à ce pouvoir que les deux livres décrivent comme un Moloch invincible ?
« Crypter !» lance Snowden. En quelque sorte retourner l’arme informatique contre celui qui veut en assurer l’absolu contrôle. « Celui qui a la clé a tous les pouvoirs » assène le réfugié de Moscou.
C’est notre meilleur espoir de lutter contre la surveillance, conseille le jeune homme.
Alors tout arrêter, ou tout crypter ?
L’alternative en deux livres, de notre miroir de papier ne semble guère supporter l’atermoiement. Face à l’État d’urgence numérique, il faudra bien décider quelque chose, sans se borner à la stricte fonction du miroir moquée par Cocteau : trop réfléchir.
ONA 2019 : Le métier de futuriste de l’info expliqué par Amy Webb
Par Nathalie Gallet, France Télévisions, MédiaLab
Amy Webb, ex-journaliste et depuis des années futuriste des médias d’information, a donné samedi à la Nouvelle Orléans sa 12ème et dernière présentation — toujours très attendue à l’ONA– des tendances tech pour le journalisme.
Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur son métier
- Amy Webb, pourquoi avoir choisi ce métier de futuriste ?
- Quelles sont les trois qualités essentielles pour être futuriste ? (0’55)
- Comment faites-vous ressortir ces tendances ? (1’40)
- Que répondez-vous aux sceptiques du futurisme ? (2’55)
- Et vous croyez-vous au futur ? (4’12)
Botbuster existe, nous l’avons rencontré
Par Pascal Doucet-Bon, France Télévisions, directeur délégué de l’Information
« N’écrivez jamais « C’est un bot » sans avoir vraiment examiné l’activité d’un compte. Vos confrères se trompent 4 fois sur 5″
Il a des faux airs de Dan Aykroyd, (acteur principal de Ghostbusters ndlr) Andy Carvin (@acarvin) est directeur de recherche au dfr lab de Washington DC. Les bots, il les traquent et les étudie toutes la journée. Rappelez-vous, c’est lui qui a couvert le Printemps arabe depuis les Etats-Unis via Twitter.

Son propos, lors de l’ONA 2019, consistait à nous sortir de la paranoïa sans pour autant baisser notre vigilance. « Oui, les bots sont utilisés pour désinformer et pour harceler, mais l’être humain n’est pas à court d’imagination pour faire cette besogne lui-même. Ne voyez pas des bots partout. Ce n’est pas parce qu’un compte Twitter, par exemple, n’a que deux ou trois followers et ne suit presque personne qu’il s’agit d’un bot. Des harceleurs peuvent créer eux-même un compte pour vous attaquer, et demander à tout leurs amis de faire de même. Pas besoin de technologie pour cela ».
OK, mais on fait comment ?
Carvin a créé une nomenclature. Une liste de critères dont aucun n’est suffisant à identifier un compte comme étant celui d’un bot.
1 Haut niveau d’activité
« Bien sûr, c’est un indice. A partir de 70 tweets et retweets par jour, le compte est suspect. Mais attention ! » Andy Carvin nous montre un compte dont il a flouté la photo et l’identifiant. L’activité indique 120 tweets. Devinette : « Bot ou pas bot » ? Nous disons bot. « Non, c’est mon propre compte ! Mon métier m’amène parfois à une frénésie de tweets. C’est aussi le cas de nombreux journalistes ou activistes, par exemple. »
2 Anonymat
Le chercheur nous expose des comptes anonymes. Pas de photos, des identifiants sous forme de longues séries de chiffres et de lettres. »Bot ou pas bot ? » Certains le sont, d’autres pas. Certains sont passés maîtres dans l’art de se cacher tout en s’exprimant, pour le meilleur ou le pire.
3 Amplification (tweets monétisés)
Certains bots sont créés pour amplifier la monétisation d’un compte.
4 Pas de photo
Voir 2
5 photo volée ou reproduite un grand nombre de fois.
Tweetonomy ou Google photo permet de vérifier cela. C’est éventuellement suspect.
6 Opérations suspectes (au regard des règles de Twitter)
7 Le compte tweete dans plusieurs langues.
Les plurilingues existent. Et ils sont surreprésentés sur Twitter. Mais ça peut être un indice de bot
8 Un compte liée à des automates
Certains journalistes en utilisent
9 Un compte qui tweete nuit et jour.
Andy Carvin nous montre l’activité d’un compte qui ne s’arrête que 4h30 par nuit en moyenne. Certains bots sont effectivement programmés pour ralentir leur activité la nuit. En l’occurrence, le compte exposé est celui… de Donald Trump !

10 détournement de hashtag
Oui, l’usage de hashtags qui n’ont rien à voir avec le sujet du message est un indice. Mais de nombreux tweetos le font couramment pour tenter d’augmenter leur trafic.
Au final, il faut qu’un compte suspect coche au moins cinq de ces cases pour être considéré comme suspect et signalé à Twitter. Voilà pour le cas où vous avez ciblé un compte suspect.
Si vous chassez un réseau de bots sans tenir un « suspect », voilà ce qu’il faut chercher:
1 modèle de langage
Si une expression ou une tournure de phrase peu idiomatique apparaît puis revient très souvent dans un laps de temps court
2 des posts ou tweets identiques
3 opérations suspectes (au regard des règles de la plateforme, déjà cité plus haut)
4 dates et heures de création identiques
5 activités identiques
6 lieux de création
Si un des comptes très similaire est créé dans des lieux très éloignés des autres
« Si plus de trois critères sont remplis, alors vous tenez certainement un réseau de bots », affirme Andy Carvin.
Pour finir, voici l’histoire de Mariangela Pereira B17, une supportrice passionnée de Jaïr Bolsonaro.
Un magazine brésilien a qualifié ce compte de robot. Voici ce qu’a répondu Mariangela :

« Pour le magazine Veja, je suis un robot. Pour prouver que ce compte est à moi, aujourd’hui le 6 avril, [j’apparais]. Nous sommes avec vous. Et je ne suis pas un robot. Je suis juste une Brésilienne comme 57 millions d’autres qui ont soutenu notre capitaine »
Veja a présenté ses excuses à Mariangela Pereira. A-t-elle souri en les lisant ? Nul ne peut le savoir. La dame pieuse, comme l’ont prouvé plusieurs chercheurs dont Andy Carvin, est un cyborg. Un bot capable de se défendre d’être un bot !
Et si, demain, entre bots et deepfakes, l’identité numérique ne pouvait plus être garantie pour personne ?
Les tendances Tech 2020 pour le journalisme
Par Nathalie Gallet, France Télévisions, MédiaLab
Devant une salle évidemment comble ce week-end à La Nouvelle Orléans, Amy Webb a donné sa fameuse présentation annuelle sur les tendances tech pour le journalisme. Sa 12ème. Et dès les premières minutes elle nous prévenait d’une surprise à la fin … Teasing pour rester jusqu’au bout ?
A l‘ONA, la conférence américaine du journalisme en ligne, la futuriste a l’habitude de nous préparer à affronter l’avenir. Elle nous surprend. Nous effraie. Et surtout nous alerte. Comme tous les ans le public présent dans la salle se demande à quelle sauce Mrs Webb va le manger !
A quoi donc pourra ressembler le futur du journalisme dans 20 ans ?
« Pourra » car Amy Webb l’annonce précautionneusement à chaque fois, elle n’est pas là pour donner la bonne aventure ou faire une réponse sans appel à la question : « que va-t-il se passer dans le futur ? ». Et dès l’intro et les beignets bien sucrés locaux offerts (pour leur excès de sucre qui allait nous servir durant la séance, a-t-elle assuré), nous pouvions deviner que cette édition des «Tech Trends 2020» allait être savoureuse :
Teaser:
So so so … quel programme !
Amy et ses équipes construisent avec méthode des scénarios possibles, plausibles, probables… Il faudra à l’audience de l’agilité, de la flexibilité et une adaptabilité constante pour remanier les scénarios afin de se rapprocher le plus possible du futur qui se réalisera.
Pourquoi ? Pour pouvoir réagir et construire le réel avenir du journalisme.
109% d’augmentation des tendances tech entre 2018 et aujourd’hui.
Première surprise : 157 tendances et 28 scénarios sont dans le rapport des tendances tech 2020. Mais n’ayez crainte : ni Amy Webb pendant la conférence, ni Méta-Média ici, ne vous énonceront les 157 + 28 items ! (vous pouvez télécharger le rapport en suivant ce lien).
En revanche l’explication pour arriver à ce résultat est intéressante car les chiffres ont augmenté de 109% depuis 18 mois.
Pourquoi ?
Amy Webb avance : « La raison est qu’il y a eu des changements critiques dans de nombreux domaines différents au cours de 18 mois environ ».

Les principaux facteurs qui sont utilisés pour trouver les tendances ont évolué rapidement : politique, climat, société, accélération de la recherche technologique, économie … et cela a conduit a plus de scénarii possibles.
Par exemple l’adoption des interfaces et enceintes connectées Google Home, Alexa, etc… par une large majorité du marché en peu de temps. Amazon a cassé les prix de son produit « Alexa » en le rendant ainsi accessible à beaucoup plus de personnes. Cet outil et son installation dans tant de foyers implique de nouveaux usages et de nouveaux usages impliquent des scénarii d’avenir supplémentaires.
Amy Webb : « Nous avons aussi commencé à voir des signes d’intervention gouvernementale très sérieuse, de sorte que dans ce pays (NB : aux Etats-Unis), nous envisageons des mesures réglementaires qui n’existaient pas il y a peut-être un an et maintenant, des enquêtes antitrust sérieuses sont en cours, ce qui a commencé à avoir un effet d’entraînement dans d’autres domaines technologiques et dans les tendances. »
Elle nous explique encore que les nouveaux modèles d’abonnements numériques s’ajoutent à l’équation.
Les nombreux éclairages que la professeure à la NYU Stern School of Business nous apportent ici permettent de comprendre à quel point le métier de « futuriste » doit manier de nombreuses données pour tenter de « désobscurcir » l’avenir.
Plongeon dans le millésime 2020
Il en ressort 3 grands thèmes, regroupant eux-mêmes plusieurs tendances faisant plusieurs scénarios… Ce sont des poupées gigognes.
1L’ère du synthétique
Amy Webb : « L’ère des médias synthétiques est à nos portes. Nous y sommes. Les tendances liées à ce thème ont trait à la reconnaissance des gestes, à la synthèse de la parole et à bien d’autres choses que nous allons vivre. »
Les technologies se développent en matière de robots conversationnels, création ou modification de visage numérique, modélisation de la voix.
- On a commencé par créer des personnages totalement « imaginaires » qui vivent sur internet. Qui ont des interactions avec des internautes. Ils n’avaient pas de visages.. juste de la conversation.
Souvenez-vous de Xiaoce. Lancé par Microsoft il y a quelque année c’était un chatbot dont beaucoup de chinois sont tombé amoureux !
- En parallèle les « effrayants » deepfakes sont arrivés.
Ces technologies sont utilisées à des fins diverses comme cette vidéo du « Saturday Night show » où Bill Hader fait une imitation de Arnold Schwarzenegger alors que son visage se transforme en même temps que l’imitation en celui d’Arnold Schwarzenegger lui-même. Ou encore David Beckman qui parle plusieurs langues dans un spot publicitaire d’intérêt public contre la malaria.
Puis enfin il y a la modélisation de la voix. Avec quelques échantillons de voix d’une personnes certaines entreprises réussissent à recréer une conversation vocale totalement inventée. Mieux encore, des avancées sont faites sur la traduction avec une voix d’une langue maternelle vers une autre langue, tout en gardant les bonnes intonations et, bien sûr, l’identité vocale de départ.
Vous parlez français et demain, vous parlerez espagnol sans même l’avoir appris ! Votre voix le fera en tout cas.
Aujourd’hui, toutes ces technologies combinées donnent par exemple Miquela Souza, jeune avatar de 19 ans, star d’Instagram.

Mais ce qui est important c’est que demain, les consommateurs d’informations passeront leur temps avec des personnages numériques.
Et après nous en avoir donnés plusieurs autres exemples déjà « existants », Amy Webb lance : « À qui appartient les médias synthétiques ? Je ne sais pas. Qui en est responsable ? Quand est-il éthique de les utiliser ? Devriez-vous les financer ? Est-ce que les lois de la parole d’un pays régissent à la fois les Humains et les contenus synthétiques de la même manière ? Que se passe-t-il s’il existe des normes différentes pour les médias et les plateformes technologiques ? Si un système d’IA à l’avenir commence à générer des personnages synthétiques et que tous ces personnages commencent à faire du mal aux gens d’une manière ou d’une autre, alors qui est responsable ? Comment définir la vérité et bâtir la confiance à l’ère des médias synthétiques ? »
Cela a tout l’air d’un bombardement ! En tout cas une promesse de vives discussions dans les rédactions !
D’autant que la conférencière n’a rien pour nous rassurer.. sauf à dire qu’il nous faut lire tout ce que nous trouvons sur le sujet pour nous y « acclimater ».
2La notation comme un big brother
Cela sonne comme une nouvelle dont nous avons déjà connaissance, mais pour laquelle nous jouons tous plus ou moins les autruches.
Combien de fois avez-vous dit ou entendu dire autour de vous que c’était incroyable car toutes vos recherches internet donnent des résultats qui rappellent ce que vous avez fait récemment sur votre ordinateur ? Que les articles qui vous sont proposés ressemblent à ce que vous avez déjà cherché etc etc… Avec le cloud ou les comptes que vous ouvrez sur n’importe quel device, c’est même vrai d’un appareil sur l’autre. Vous avez le sentiment d’être suivi partout et pour tout !
Pour autant, arrêtez-vous vos usages ? Vous protégez-vous en tentant d’utiliser un navigateur plus « privé » ? Faites-vous quelque chose ?!
Et bien vous voilà noté.. à tous les coins du net mais aussi à tous les coins « des webcams » ou même de wifi, de GPS, enceinte connectée etc…

Amy Webb : « AirBnB vous donne un score et cela peut signifier que vous n’êtes pas autorisés à gérer certains types de propriétés. Walmart vous donne une note pour déterminer si vous devez payer 9 dollars ou 3 dollras pour du papier hygiénique. »
Tous récupèrent vos données en temps réel et les filtrent, les optimisent. Est-il possible que le web vous connaisse mieux que votre propre entourage !
Aujourd’hui Amazon travaille sur un projet de détection de mouvement. Avec des données biométriques et vocales. Ces systèmes pourraient déterminer si on éternue normalement ou pas. Si c’est à cause d’un rhume ou d’une autre maladie. Au débit et la tonalité de la voix, savoir si nous sommes dépressif …
Plus surprenant que tout, les chaînes de magasins Walmart (supermarchés américains) ont développé des technologies presque incongrues pour leurs services d’origine : les caddies des courses sont «équipés de systèmes biométriques ». En posant vos mains sur la barre pour pousser votre chariot, il prend votre pouls, votre température et détecte votre transpiration. Le tout est envoyé dans un centre qui permet d’envoyer un agent si vous vous évanouissez. C’est de la biométrie comportementale.

N’oublions pas la reconnaissance faciale, l’utilisation des webcam pour savoir ce que vous faites, ce que vous avez chez vous, quel style de journal, quels styles de meubles etc etc …
La récolte de données semblent être aussi vertigineuse que remplir le tonneau des danaïdes.
Au-delà de tout ce que ces systèmes génèrent comme inquiétudes, il y a les injustices probables qui peuvent en découler. Ces notations peuvent être biaisées, trompeuses, fausses. Comment faire alors pour remettre les choses à plats ? contre qui devons-nous nous défendre ?
Et c’est reparti pour un flots de questions toutes aussi pertinentes et effrayantes les unes que les autres mais auxquelles nous allons devoir absolument faire face :
Amy Webb : « Comment ces données vont façonner notre avenir ? Comment les notations extérieures impacteront notre habilitation à voir les contenus des médias ? Quel sera l’impact de l’évolution des scores sur la publicité programmée ? Les journalistes ont-ils la responsabilité d’aider les gens à comprendre comment ils sont notés ? »
Et de nous inviter à bien réfléchir à ce futur déjà en marche.
3Fin des abonnements numériques
Nous avons l’impression qu’il vient de débuter, mais en réalité, aux Etats-Unis, le marché des abonnements numériques est arrivé à maturité. En faisant des analyses sur 90 journaux locaux, Sam Guzik (collaborateur d’Amy Webb) est venu nous expliquer que la pénétration moyenne était de 28%. Les ménages américains qui soutenaient jadis leur presse locale à 100%, dépensent maintenant en moyenne 100 $ mensuel pour une flopée de services différents et non pour leur seule presse. Et l’argent qu’ils sont prêt à mettre dans des abonnements n’est pas extensible. Il est même plutôt en régression.

Amy Webb a évoqué un critère qui détermine ce que souhaitent les consommateurs, le LPF : « Lowest Point of Friction ». Et après étude du marché américain, ce que les ménages souhaitent notamment c’est de la facilité et de l’accessibilité.
En découlent l’avalanche de questions devenue rituelle de la conférencière. Cette avalanche essentielle pour rendre compte des difficultés subsistantes pour résoudre l’équation d’un modèle économique viable pour le journalisme :
Amy Webb : « Sommes-nous en train de créer un déséquilibre dans la façon dont les différentes communautés sont informées ? Qu’est ce qui différencie votre produit de tous les autres auxquels on nous demande de souscrire ? Comment faire de l’argent si vous ne contrôlez pas les données ? Quelles sont toutes les autres manières dont vous pourriez générer des revenus qui vont au-delà des abonnements et des événements ? »
Conclusion en forme d’adieu
« L’incertitude salue l’incertitude qui justifie des questions profondes, mais elle justifie aussi une action bien informée. Des mesures incrémentielles prises tout le temps. Parce que ne pas planifier en pensant à l’avenir, c’est planifier pour échouer. »
Mais comme pour se faire pardonner de quelque chose, elle a enchaîné sur une note positive : nous avons eu le droit aux 4 scénarios préférés de la professeure. Mais franchement.. était-ce simplement pour nous quitter en bon terme ?
- Retour de la confiance
- Les informations se font à un rythme plus lent. Les journalistes ont le temps d’enquêter.
- L’information est devenue lucrative
- Toutes les rédactions ont embauchés des futuristes
- Et la surprise ??? Amy Webb nous annonce la fin de ses apparitions exposant les tendances Tech à l’ONA …

So standing ovation ! Good bye and thank’s Madame Amy Webb, vous, la visionnaire qui sait se retirer au profit d’une jeunesse montante, pour que les trends soient toujours les plus pointues possibles pour mieux servir votre auditoire.
Chapeau bas et Merci !
ps : lien de la vidéo de sa présentation samedi
Désinformation, « la mère de toutes les batailles »
Par Pascal Doucet-Bon, France Télévisions, directeur délégué de l’Information
Les fake news se propagent vite
A l’ONA 2019, personne ne nie que la première bataille de la désinformation a été perdue. Tant aux Etats Unis qu’au Brésil ou en Grande-Bretagne, les campagnes électorales et référendaires ont fait l’objet d’une désinformation massive que la presse n’a pas su contrer. Les fake news se propagent vite, et nous sommes lents.
« En 10 ans, assure la journaliste spécialisée de Buzzfeed News Jane Lytvynenko, le nombre d’Etats impliqués dans la désinformation délibérée a doublé. Il faut y ajouter les activistes de tous bords, mais aussi les bonnes vieilles rumeurs viralisées à dessein (ou pas) ». « La désinformation d’origine religieuse sur les médicaments, par exemple, est devenue massive dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie du sud », affirme Michael Edison Hayden, enquêteur du Southern Poverty Law Center
Des médias aveugles et sourds ?
Autre constat largement partagé : la question de la détection des fakes news et des images trafiquées est au moins aussi cruciale que les techniques de « debunkage ». Il ne sert presque à rien d’embaucher une armée de vérificateurs si vous ne savez pas qu’une vidéo bidon est en train de tourner sur une messagerie communautaire comme WhatsApp.
« 400 millions d’Indiens ont acquis leur premier smartphone ces trois dernières années, et ont adopté immédiatement WhatsApp, explique Shalini Joshi, spécialiste de la vérification au sein de l’ONG ICNJ. « Les rédactions ne peuvent pas savoir quelles rumeurs, fake news ou images contrefaites s’y répandent ».

Crédit photo : Shalini Joshi
« L’une des raisons pour laquelle certains de ces gens utilisent WhatsApp, c’est parce que cette messagerie est cryptée », ajoute Joan Donovan, directrice du Technology and Social Change Project à Harvard Kennedy school. « C’est une population qui ne fait de toutes façons pas confiance aux rédactions, et qui se dit en défiance de tous les pouvoirs ».
Tai Nalon, directrice d’Aos fatos, plateforme brésilienne de fact checking (@aosfatos), renchérit : « WhatsApp est la deuxième source d’information des Brésiliens derrière Facebook. 87% d’entre eux disent faire plus confiance à leur communauté qu’aux médias. »
Je connaissais déjà ce phénomène grâce à Méta-media, mais la multiplication des chiffres vertigineux fait frémir. Ce qui m’a le plus frappé, dans la bouche de journalistes compétentes et chevronnées, c’est l’absence de solution, même théorique.
« Quoi que nous fassions, avoue Jane Lytvynenko (Buzzfeed news), ceux qui tournent le dos au journalisme « de qualité » ne nous croirons jamais ». « Ce n’est hélas pas pour eux que nous travaillons » ajoute Nadine Ajaka, responsable de la plateforme video du Washington Post, spécialiste de la détection de fausses vidéos.
La riposte s’organise
Tout n’est pas perdu. Les médias, du moins ceux qui en ont les moyens, se sont structurés pour détecter la désinformation quand c’est possible (pas sur les messageries fermées, donc). Si quelques rares comités de direction tentent de responsabiliser et de former tous leurs journalistes sans service spécialisé, presque tous les managers rencontrés disent avoir fait le choix d’équipes dédiées à la vérification, l’image fixe ou animée étant considérée comme le domaine les plus sensible.
Reuters a embauché Hazel Baker, venue de Skynews, pour créer une équipe de douze personnes capables de vérifier et le cas échéant de débunker 24 heures sur 24 tous les contenus extérieurs à l’agence (l’UGC, User Generated Content). Hazel tend même des pièges à son équipe.
Jane Lytvynenko est elle-aussi spécialisée. Ils sont deux à travailler exclusivement sur la désinformation chez Buzzfeed News : « les médias sont désormais bien organisés pour détecter les fausses nouvelles. Alors, plutôt que de traiter chacune d’entre elles, nous nous concentrons maintenant sur des papiers d’investigation sur ceux qui fabriquent la désinformation. Celle-ci n’est pas toujours le fait de grandes organisations qui pratiquent ce que nous appelons le « terrorisme social ». Elle peut relever d’une forme de délinquance de masse. La monétisation peut rapporter gros ».
L’union fait la force
L’équipe vidéo du Washington Post a tenté de créer un nomenclature des vidéos contrefaites. A voir absolument. C’est de loin le travail le plus synthétique et éclairant pour former les rédactions.
« Notre but est de susciter une grammaire commune à tous les médias de bonne volonté ainsi qu’au monde de la recherche », explique Nadine Ajaka.
Bien sûr, le réseau Crosscheck, dont fait partie France Télévisions, est souvent cité en exemple à l’ONA. Dans une moindre mesure, beaucoup savent que l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER) tente aussi de fédérer ses membres autour de la lutte contre la désinformation. Y a-t-il un risque de créer un journalisme labellisé, officiel, qui énerverait encore plus les conspirationnistes de tous poils ?
« Oui, mais le danger est trop grand, répond Shalini Joshi. En Inde, les désinformateurs veulent nous éradiquer. Nous devons les combattre de toutes les manières possibles, puisque les plateformes de nous aident presque pas ».
Et voilà, pour finir, l’autre grand consensus de l’ONA2019 : de l’avis général, les plateformes ont bougé, mais pas assez. Elles doivent passer des promesses aux actes. Bien sûr elles étaient présentes à l’ONA 2019, mais elles n’ont pas participé aux débats.