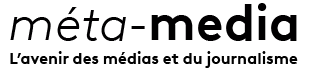From left to right, screenshots from the accounts of: Dylan Page, UnderTheDeskNews, and Salomé Saqué
EBU News Report: Diriger une rédaction à l’ère de l’intelligence artificielle générative
Ce n’est pas la première fois que les médias affrontent une révolution technologique. Mais cette fois, le cœur même du métier est en jeu. L’essor de l’intelligence artificielle générative bouscule la production, la hiérarchisation, la distribution et même la légitimité de l’information. Derrière les expérimentations techniques menées dans les rédactions européennes, un changement de paradigme s’opère : l’IA ne se contente pas d’automatiser, elle redéfinit les rôles, déplace le pouvoir, et interroge la place du journaliste dans l’espace public.
Résumé par Kati Bremme, Rédactrice en chef Méta-Media
Le News Report 2025 de l’UER Leading Newsrooms in the Age of Generative AI dirigé par la journaliste Alexandra Borchardt offre une photographie précieuse de la manière dont les rédactions européennes – et au-delà – expérimentent, régulent et questionnent l’IA générative. Fruit de 20 entretiens approfondis, il met en lumière à la fois les avancées concrètes, les impasses stratégiques et l’urgence d’un dialogue équilibré avec les géants de la tech.
« If we lose control of the news, we are toast. »
Un membre du comité exécutif de l’UER cité dans l’introduction du rapport
Le journaliste comme créateur de sens
Après l’enthousiasme initial suscité par ChatGPT et ses pairs, les rédactions ont ralenti. Selon le rapport, la phase actuelle est marquée par « un esprit de réalisme ». Comme le résume Jyri Kivimäki de Yle : « Très souvent, mon travail consiste à trouver un juste équilibre entre les attentes et la réalité. » Les usages se sont stabilisés autour de la traduction, de la transcription, du sous-titrage ou encore de la personnalisation de contenus. Mais les ambitions plus créatives ou éditoriales restent limitées. Les craintes liées à l’exactitude, à l’opacité des modèles et à l’impact sur la confiance des audiences freinent des projets exposés au grand public.
L’émergence de modèles capables de générer des textes, de synthétiser des discours ou de reformuler des dépêches remet en question la légitimité du journaliste comme producteur exclusif de contenus. Cette automatisation, loin de le rendre obsolète, impose une requalification de sa mission. Désormais, ce n’est plus tant la création de contenu qui définit sa valeur que la capacité à en extraire du sens, à articuler les faits, à poser un regard critique. Le journaliste deviendrait alors “créateur de sens”. L’IA générative ne remplace les journalistes, elle les déplace. Elle les pousse hors de leur zone d’exclusivité – la production de contenu – pour les recentrer sur une fonction plus complexe, plus stratégique : la fabrique de sens.
Cette inflexion se vérifie dans les pratiques internes des rédactions les plus avancées. Chez CBC, par exemple, l’AI Project Accelerator a permis de tester des outils non pas pour remplacer les journalistes, mais pour enrichir leur processus de raisonnement. L’IA devient ici un catalyseur d’analyse, un outil pour questionner la structure d’un récit ou simuler des hypothèses. Même logique en Suisse, où la RTS a conçu « BakerStreet », un assistant capable, entre autres, de suggérer des angles alternatifs à partir d’une actualité brute. Utilisé au quotidien par les journalistes, l’outil est perçu non comme une menace, mais comme un levier d’enrichissement éditorial. À Sveriges Radio, son équivalent suédois a été rebaptisé « Vinkelkompisen », l’ami des angles éditoriaux et de la diversité d’opinions. Et la NPO, aux Pays-Bas, utilise un « focus group d’avatars » pour s’assurer que son journalisme intègre une large diversité de points de vue.
« (…) Nous allons devoir passer du rôle de créateurs et de curateurs de contenus à celui de créateurs de sens. Il nous faut devenir plus constructifs et encourager la confiance et l’optimisme. »
Anne Lagercrantz, directrice générale de la SVT
Cette évolution ne se résume pas à un changement d’outil : elle transforme le positionnement professionnel. Dans toutes les rédactions interrogées, ce glissement est palpable. Les journalistes ne sont plus seuls à résumer un événement, formuler un titre ou proposer une accroche. Les outils génératifs le font en quelques secondes, souvent avec une qualité suffisante pour un usage interne. Le rôle du journaliste glisse vers celui de curateur intelligent, capable de sélectionner des données générées, de détecter des biais, de contextualiser une information dans un paysage mouvant. Comme le résume Minna Mustakallio, responsable de l’IA responsable à Yle : « Les gens ne se préoccupent pas réellement de l’IA. Ils réclament un meilleur journalisme, de meilleurs médias, quelque chose qui améliore leur vie. Nous devons donc prendre du recul et réfléchir à ce qui a réellement du sens. »

La désintermédiation de l’actualité par les moteurs IA
Pour la première fois dans l’histoire, les moteurs de recherche eux-mêmes sont en train de devenir des producteurs éditoriaux, prolongeant en partie le mouvement amorcé par les réseaux sociaux, passés du partage à la création de contenus. Les outils comme Perplexity ou la Search Generative Experience de Google construisent des réponses, synthétisent les sources, éditorialisent l’information sans intervention humaine, bouleversant le rôle classique du journaliste comme intermédiaire entre le savoir et le public.
Cette rupture est identifiée par plusieurs responsables interrogés. La dynamique d’accès à l’information bascule : l’utilisateur ne cherche plus une source fiable, mais une réponse synthétique à une requête formulée en langage naturel. Non seulement les contenus y sont exposés à des risques d’appropriation, mais leur origine devient de moins en moins visible pour l’utilisateur final. Un phénomène qui compromet la découvrabilité des contenus produits, mais aussi la capacité à contextualiser, éditorialiser et hiérarchiser l’information. Il représente une menace existentielle pour le rôle social du journalisme.
« Nous devons redoubler d’efforts pour défendre la cause du vrai journalisme. »
Olle Zachrison, SR
Dans ce nouveau contexte, les rédactions doivent repenser leur stratégie de visibilité. Produire pour des moteurs IA ? Adapter les formats à la recherche générative ? Ou réaffirmer la spécificité d’une expérience éditoriale humaine, construite dans la durée ? Aucun choix n’est neutre, tous impliquent des concessions. En parallèle, les journalistes doivent aussi « éduquer le public » à l’IA et plaider pour une information fiable. Pour reprendre les mots d’Olle Zachrison (SR) : « Nous devons redoubler d’efforts pour défendre la cause du vrai journalisme. »

L’apparition des agents autonomes et la menace sur le jugement éditorial
L’automatisation ne se limite plus à la génération de contenus. L’apparition d’agents IA capables d’agir selon des objectifs autonomes, de hiérarchiser l’information, de publier sans intervention humaine, marque un tournant plus profond encore. Ce sont les mécanismes de sélection, de timing, de titrage, de scénarisation qui pourraient être externalisés. Ce basculement appelle une réflexion de fond sur la souveraineté éditoriale. Qui contrôle la hiérarchie de l’information ? Comment garantir qu’un outil optimisé pour l’engagement ne devienne pas un accélérateur de biais ou de bulles de confirmation ? À l’échelle locale, certains outils d’automatisation du sport ou de la météo ont déjà montré leurs limites. Et à l’échelle politique ou sociétale, le risque est d’autant plus élevé.
« We don’t have to simplify everything for everybody”
Pattie Maes, Professor, MIT Media Lab
C’est pourquoi la quasi-totalité des rédactions interrogées insistent sur le maintien du « human in the loop ». Non comme simple superviseur technique, mais comme gardien d’un jugement éditorial collectif, ancré dans une culture, une éthique, une temporalité propre au journalisme. Mais avec un bémol que Felix Simon évoquait dans un article pour le Reuters Institute, cité dans le rapport: « La promesse des approches de type « humain dans la boucle » s’accorde difficilement avec l’argument central de l’IA : l’évolutivité. L’idée qu’un humain doive valider ou intervenir à chaque décision contredit fondamentalement le principe d’accélération ou de mise à l’échelle des tâches. »
Une dépendance stratégique aux fournisseurs d’IA qui fragilise les rédactions
La domination des GAFAM, renforcée par les batailles géopolitiques (Trump/Musk aux États-Unis, Xi/Alibaba en Chine), inquiète. Le lancement du modèle chinois DeepSeek a ravivé la compétition mondiale. L’UER appelle à des règles claires et à une régulation proactive. Elle propose un code de bonnes pratiques, basé sur 5 principes dont :
- Le Consentement explicite pour l’usage de contenus journalistiques dans les modèles.
- La Reconnaissance de la valeur des contenus d’actualité.
- La Transparence sur les sources générées.
Charlie Beckett, professeur à la LSE pose la question : « Si votre entreprise dépend de l’IA générative, que ferez-vous si, soudainement, son prix est multiplié par cinq ou si ses fonctionnalités changent du jour au lendemain ? » Anne Lagercrantz, directrice générale de la SVT (Suède), constate : « Nous gagnons en efficacité individuelle et en créativité, mais nous ne faisons aucune économie. En ce moment, tout est plus cher. » En effet, contrairement à certaines espérances initiales, le déploiement d’outils d’IA générative ne réduit pas les coûts opérationnels dans les rédactions. Pire : il génère souvent des dépenses supplémentaires (licences logicielles, formation, intégration, cybersécurité). Autrement dit : beaucoup d’efforts pour peu de retours mesurés. Faute de KPIs solides, les investissements IA ne sont pas encore des leviers stratégiques fiables, notamment dans les rédactions des médias de service public.

Kasper Lindskow, du groupe JP/Politikens Media, qui propose à ces rédactions un « clone de ChatGPT » ultracomplet, identifie trois groupes d’adoption de l’IA : entre 10 et 15 % du personnel qui sont des enthousiastes expérimentant de leur propre initiative, un autre petit groupe totalement désintéressé, et la majorité (entre 70 et 80 %) qui s’intéresse à l’IA et est prête à l’essayer. « De notre point de vue, l’élément le plus important pour déployer l’IA est de concevoir des outils adaptés à ce groupe, afin de garantir une adoption plus large », explique-t-il. Dans cette organisation d’environ 3 000 personnes, 11 personnes travaillent actuellement à temps plein sur le développement de l’IA au sein d’une unité centrale dédiée, en plus de deux doctorants. Robert Amlung, responsable de la stratégie numérique à la ZDF, déclare : « Le plus grand risque est que ceux qui utilisent l’IA ne sachent pas ce qu’ils font. (…) Ce que je crains le plus, c’est que les utilisateurs deviennent trop paresseux pour réfléchir. »
Repenser la connexion avec les audiences dans un univers intermédié par l’IA – en toute transparence ?
L’IA a démultiplié la capacité à produire du contenu. Cette abondance menace désormais de saturer les espaces informationnels et d’épuiser l’attention des audiences. Plusieurs responsables de rédaction observent une forme de lassitude chez leurs utilisateurs face à un flux ininterrompu d’informations parfois peu différenciées. La bonne idée serait donc de comprimer et synthétiser l’information ? Mais si tout est résumé de la même manière, on perd les nuances qui donnent du sens aux récits. C’est toute la construction d’une relation de confiance qui est en jeu.
Le lien entre journalistes et publics repose historiquement sur cette relation de confiance et de proximité. L’IA, en interposant des interfaces et en filtrant les contenus selon des logiques de pertinence algorithmique, risque d’affaiblir ce lien essentiel. Les audiences ne sont pas hostiles à l’IA, à condition qu’elle reste en coulisses. Les recherches du Reuters Institute montrent que les usagers tolèrent l’automatisation pour les résumés ou les traductions, mais refusent des avatars pour traiter de sujets politiques. Parfois même avec des réactions quelque peu virulentes : Jyri Kivimäki, de Yle, explique qu’ils ont dû repenser leur politique de transparence : « Nous avons commencé à étiqueter les résumés produits par l’IA, en indiquant aux utilisateurs que le contenu avait été créé avec l’aide de l’IA et vérifié par un humain. Et cela met nos lecteurs en colère. Si nous mentionnons l’IA, ils réagissent en disant : “bande de paresseux, faites votre travail. Peu m’importe ce que vous utilisez pour cela.” »
Se réinventer sans se renier
En filigrane du rapport, une ligne de fracture traverse le monde des médias : instrumentaliser l’IA pour plus d’efficacité ou la mettre au service d’un renouveau éditorial ? Le choix ne pourra plus être évité. L’UER insiste : l’IA doit rester un outil au service d’une ambition plus vaste – renforcer la relation avec les publics. Peter Archer (BBC) résume la ligne rouge : « What AI doesn’t change is who we are and what we’re here to do. » L’IA impose aux rédactions de revoir leurs fondamentaux : pourquoi publions-nous ? Pour qui ? Avec quelle plus-value spécifique face à des machines capables de synthétiser en quelques secondes ce que des journalistes mettaient des heures à produire ?
« Avec l’explosion de l’intelligence artificielle, nous assistons non seulement à une révolution technologique — la plus puissante de notre histoire — mais aussi à un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité »
Eric Scherer, directeur du News MediaLab et des Affaires internationales à France Télévisions et président du News Committee de l’UER
Loin d’être une menace fatale, l’IA générative pourrait donc être une opportunité historique de recentrer le journalisme sur sa mission première : apporter du sens, créer du lien, et défendre la démocratie dans un environnement informationnel saturé.
Pour télécharger le rapport complet : Leading Newsrooms in the Age of Generative AI
Ou écoutez le podcast avec Laurent Frat, qui reçoit Olle Zachrison et Alexandra Borchardt 🎧⬇️
Et pour finir, les points les plus saillants du rapport (selon l’avis de NotebookLM de Google, et on est plutôt d’accord avec la sélection) :
- La transformation fondamentale du rôle du journaliste, passant de créateur et curateur de contenu à « créateur de sens » (« meaning makers« ). Cette évolution suggère une redéfinition profonde de la profession face à la capacité croissante de l’IA à générer et distribuer de l’information.
- La possibilité que les moteurs de recherche basés sur l’IA diminuent le rôle des journalistes en tant qu’intermédiaires entre les experts et le public, en privilégiant potentiellement les sources académiques et éducatives au détriment des sources d’information traditionnelles.
- L’émergence des Agents IA capables de prendre des décisions autonomes pour atteindre des objectifs d’information. Cette évolution technologique pourrait potentiellement transformer la manière dont l’information est agrégée et présentée aux utilisateurs, remettant en question le contrôle éditorial traditionnel.
- La dépendance croissante des médias vis-à-vis des grandes entreprises technologiques pour les outils d’IA, soulevant des inquiétudes face aux augmentations de prix soudaines ou aux changements de fonctionnalités qui pourraient impacter leurs opérations. Cette dépendance pourrait impacter radicalement les modèles économiques des médias.
- Le risque que l’abondance de contenu généré par l’IA conduit à une (encore plus grande) « fatigue de l’information » et à un évitement de l’actualité par le public. Si le volume d’informations devient trop important et difficile à distinguer, cela pourrait éroder l’engagement du public.
- La perspective que dans un avenir proche, une grande partie du public pourrait s’informer directement via des plateformes d’IA comme Google AI Overview ou Perplexity, contournant potentiellement les sites web et applications d’actualités traditionnels, une menace existentielle pour la visibilité et la distribution du journalisme.
- Le défi de maintenir des liens solides entre les journalistes et leur public dans un monde où la distribution de l’information pourrait être de plus en plus intermédiée par l’IA, avec le risque d’une aliénation et d’une perte de contact avec les besoins spécifiques des différentes audiences.
- La remise en question du modèle économique actuel du journalisme par le fait que l’investissement dans l’IA augmente les coûts sans nécessairement générer des économies immédiates, tout en menaçant potentiellement la visibilité du contenu de qualité.
- La nécessité pour les médias de repenser fondamentalement leurs stratégies en mettant l’accent sur un journalisme de qualité et leurs audiences spécifiques plutôt que de se laisser uniquement guider par les avancées technologiques. Cela implique un changement de mentalité et de priorités.
- Le potentiel que l’accès à des assistants super-intelligents alimentés par l’IA soit limité aux personnes aisées en raison des modèles de tarification, ce qui pourrait exacerber les inégalités en matière d’accès à l’information de qualité et nuire à la démocratie.
Illustrations : KB
Festival International du Journalisme de Pérouse 2025 : How to ‘Make Journalism Great Again’ ?
Face à la double menace des dictatures dystopiques et des intelligences artificielles incontrôlables, le journalisme vacille. Le soleil indulgent de l’Ombrie adoucit les tensions et rend les conversations plus perméables, mais chacun s’interroge sur la survie d’un métier malmené qui doit plus que jamais affirmer sa mission.
Par Kati Bremme, rédactrice en chef Méta-Media, Alexandra Klinnik et Océane Ansah, MediaLab de l’Information de France Télévisions
Ceux qui maîtrisent en profondeur les technologies d’intelligence artificielle et les logiques économiques qui les sous-tendent restent les plus sceptiques face à leur intégration dans les rédactions. Étonnamment, peu de journalistes enquêtent sur l’ampleur du déséquilibre des pouvoirs à l’œuvre dans cette nouvelle révolution sociétale — qui remet pourtant en question la raison d’être même de leur activité. Les analyses percutantes de Karen Hao, Martin Andree ou Christopher Wylie font figure d’exception.
Les early adopters des grands modèles de langage dans les rédactions, de leur côté, ont payé le prix fort : des phases de test et de fine-tuning épuisantes, qui les empêchent d’assurer leur travail de base et de remplir leur mission. Une mission qu’il faut d’ailleurs redéfinir. Les journalistes doivent réapprendre à écouter — certains évoquent même un rôle de thérapeute, s’ils veulent maintenir un lien avec les user needs (souvent portés par les équipes produit), voire avec de simples besoins humains. Des besoins que les créateurs de contenus ont bien compris. Mais eux aussi montrent des signes d’usure, et en viennent presque à appeler l’émergence de nouveaux intermédiaires face aux algorithmes des plateformes dont ils dépendent — avant, peut-être, d’être un jour remplacés par des avatars IA, générés et entraînés sur leurs propres contenus.
Dans certains conflits de ce nouveau monde en guerre, le public semble faire preuve de davantage de news literacy que les grandes rédactions elles-mêmes. Une question s’impose alors, à la fois dérangeante et peut-être un peu datée, héritée de l’époque des gatekeepers : à quoi bon produire un journalisme rigoureux, si celui-ci peut, en toute légalité, conduire à l’élection de dirigeants résolument autoritaires ? Sans prétendre façonner l’opinion, il est peut-être temps de sortir d’une posture exclusivement réactive pour adopter une approche plus constructive, plus accompagnante : offrir des repères, donner des clés de lecture dans un monde toujours plus chaotique, face à des plateformes qui monopolisent désormais non seulement le divertissement, mais aussi l’information.
Si les médias sont aujourd’hui remis en cause (#NewsFatigue), il est peut-être temps d’arrêter de pointer un public prétendument désengagé — et de reconnaître que la difficulté à se réinventer vient d’abord des médias eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin : des journalistes un peu plus “full stack”, capables de comprendre leur produit (le monde), de connaître leur audience en profondeur, et de savoir comment l’écouter et lui parler.
A voir
Toutes les sessions sont accessibles gratuitement sur le site de l’IJF 2025, mais voici notre top 3 à rattraper :
- News or noise? The competing visions for journalism in an AI-mediated society
- How to save journalism from big tech
- Captured: how Silicon Valley’s AI emperors are reshaping reality
10 points à emporter :
- Selon David Caswell, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative.
- Dans le nouveau monde artificiel, « Digital doubt is becoming the new normal ». 59,9 % des personnes remettent davantage en question l’authenticité des contenus en ligne qu’auparavant, selon le dernier Wayfinder d’Ezra Eeman sur les tendances des médias.
- D’après Karen Hao, les médias s’associent à OpenAI dans l’espoir de partenariats fructueux, mais la journaliste-ingénieure anticipe un scénario identique à celui des réseaux sociaux, où les rédactions ont été évincées du jour au lendemain.
- Des LLM sont des Large Language Models et non pas des Large Fact Models (c’est toujours bien de le rappeler). Des technologies qui reposent entièrement sur la probabilité sont peut-être en contradiction avec la vérification des faits propres au journalisme.
- Le public cherche de plus en plus des réponses plutôt que des informations. Chaque interface se transforme en machine à réponse. Selon la CJR, près d’un quart des Américains utilisent désormais l’IA à la place des moteurs de recherche classiques.
- Pour Ellen Heinrichs, fondatrice et directrice du Bonn Institute, les rédactions devraient, au lieu de courir après le dernier gadget IA, investir dans plus de journalisme humain. Une conclusion partagée par l’étude « News for all » menée par Cymru et la BBC, Karen Hao ou encore Christopher Wylie, le lanceur d’alerte derrière Cambridge Analytica.
- Peu importe que le journalisme soit financé par des fonds privés ou publics – nous perdrons le journalisme, car c’est la visibilité qui disparaît. L’invention de l’imprimerie a seulement transformé la distribution. L’IA, elle, bouleverse à la fois la production et la diffusion. Martin Andree nous laisse quatre ans avant que les Big Techs ne prennent totalement possession des médias.
- Et si, comme le suggère Chris Moran du Guardian, il ne s’agissait pas de produire davantage, mais autrement ? Plutôt que d’exploiter l’IA pour multiplier les contenus, pourquoi ne pas l’utiliser pour réduire le volume et améliorer la pertinence ? Vers une forme assumée de sobriété éditoriale…
- Les early adopters des grands modèles de langage dans les rédactions ont payé le prix fort : des phases de test et de fine-tuning épuisantes, qui les empêchent d’assurer leur travail de base et remplir leur mission.
- Selon Isobel Cockerell, le Vatican, la « Silicon Valley de l’époque » fait partie des rares institutions à prendre au sérieux les dangers liés à l’intelligence artificielle, « un substitut à Dieu ». « L’ancienne religion semble ainsi mener une bataille contre la nouvelle », ironise-t-elle.
Et voici nos notes en détail :
Comment ne pas se noyer dans l’IA ?
Tout le monde parle d’outils de productivité, mais rares sont ceux qui interrogent la source même de cette exigence de performance : des réseaux sociaux et des appareils connectés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, affamés de contenu neuf. Et si, comme le suggère Chris Moran du Guardian, il ne s’agissait pas de produire davantage, mais autrement ? Moins de journalisme, mais davantage de service. Plutôt que d’exploiter l’IA pour multiplier les contenus, pourquoi ne pas l’utiliser pour réduire le volume et améliorer la pertinence ? Vers une forme assumée de sobriété éditoriale. Et si les chatbots d’il y a quinze ans, fondés sur de simples arbres de décision, étaient en réalité mieux adaptés au journalisme que les modèles de fondation hallucinatoires des LLM ?
- Dans sa séance d’ouverture, Nic Newman déclare : « Avec l’IA, on ne connaît pas le produit. Il faut expérimenter ensemble et trouver la valeur, en s’appuyant sur notre mission. » Et c’est bien là tout le paradoxe : alors que les rédactions manquent de temps, elles devraient en consacrer plus que jamais à tester, chercher, tâtonner.
- Quand « les journalistes pensent que le langage leur appartient » (Lucy Kueng), l’irruption des grands modèles de langage remet forcément leur rôle en question. Qui produit du sens ? Qui édite quoi ? À partir de quelles intentions ?
- Dans ce nouveau monde artificiel, « Digital doubt is becoming the new normal »

- Ezra Eeman, Directeur Stratégie et Innovation de la NPO, pose la question : faut-il simplement optimiser le processus, ou bien le repenser entièrement en boucles, où l’audience n’est plus en bout de chaîne, mais au cœur du système ? Le public ne cherche plus seulement des informations, il attend des réponses. Et chaque plateforme, des moteurs de recherche aux réseaux sociaux en passant par les assistants vocaux, devient une machine à produire ces réponses. Le format même de l’article s’efface progressivement au profit de formes conversationnelles, adaptatives, immédiates.
- Spotify est passé de la playlist à la daylist. Les deepfakes sont devenus un standard culturel. Et ce n’est pas le C2PA — pensé pour signaler les contenus générés par IA — qui permettra de sortir de cette opacité croissante. Tandis que l’industrie technologique le conçoit comme un outil de transparence technique, les médias, eux, y projettent un espoir presque symbolique : celui de redonner de la visibilité à l’humain (toujours selon Ezra Eeman).
- L’enjeu, pour les rédactions, est clair : ne pas se disperser dans des « fancy experiments » menées à partir de « messy data ». C’est là que les rédactions nativement construites autour de l’IA, comme le média indien Scroll, disposent d’un net avantage. Sa responsable du AI Lab for News, Sannuta Raghu, explique comment l’IA (toujours avec un humain dans la boucle) leur permet de produire jusqu’à 20 vidéos par jour dans un pays aux 22 langues officielles, où la recherche s’effectue majoritairement par commande vocale.
- Pour Joseph El Mahdi, News Commissioner à la Swedish Radio, le journalisme de qualité et les contenus générés par l’IA sont incompatibles. En revanche, la stratégie d’actualité de la SR intègre désormais l’assistance de l’IA : transcriptions, suggestions de titres, traitement de volumes massifs de données. Un outil comme « l’angle buddy » – Vinkelkompisen – vient soutenir ce processus éditorial, tandis que leur chatbot développé avec Neo de l’EBU est volontairement bridé pour éviter de répondre des fake news.
- Chez Semafor, Gina Chua voit une opportunité claire d’améliorer la relation avec les audiences grâce à l’IA : intégration d’articles connexes, de résumés, et de points de vue alternatifs pour anticiper les réactions du public et prendre en compte la diversité des perceptions. Khalil Cassimally de The Conversation considère ces outils comme un levier pour mieux comprendre les publics, en facilitant l’accès aux audience insights. Chacun peut désormais se construire son propre outil d’analyse de données, grâce au vibe coding.
- Au Wall Street Journal, l’IA générative est utilisée pour des chatbots spécialisés, comme Lars, assistant fiscal. Au New York Times, un bot a été conçu après deux mois de focus groups avec des équipes éditoriales. Deux tiers des besoins portaient sur des demandes de résumés, ce qui a conduit à la création d’Echo, capable de résumer n’importe quelle URL du NYT. Echo 2.0 ajoute une couche de jugement éditorial. Par ailleurs, au NYT, on préfère les « tiny experiments as a concept ».
- Dans la plupart des rédactions, l’IA (prédictive et/ou générative) est désormais soit intégrée directement dans le CMS, soit dans des « boîtes à outils » sur mesure (le NYT est en train de rassembler tous ses cas d’usage dans une même interface).

- Aujourd’hui, la technologie est la partie facile. C’est la validation éditoriale qui absorbe l’énergie. Il faut savoir définir ce qu’est un « bon contenu » pour l’expliquer à l’IA. The Guardian partage un échec plutôt qu’un succès : le résumé automatique dans ses live. « Fine-tuning takes a hell of human effort! » Il ne suffit pas d’apprendre à la machine ce qui est juste, encore faut-il lui enseigner ce qui est important. Or elle préfère ce qui est viral. Chris Moran en viendrait presque à expédier les deux podcasteurs de Notebook LM sur la lune, lassé par la course à la hype. Il reconnaît toutefois l’utilité de fonctions très ciblées, comme l’accès direct à un passage spécifique dans un PDF. Pour lui, l’IA intermédiarisera tout — appareils, plateformes — et ce sera « assez bon » pour le grand public. Son appel aux rédactions : « S’il vous plaît, ne recréez pas les mêmes outils. »
- Rappel : les LLM sont des Large Language Models, pas des Large Fact Models. La vérité est déterministe, non probabiliste.
« Fine-tuning [AI ]takes a hell of human effort! »
Chris Moran, The Guardian
- Sur les partenariats entre big tech et médias, Ezra Eeman note un net ralentissement. Karen Hao, ingénieure passée par le MIT et aujourd’hui journaliste à The Atlantic, rappelle que la tech de la Silicon Valley n’a jamais été alignée avec l’intérêt général. Selon elle, les rédactions s’associent à OpenAI en espérant des retombées positives — mais elle anticipe le même scénario qu’avec les réseaux sociaux : des relations asymétriques, puis une éviction brutale.

- Pour Ezra Eeman, « It’s better to be inside than outside ». Mais Karen Hao, forte de ses recherches pour son livre Empire of AI, insiste : le récit d’un progrès inéluctable vers l’IA générative et générale est une construction. Rien n’est inévitable. Et s’associer à des entreprises qui œuvrent, selon elle, à la mort du journalisme n’est peut-être pas la meilleure projection stratégique pour une rédaction. Sa formation pour The AI Spotlight Series, produite avec le Pulitzer Center, sera d’ailleurs accessible gratuitement plus tard dans l’année.
- Retour d’expérience : les modèles vieillissent vite. Ils doivent être retestés, réévalués régulièrement — un processus coûteux, chronophage, incompatible avec le rythme quotidien des rédactions. Le Wall Street Journal a d’ailleurs mis en place un poste d’éditeur de flux de travail dédié pour suivre ce cycle d’usure.
- Une question posée dans la salle : doit-on utiliser ces IA génératives ou non ? Réponse nuancée : Oui, si le cas d’usage n’exige pas de précision extrême et n’implique pas de contact direct avec le public. Non, si l’enjeu est critique et exposé.
- Avec, en arrière-plan, un mot d’ordre aussi séduisant qu’illusoire : Move fast without breaking things. Et si, justement, il était temps de briser deux ou trois certitudes ?
- Et pour l’instant, selon David Caswell, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative, faisant référence aux fournisseurs de modèles comme OpenAI, Anthropic…, qui investissent bien plus que leurs revenus.
« Pour l’instant, personne ne gagne de l’argent avec l’IA générative. »
David Caswell
- Quelques faits cités par Karen Hao : en 2023, l’un des ensembles de données les plus utilisés pour entraîner les IA génératives d’images contenait du matériel pédopornographique. Le programme Apollo aurait coûté, en valeur actuelle, 300 milliards de dollars sur 15 ans pour aller sur la Lune ; 500 milliards seront investis en seulement quatre ans… pour développer de plus gros chatbots. À l’origine, la recherche en IA était universitaire, financée par les États, guidée par des impératifs d’efficacité. Aujourd’hui, elle est menée par des entreprises privées, autofinancées, disposant d’un accès illimité aux données et d’une puissance de calcul colossale — avec, pour principale boussole, l’envie de conquête de marché. Toujours plus vite, toujours plus grand.
- Espérons que le journalisme ne devienne pas le edge case scenario de l’IA générative et des Big Tech…
Comment devenir Full Stack Journalist ?
Dans la séance d’ouverture, Nic Newman résume 15 ans de « produit » en 7 minutes. Il y a 25 ans, la tech était encore marginale dans les rédactions. Dans l’histoire du « produit » — un terme qui reste flou pour beaucoup de journalistes (Nic Newman cite un sondage du Reuters Institute : 93 % des rédactions jugent le sujet important, mais seulement 45 % estiment en comprendre réellement les contours) —, le lancement de l’iPlayer fut un tournant. Mis en ligne le jour de Noël en 2007, après trois ans d’échecs, il marque l’introduction de la « méthode agile » dans l’univers des médias.
- Aujourd’hui, les données d’usage permettent de passer du minimum viable product à une minimum viable experience. On n’est plus face à un défi technologique, mais à un enjeu business.
- Dans la chaîne de décision, le pouvoir et les budgets restent souvent concentrés côté éditorial. Il serait peut-être temps d’expérimenter aussi une minimum viable structure. Point positif : le produit n’est plus une tendance, mais une position stratégique. Un levier de croissance. Et les meilleures idées ne viennent pas systématiquement du top management…

- Si l’on définit le produit comme un « échange de valeur avec l’audience », alors comment définir — et surtout évaluer — cette valeur ? C’est précisément ce qu’a tenté la table ronde « La valeur publique du journalisme : entre mesures individuelles et impact sociétal », réunissant Smartocto (qui détient toutes les métriques individuelles), Mattia Peretti (fondateur de News Alchemists) et Karlijn Goossen de 360 NPO. Tous trois interrogent le décalage entre ce que l’on mesure au quotidien et ce qui pousse un journaliste à se lever le matin — autrement dit, la valeur sociétale.
- Le User Needs Model (créé par Dmitry Shishkin) est-il plus pertinent dans sa version 2.0 avec Smartocto ? Ne regarde-t-on pas les mauvais chiffres, de la mauvaise manière ? La vraie question n’est-elle pas plutôt : que se passe-t-il dans le monde si demain nous ne sommes plus là ? On surindexe le comment, sans assez interroger le pourquoi.

- Il faudrait aller vers un rapport plus relationnel que transactionnel. Mais comment équilibrer la démonstration de valeur sociale avec celle de la valeur individuelle, dans une société centrée sur l’individu (question de l’audience) ?
- Pour Upasna Gautam, Senior Platform Product Manager chez CNN, « la confiance est un produit dérivé de la curiosité ». C’est elle qui introduit la notion de Full Stack Journalist, empruntée au vocabulaire produit : le contenu est le produit, et chaque journaliste doit savoir à la fois comment il est conçu, et comment il est distribué.
« La confiance est un produit dérivé de la curiosité »
Upasna Gautam, Senior Platform Product Manager chez CNN
- La position de gatekeeper est définitivement révolue. Pour rester pertinents, les médias doivent repenser leur fonction. Sans aller jusqu’au rôle de thérapeute — évoqué dans plusieurs panels —, il s’agit d’écouter plus finement les besoins des publics. Même si le résultat dérange, comme dans l’étude News for all que la BBC a longtemps hésité à publier, tant les résultats étaient jugés trop confrontants.
- The Globe and Mail, au Canada, a complètement revu l’organisation de sa rédaction après avoir constaté que trop de journalistes couvraient les mêmes types d’actualités. Une refonte structurelle pensée pour rééquilibrer les ressources éditoriales.

- Comme beaucoup d’intervenants, Ellen Heinrichs, fondatrice du Bonn Institute, appelle les rédactions à cesser de courir après le dernier gadget IA. Mieux vaudrait investir dans du journalisme résolument humain. Les publics ne réclament pas un chatbot sophistiqué qui s’exprime dans leur langage, mais des journalistes sur le terrain, dans leur quartier, capables d’écouter. Une forme de journalism as a service, qu’Ellen Heinrichs décline en trois mots-clés :
- Solutions — pas comme format, mais comme principe de leadership éditorial
- Perspectives — raconter une histoire à travers le regard d’un autre
- Dialogue — pour sortir de la logique binaire du pour/contre et introduire des nuances.
Créateurs en quête d’indépendance
L’économie des créateurs de contenu est estimée à 500 milliards de dollars d’ici 2027. Pendant ce temps, le modèle économique traditionnel des médias s’effondre. Le lien qui unissait autrefois les journalistes à une rédaction tout au long de leur carrière n’a plus cours. Dans cette brèche, certains journalistes franchissent le pas et deviennent eux-mêmes des créateurs de contenu. Mais cette reconversion n’est ni évidente ni forcément souhaitable, car elle implique une posture entrepreneuriale (se vendre, construire une audience, gérer une marque personnelle), souvent éloignée du rôle journalistique. Pour accompagner cette transition, des structures créées par d’anciens journalistes émergent afin d’aider leurs pairs à s’insérer dans cette nouvelle économie.
- Tous les médias s’interrogent sur la collaboration avec les créateurs de contenu. V Spehar, de Under the Desk News (3,5 millions d’abonnés sur TikTok), livre sa recette : miser sur des partenariats durables — comme ceux noués avec le LA Times ou le Washington Post — et non sur des opérations ponctuelles, alibi.
- Ce qui distingue les créateurs des rédactions : une maîtrise plus fine des sujets traités, et surtout une relation directe avec leur audience — par l’intermédiaire de plateformes et d’algorithmes dont ils restent dépendants. L’audience, ici, tient lieu de rédacteur en chef. « Je parle à mon public chaque jour. […] Nous produisons de l’information ensemble. Cela me coûte, mais cela me nourrit aussi. »
« Je parle à mon public chaque jour. […] Nous produisons de l’information ensemble. Cela me coûte, mais cela me nourrit aussi. »
V Spehar, Under The Desk News
- V Spehar est aussi lucide sur le contexte : ce lien se joue souvent dans l’intime — dans la salle de bains, pas dans le salon familial devant le téléviseur. Consciente de sa vulnérabilité face aux algorithmes, elle encourage les créateurs à rejoindre Substack, nouveau refuge perçu comme un espace plus sûr. Adeline Hulin, de l’UNESCO, complète : si le journalisme est une fonction, alors les créateurs de contenu (des « nano-newsrooms », selon la définition d’Ezra Eeman) relèvent, eux aussi, de la protection de cette fonction.

- L’économie des créateurs se structure : de plus en plus de marques investissent dans ce nouvel espace numérique, où les contenus indépendants attirent massivement les jeunes audiences. « On est clairement en train d’assister à une transition : les budgets publicitaires migrent des anciens formats vers ces nouveaux formats », constate Johnny Harris, ex-journaliste chez Vox devenu YouTubeur. Les marques suivent l’audience : selon une étude Deloitte, 56 % de la génération Z trouvent les contenus sur les réseaux sociaux plus pertinents que les films ou séries traditionnels, et près de la moitié se sentent plus connectés aux créateurs en ligne qu’aux présentateurs TV. Mais Tous les créateurs déconstruisent le mythe de la célébrité instantanée et sans effort. V Spehar a lancé sa carrière en parallèle d’un emploi à temps plein. Johnny Harris (6,5 millions d’abonnés sur YouTube) reconnaît volontiers que c’est sa femme qui gère le marketing.
- Pour Johnny Harris, les créateurs qui réussissent sont ceux qui maîtrisent un sujet spécifique. Un rappel utile pour les rédactions qui ont parfois trop vite abandonné l’expertise, pensant qu’il suffisait de bien présenter pour parler 1 min 20 à la télévision.
« On ne peut pas s’attendre à ce que tous les meilleurs journalistes aient aussi envie de devenir chefs d’entreprise »
Johnny Harris
- Être journaliste et entrepreneur, ce sont deux rôles bien différents, ce qui freine de nombreux journalistes à se lancer seuls. « On ne peut pas s’attendre à ce que tous les meilleurs journalistes aient aussi envie de devenir chefs d’entreprise », explique Harris, évoquant les risques financiers et l’endurance que demande le lancement d’une activité indépendante. Tous constatent un même mouvement : les plateformes sociales, saturées par l’économie de l’attention, ne suffisent plus. Les créateurs se tournent vers des modèles d’abonnement — entrant de fait en concurrence directe avec les médias traditionnels. Mais même sur Substack, selon Taylor Lorenz (ex-Washington Post, devenue indépendante), il faut publier au moins quatre à cinq fois par semaine pour espérer émerger.
@underthedesknews How do you say Banana in Italian? #news #italy ♬ original sound – UnderTheDeskNews
- Pour répondre à ces obstacles, Johnny Harris a conçu une structure de transition reposant sur les abonnements et la publicité, servant de rampe d’accès vers l’économie des créateurs, tout en protégeant les journalistes des aspects les plus complexes de l’entrepreneuriat.
« Ils ne veulent pas forcément diriger une organisation, embaucher du personnel, gérer des impôts ou négocier des partenariats de marque. Ce qu’ils veulent, c’est faire du journalisme », poursuit-il. - Réinventer le modèle de distribution des reportages de terrain : En parallèle, Jane Ferguson a fondé Noosphere, une plateforme vidéo pensée pour les journalistes indépendants, souvent en zones de conflit, afin de publier leurs reportages en toute liberté et être rémunérés directement par leur public. Inspirée de Substack ou YouTube, Noosphere repose sur un modèle d’abonnement : les journalistes reçoivent 50 % des revenus des abonnements qu’ils génèrent, tout en conservant une liberté éditoriale totale. La plateforme offre aussi un soutien logistique (formation à la sécurité, assurance, équipements), tout en permettant aux journalistes de collaborer avec d’autres médias s’ils le souhaitent.

- L’enjeu : sortir de la dépendance aux plateformes classiques et redonner du pouvoir aux journalistes. « Personne ne peut vous virer, soutient Ferguson. La désintermédiation est le futur. » Ce modèle répond aussi à une pression constante ressentie par les créateurs. Pas besoin de constamment poster pour tout simplement exister. Selon Patreon, 75 % des créateurs estiment être pénalisés s’ils ne postent pas régulièrement, ce qui alimente la fatigue dans l’économie de l’attention.
- Patreon s’impose comme un pilier pour l’indépendance éditoriale : lors d’une table ronde parallèle, plusieurs journalistes indépendants ont expliqué comment ils s’éloignent des structures traditionnelles pour produire des contenus en dehors des logiques industrielles. Patreon devient une solution concrète pour sécuriser des revenus récurrents, permettre une plus grande liberté de ton et travailler pour une communauté engagée, plutôt que pour les algorithmes.
- Adam Cole (HowTown) illustre le parcours exigeant vers l’autonomie : ancien de NPR, il raconte le contraste entre les espoirs initiaux et la réalité du lancement. Aujourd’hui, sa chaîne YouTube rassemble plus de 719 000 abonnés. Son modèle repose sur trois sources de revenus équilibrées : un tiers Patreon, un tiers monétisation YouTube, un tiers sponsoring via des intégrations. Une répartition qui lui permet de créer du contenu avec sens, même pour une audience plus restreinte.
- Une stratégie partagée par d’autres créateurs présents : Samuel Muna, fondateur d’un média africain indépendant, et Gloria Chan, cofondatrice de Green Bean Media, utilisent eux aussi Patreon pour construire un modèle d’abonnement mensuel stable. L’objectif : produire autrement, sans dépendre d’un volume massif d’audience, en misant sur un lien direct avec leurs soutiens.
- Johnny Harris résume ce qui fait le succès de ses documentaires de 40 minutes : « Une grande partie de ma narration consiste à faire cheminer le public à travers le processus de construction de l’information. » L’objectivité n’est plus la norme ; la confiance passe désormais par l’authenticité. Les jeunes audiences n’ont d’ailleurs plus la même définition de l’information qu’une rédaction classique — tout en rappelant qu’« authenticité n’est pas vérité ». Interrogé sur la taille de son équipe : 17 personnes. « Je suis accidentellement devenu une entreprise média. »
« Je suis accidentellement devenu une entreprise média. »
Johnny Harris
- De son côté, Sophia Smith Galer cherche à diversifier ses revenus. Elle a fait tester, en terrasse, une application à destination des créateurs qui transforme n’importe quel texte en prompt (la aignification télé ancienne) pour enregistrer une vidéo. Une interface minimaliste pensée pour simplifier le passage à l’écran. Sur les réseaux sociaux, selon elle, l’enjeu n’est plus de « toucher les jeunes », mais d’atteindre une large audience d’utilisateurs numériques. Sa méthode : une formule en 3 I. Instinct : une histoire vous interpelle. Insights : vous vérifiez tous les éléments, en lien avec ce que vous avez déjà produit. Impact : en quoi ce contenu se distingue-t-il de celui de vos concurrents — car l’espace est saturé. Autrefois pionnière, elle se retrouve aujourd’hui en concurrence directe avec l’ensemble des créateurs d’actualité. Et rappelle qu’une vidéo de 90 secondes doit être aussi sourcée et rigoureuse qu’un article…

La Muskification des médias
« Les big tech représentent une menace existentielle pour le journalisme », déclare Clayton Weimers, directeur exécutif de Reporters Sans Frontières USA, lors d’une table ronde intitulée The Muskification of American Media. « Quelles solutions face à la désinformation lorsque des hommes puissants en sont à l’origine ? », interroge-t-il. Pour Courtney Radsch, directrice du Center for Journalism and Liberty, la réponse est claire : « Les médias doivent couvrir les géants de la technologie de manière beaucoup plus critique. » Aux côtés de Patricia Campos Mello, éditrice en chef de Folha de São Paulo, et d’Anya Schiffrin, professeure à la School of International and Public Affairs de l’Université de Columbia, le panel a exploré ces questions et proposé plusieurs solutions.
- La bataille autour des mots sert les intérêts des grandes plateformes. La « muskification » relève d’un double langage orwellien, estime Courtney Radsch : « Les choses sont mélangées, on appelle la censure discours libre. » Elle dénonce l’usage stratégique de termes comme « censure » ou « antiaméricanisme » pour discréditer les régulations, telles que le DSA ou l’AI Act. Le panel évoque la polémique autour de l’expression « Golf of America », qui oppose Donald Trump à l’Associated Press, comme exemple de cette confusion entretenue dans l’espace public. Même logique au Brésil, où Patricia Campos Mello rappelle comment Elon Musk s’est abrité derrière la liberté d’expression pour contester une décision de justice. Face à ces tentatives de manipulation, les intervenants insistent : les définitions doivent être claires. Médias, gouvernements et citoyens ne peuvent se permettre de laisser les “tech bros” redonner une définition aux mots.
- Pas besoin de nouvelles lois, affirment les intervenants. Les outils existent déjà, encore faut-il les utiliser. « L’Union européenne devrait tenir bon et s’inspirer du Brésil », estime Courtney Radsch. Lois contraignantes, politiques de concurrence, règles antitrust, fiscalité, exigences en matière de transparence et de droits d’auteur : la boîte à outils est là. Reste à l’ouvrir. Pour les panélistes, face à la puissance des big techs, il est temps de faire appliquer les règles, pas de les réécrire.
- Les rédactions doivent changer de regard sur la tech, plaide Clayton Weimers. « Il faut cesser de traiter la tech comme une simple rubrique. C’est un mouvement politique à part entière. » Derrière les promesses d’innovation, des idéologies s’imposent. Anya Schiffrin, parmi d’autres, parle de « techno-fascisme », tandis que Courtney Radsch alerte sur les biais inscrits dans les grands modèles de langage. « L’IA d’Elon Musk entre à la Maison-Blanche », ironise-t-elle. Dans le même temps, certaines rédactions signent des accords avec les plateformes pour « quelques dollars » et relaient l’idée que cette évolution serait inévitable. Une illusion, selon elle.

- Lutter contre les” techno fascistes” c’est aussi s’abonner aux médias. Anya Schiffrin confie être entourée de personnes qui cherchent comment agir, sans risquer l’expulsion du territoire américain. Sa réponse est simple : s’abonner à la presse indépendante, soutenir des titres comme le New York Times ou d’autres médias de référence. Un geste concret pour renforcer un écosystème journalistique sous pression et résister aux tentatives de musellement.
- À la question « La pression publique peut-elle créer du changement ? », la réponse est unanime et radicale : « Non, la pression publique ne peut être exercée tant que les grandes plateformes contrôlent les algorithmes. »
- David Caswell fait dans une autre table ronde un excellent résumé du parcours média du patron Tesla par ses traces laissés sur le numérique, dont ce tweet qui explique sa vision de la modération :

- Plus tard c’est « Notre objectif est de maximiser le nombre de secondes d’utilisation sans regret. Trop de contenus négatifs sont poussés, ce qui augmente certes le temps passé techniquement, mais pas le temps que les utilisateurs ne regrettent pas. ». Et d’ici 2029, selon les amis de Musk, l’IA sera plus intelligente que les humains.
- Toute cette belle idée d’un Internet décentralisé s’avère, en réalité, terriblement centralisée. Ce qui ressort de cette table ronde : renforcer les compétences techniques, développer un contre-pouvoir épistémique fondé sur la compréhension, et établir un standard d’excellence pour l’information. La solution passerait-elle par Community Notes ? Nous glissons d’un modèle où la confiance reposait sur un journaliste identifiable à un modèle où elle est transférée à la foule. Comme le souligne Yuval Harari, ce n’est pas l’abondance d’informations qui renforce une société — nous en avons fait l’expérience —, mais sa capacité à rechercher la vérité et à se corriger elle-même.
New: @elonmusk emailed me about his plan for AI news on X.
— Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) May 3, 2024
The idea is to use AI to blend breaking news and commentary, building real-time summaries of events. Then you can go deeper via chat on Grok.
Here's the full story! I'll be talking more about this on Big Technology…
Comment les empereurs de l’IA de la Silicon Valley reconfigurent la réalité
Christopher Wylie, lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica, tire la sonnette d’alarme : la Silicon Valley n’est plus un simple centre d’innovation technologique, mais un mouvement idéologique dangereux, une « secte religieuse ». « Ce sont les hommes les plus riches du monde, à la tête des entreprises les plus puissantes au monde », déclare-t-il. Il n’est pas le seul à voir émerger une idéologie anti-humaine, façonnée par des « tech bros » qu’il qualifie de «cinglés », convaincus que les machines doivent supplanter l’humanité et dénonce un « anti-humanisme » rampant, masqué sous le vernis du progrès.

- Selon Christopher Wylie, lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica, la Silicon Valley ne se limite plus à une simple révolution technologique ; elle s’est transformée en un mouvement religieux, une “secte” porté par des milliardaires et des « tech bros », des “nutters” (des cinglés) qui prêchent avec conviction une vision du futur où l’humanité serait supplantée par des machines. La différence avec les autres sectes ? Une puissance inégalée. “Ce sont les hommes les plus riches du monde, à la tête des entreprises les plus puissantes au monde”, résume-t-il. “Quand vous avez un groupe d’hommes qui pensent qu’ils vont remplacer l’humanité par des machines, c’est une idéologie anti-humaine. Et je pense que ce qui continue de grandir à la Silicon Valley, c’est l’anti-humanisme. Ils appellent ça le transhumanisme mais en réalité c’est une volonté de remplacement des humains”, observe Christopher Wylie.
- Mais ce fanatisme technologique n’est pas suffisamment scruté, selon Julie Posetti (International Center for Journalists) : « Nous avons peur de traiter les fous sérieusement (…). Ces missions sont réelles et totalement financées.» Elle alerte sur les parallèles avec la couverture médiatique trop laxiste de Donald Trump. Même constat chez le lanceur d’alerte : la presse reste trop passive, concentrée sur les derniers outils et ne prend pas au sérieux les “prophéties” de ces hommes surpuissants et connectées à la Maison Blanche.
- Christopher Wylie va plus loin et qualifie la Silicon Valley de mouvement fasciste. Il cite le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen, qui célèbre Filippo Tommaso Marinetti – cofondateur du fascisme italien – comme un « saint ». « Les fascistes ont toujours été obsédés par le futur. A quoi pensaient les fascistes il y a 100 ans ? A des hommes forts qui bouleversaient la société pour imposer leur vision du futur, et tous les faibles devaient s’écraser sous eux, pour un avenir glorieux. Aujourd’hui, c’est la même merde, tranche Wylie. Avant de parler régulation, il faut qu’on parle de comment résister au fascisme ? Comment est-ce qu’on aurait régulé Mussolini, franchement ? ».
« D’un côté, des journalistes pensent à sauver la technologie ; de l’autre, des tech bros pensent à comment vivre après la démocratie ».
Christopher Wylie
- Pour lui, un fossé béant s’est creusé entre les journalistes et les milliardaires de la tech : « D’un côté, des journalistes pensent à sauver la technologie ; de l’autre, des tech bros pensent à comment vivre après la démocratie ».

- Pour Martin Andree, auteur de Big Tech Must Go!, le diagnostic est clair : les Big Tech ont mis la main sur l’intégralité de l’écosystème de l’information. Tout le trafic internet se déroule désormais à l’intérieur des plateformes — résultat d’une combinaison redoutablement efficace : effets de réseau, systèmes fermés, suppression des liens sortants (un peu comme un grand magasin sans issue), contenus générés gratuitement par les utilisateurs, et auto-référencement algorithmique. Même le récit de l’évolution technologique est contrôlé… par ceux qui en tirent profit.
- Peu importe que le journalisme soit financé par des fonds publics ou privés : ce que nous sommes en train de perdre, ce n’est pas le contenu, mais sa visibilité. L’imprimerie avait transformé la distribution. L’IA, elle, bouleverse à la fois la production et la distribution. Mais Andree avance aussi des pistes concrètes : ouvrir les plateformes aux liens sortants ; imposer des standards ouverts ; séparer économiquement distribution et production de contenus ; fixer une part de marché maximale de 30 %, y compris pour les médias numériques ; interdire la monétisation de contenus criminels (ce qui paraît naturel).

- En attendant, les médias se retrouvent face à une alternative piégée, résumée dans un diagramme simple : publier sur les réseaux sociaux et travailler gratuitement pour les Big Tech, ou publier sur leurs propres sites et disparaître dans le silence algorithmique. Il pose alors la question essentielle : quelles implications pour notre réalité partagée ? Sommes-nous en train d’entrer dans une illusion — celle d’un espace médiatique ouvert, participatif — alors que, dans les faits, l’effet de réseau enferme, et que la machinerie est aux mains de quelques-uns ? Un monopole médiatique ne devrait-il pas être considéré comme anticonstitutionnel ? Selon lui, il ne s’agit pas de réguler, mais de libérer. « Ils ont volé Internet. »
« Ils ont volé Internet. »
Martin Andree
- Le débat ne doit pas être anti-technologique, mais doit cibler les usages, les abus, et la captation du mot “tech” par quelques puissants. « La Silicon Valley s’est auto-proclamée, de manière vraiment narcissique, comme étant la technologie — ce qui est absurde.» Christopher Wylie rappelle que la majorité des ingénieurs sont sincèrement engagés pour le bien commun : « Nous sommes contre les abus, contre la financiarisation de toute la société, contre l’exploitation émotionnelle, et contre la destruction des sociétés civiles.»
Quatre ans pour ne pas disparaître
Avec l’IA, nous sommes à l’aube d’une saturation totale : une avalanche de contenus générés à grande vitesse, souvent creux, parfois toxiques — dans un monde où la capacité à comprendre devient plus vitale que jamais. Ezra Eeman, dans sa présentation Wayfinder, toujours aussi claire et synthétique malgré le chaos ambiant, décrit bien le glissement de pouvoir : d’un côté, des groupes médiatiques capables de produire à grande échelle ; de l’autre, des individus qui créent de la valeur. Mais tous dépendent de plateformes qu’ils ne contrôlent pas.
Demain, travaillerons-nous dans des rédactions cybernétiques ? Le risque n’est pas seulement celui de machines qui singent mal l’humain, mais aussi d’humains qui finissent par imiter la machine — mal.
Un mouvement anticyclique se dessine : d’un côté, une prise de conscience des rédactions face à des Big Tech qui maîtrisent toute la chaîne de valeur, de la création à la diffusion ; de l’autre, une course effrénée à l’intégration de l’IA, pour rester dans la course… que dictent justement ces mêmes acteurs. Au final, le journalisme assisté par IA pourrait bien être l’un des derniers espaces où les humains restent dans la boucle. Ailleurs, ils seront progressivement exclus du circuit.
Que pouvons-nous créer qui nous soit véritablement propre ?
Qu’est-ce qui donnerait à quelqu’un une bonne raison de venir chez nous plutôt qu’ailleurs ?
Martin Andree estime qu’il reste quatre ans avant que les Big Tech ne prennent le contrôle total du système médiatique. Lorsque des figures de la Silicon Valley commencent à se présenter comme les prophètes d’une religion dont l’IA serait le Dieu — omnisciente, omnipotente, omniprésente — il est peut-être temps de reconnaître que le problème dépasse la seule question technologique. Conclusion d’un International Journalism Festival… sponsorisé par Google.

Images : KB, sauf contre-indication

Liens vagabonds : De l’angoisse ado aux secrets d’État, le cynisme selon Meta
Sarah Wynn-Williams, ex-directrice de la politique publique de Meta, vient de livrer cette semaine un témoignage édifiant au Sénat américain, suite aux révélations de son livre Careless People. Elle y explique comment le groupe a délibérément exploité la détresse émotionnelle de ses utilisateurs adolescents à des fins publicitaires : Meta pouvait détecter qu’un adolescent se sentait « sans valeur ou nul » et partager cette information avec des annonceurs, afin de lui afficher une publicité « au moment le plus opportun » – par exemple un produit de beauté juste après qu’une adolescente ait supprimé un selfie, ou des offres de régime amaigrissant lorsque des jeunes filles exprimaient un mal-être corporel. Ces pratiques, qui visaient les 13-17 ans jugés « très rentables », se sont, selon elle, déroulées sans aucun garde-fou éthique au sein de Meta. Wynn-Williams rapporte même qu’un cadre considérait ces adolescents comme « le segment le plus précieux » et estimait qu’il fallait le clamer haut et fort. Elle s’est dite atterrée de voir une entreprise valorisée plus de 1000 milliards de dollars monnayer sans scrupules la détresse de mineurs pour « ajouter un peu plus à [ses] coffres ».
« Le plus grand tour que Mark Zuckerberg ait jamais joué, c’est de s’envelopper dans le drapeau américain, de se proclamer patriote et d’affirmer qu’il n’offrait pas de services en Chine, alors qu’il a passé la dernière décennie à y bâtir une entreprise de 18 milliards de dollars »
La même logique de croissance effrénée transparaît dans les révélations de Wynn-Williams sur les relations de Meta avec Pékin. Selon son témoignage, les dirigeants de Facebook n’ont pas hésité à collaborer avec le régime chinois pour tenter de pénétrer le marché asiatique : Meta aurait organisé des briefings sur les avancées américaines en matière d’intelligence artificielle à l’attention d’officiels chinois, dans l’espoir de gagner les faveurs de Pékin. En interne, l’entreprise a même envisagé de construire un « pipeline » de données entre les États-Unis et la Chine – projet finalement abandonné sous la pression de régulateurs, car il aurait offert à Pékin un accès direct aux données d’utilisateurs américains. Parmi ses allégations, Wynn-Williams a déclaré que le modèle d’IA de Meta « a contribué de manière significative aux avancées chinoises dans des technologies d’IA comme DeepSeek ». et que Meta a accepté de supprimer le compte Facebook d’un dissident chinois exilé aux États-Unis, cédant ainsi aux exigences de censure du Parti communiste. Officiellement, le groupe avait invoqué un prétexte de non-conformité de ce compte à ses règles, mais l’intention réelle serait d’apaiser les autorités chinoises.
De l’exploitation cynique des faiblesses d’adolescents aux compromissions avec un régime autoritaire, ces deux volets peignent le portrait d’une entreprise prête à tout pour son expansion. Meta apparaît guidée par une logique commerciale sans limite, sacrifiant principes moraux et sécurité de ses utilisateurs sur l’autel de la croissance. Le ciblage des mineurs en état de vulnérabilité et la complaisance envers la censure d’État procèdent d’un même engrenage : privilégier les profits et la conquête de nouveaux marchés au mépris des valeurs éthiques et de la protection du public…
CETTE SEMAINE EN FRANCE
- En France, la fronde contre Meta s’organise. Une coalition inédite de plus d’une centaine de médias français (presse, TV, radio) s’apprête à poursuivre Meta en justice pour concurrence déloyale liée à la publicité ciblée – Les médias français s’allient contre Meta dans une offensive massive et inédite pour obtenir réparation de leur préjudice sur le marché de la publicité ciblée (La Lettre)
- Contexte s’attaque à Politico sur la scène européenne – Le média français Contexte (spécialisé dans les politiques publiques) lance une version en anglais afin de rivaliser avec Politico sur l’info européenne (PressGazette)
LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Version mise à jour avril 2025, par Le Monde Diplomatique
3 CHIFFRES
- 53% des interrogés de la GenZ sont anxieux face à l’IA, rapporte Axios.
- 128 cas de désinformation climatique recensés depuis janvier sur Sud Radio, CNews, mais aussi France Télévisions, selon une étude de QuotaClimat, Data for Good et Science Feedback, citée par le média vert
- 34 millions – Le nombre d’utilisateurs de Bluesky atteint ce mois-ci 34 M, contre à peine 255 000 en octobre 2024, une croissance exponentielle (+1 064 % en six mois), selon TechCrunch
NOS MEILLEURES LECTURES / DIGNES DE VOTRE TEMPS / LONG READ
- Entrée : Refusée. Le « risque intolérable pour la liberté de la presse » que représentent les fouilles d’appareils électroniques à la frontière (Columbia Journalism Review)
- Y a-t-il une “bonne” manière d’utiliser l’IA dans l’art ? (The Verge)
- « Hot Air: the danger of climate misinformation » – Une enquête de Tortoise Media sur la montée des fake news climatiques en ligne (Tortoise)
- Quels types de personnes n’apprécient pas vraiment les informations dites « impartiales » ?
Les personnes qui n’ont pas de pouvoir. (NiemanLab) - Zach Seward sur l’IA dans les rédactions (Depth Perception)
- J’ai vingt ans d’archives numériques. Qu’est-ce que j’en fais ? (Wall Street Journal)

DISRUPTION, DISLOCATION, MONDIALISATION
- Kings League, l’avenir du Sport (Le Monde)
- Un désastre pour l’innovation américaine. L’administration Trump met en péril l’essor de l’intelligence artificielle (The Atlantic)
- L’ère des mèmes d’assassinat a commencé (The Nation)

DONNEES, CONFIANCE, LIBERTÉ DE LA PRESSE, DÉSINFORMATION
- Pronoms dans la bio ? La Maison-Blanche pourrait bien vous ignorer (New York Times)
- Comment de vraies “fake news” ont provoqué une secousse sur les marchés (CNN)
- La Turquie interpelle deux journalistes de renom lors de raids matinaux (Reuters)
- Trump et Paramount s’accordent sur un médiateur dans le cadre du procès lié à 60 Minutes (New York Times)
- Un juge ordonne à la Maison-Blanche de garantir à l’Associated Press un accès total à Donald Trump (New York Times) ; La Maison-Blanche de Trump va faire appel de la décision levant les restrictions de l’AP concernant le golfe du Mexique (Reuters)
- Lundi, Meta a mis fin à son programme de fact-checking aux Etats-Unis (Le Monde)
- L’UER lance le réseau de vérification des faits Spotlight pour lutter contre la désinformation et soutenir l’information de confiance (EBU)

LÉGISLATION, RÉGLEMENTATION
- L’Europe dévoile son plan pour devenir le ‘continent de l’IA’ : des règles simplifiées et plus d’infrastructures (CNBC)
JOURNALISME
- Comment des étudiants en journalisme relaient l’actualité nationale à l’échelle locale (NiemanLab)
- Le Fonds pour le journalisme de l’Associated Press annonce son conseil d’administration et un premier programme réunissant près de 50 rédactions locales (AP)
- La journaliste indienne Mitali Mukherjee nommée directrice du Reuters Institute (Reuters)
- Quand l’IA vous a-t-elle fait rire pour la dernière fois ? Scènes du Sommet 2025 sur l’IA, l’éthique et le journalisme (Poynter)
STORYTELLING, NOUVEAUX FORMATS
- Dotdash Meredith investit massivement dans une appli People au format “façon TikTok” (Press Gazette)
ENVIRONNEMENT
- Les nouveaux centres de données des géants de la tech puiseront l’eau dans les zones les plus arides du monde (The Guardian)
RÉSEAUX SOCIAUX, MESSAGERIES, APPS
- ChatGPT introduit une mémoire persistante pour l’ensemble des conversations (The Verge)
- La quête de Bluesky pour un réseau social non toxique (The New Yorker)
- Instagram muscle sa recherche (TechCrunch)
- Les adolescents de moins de 16 ans devront obtenir une autorisation pour diffuser en direct sur Instagram, annonce Meta (Axios)
- BeReal va introduire des publicités dans le fil de ses utilisateurs américains, première étape depuis son rachat par Voodoo pour 500 M€ (TechCrunch)
STREAMING, OTT, SVOD
- Vimeo lance « Vimeo Streaming », permettant aux utilisateurs de créer leur propre service de streamig (The Hollywood Reporter)
- Même les plateformes de streaming pourraient pâtir des tarifs douaniers de Trump (Wired)
- Amazon fait évoluer Prime Video vers un modèle de diffuseur “à l’ancienne” (Reuters)
- Nickelodeon mise sur les podcasts enfants (Kidscreen)
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DATA, AUTOMATISATION
- Certains estiment que l’écriture générée par l’IA a un indice — le tiret cadratin. Les écrivains ne sont pas d’accord (Washington Post)
- Ce que nous avons appris en suivant l’usage de l’IA dans les élections mondiales (Rest of world)
- Comment ByteDance, la maison mère de TikTok, est devenue un géant de l’intelligence artificielle (NYT)
- L’ère des agents d’IA exige une nouvelle forme de théorie des jeux (Wired)

MONÉTISATION, MODÈLE ÉCONOMIQUE, PUBLICITÉ
- Quartz, ex-média économique innovant lancé en 2012 : le site vient d’être revendu pour la 4ᵉ fois en 7 ans (Axios)
Par Kati Bremme, Océane Ansah et Alexandra Klinnik
SXSW 2025 : Le journalisme au temps de la lumière déclinante
2025, toujours plus immersif, toujours plus IA, et pourtant… presque trop lisse. Cette édition du festival SXSW aurait pu être le théâtre d’une dystopie en direct, mais non : pas de révolte contre les tech bros et leur nouveau Líder Máximo au teint orange, pas même une allusion « au nom qui ne doit pas être prononcé » chez Amy Webb, d’ordinaire prophétesse des effondrements annoncés. Elle a préféré tracer une route vers un futur plus organique, un « au-delà » (de la raison ?), un brin ésotérique, porté par l’« intelligence vivante ». Juste ça.
Par Kati Bremme, Directrice Innovation et Rédactrice en chef Méta-Media
Eva Wolfangel, du journal allemand Die Zeit, capture parfaitement ce moment : comme si « toute la salle avait basculé dans une faille temporelle » face à l’absence d’analyse contextuelle politique (ce qui était déjà le cas pour la cérémonie des Oscars). Pourtant, l’ambiance était nettement moins décontractée que l’an dernier. À Austin, certains journalistes américains commençaient à se demander s’ils ne devraient pas suivre une formation express sur l’art d’informer sous un régime autoritaire – avec, pourquoi pas, un stage d’observation à Pyongyang, Téhéran ou Moscou. Au même moment, the Land of the Free venait d’être inscrit sur la liste de surveillance internationale pour érosion rapide des libertés civiques.
« Nous n’avons jamais appris à débattre de politique de manière constructive. »
Un festival qui regarde l’avenir… en évitant le présent
Mais on voyait peu de reflets de cette inquiétude dans les panels et keynotes de cette édition 2025. Quand Esther Perel ne nous propose pas d’imaginer « notre futur préféré », la résignation à l’apolitisme s’expose un peu partout sur scène, notamment dans ce panel où de jeunes fondateurs de start-up revendiquent leur combat sous la bannière « Gen Z vs. la gérontocratie ». Lorsque l’on leur demande pourquoi l’actualité politique est absente de leur discussion, ils répondent : « Notre premier souvenir politique, c’est l’élection de 2016 » (celle qui a porté Trump au pouvoir). « Nous n’avons jamais appris à débattre de politique de manière constructive. » Même retenue sur une table ronde réunissant NewsGuard et The Trust Project, dédiée à la désinformation et à la nouvelle question clé : comment distinguer les faits de la fiction ? Une rédactrice du Washington Post y assiste, mais sans que ne soient abordés ni la stratégie de Trump pour discréditer les médias, ni l’influence discrète de Jeff Bezos, propriétaire du journal, sur sa ligne éditoriale. « Nous avons convenu de ne pas aborder la politique actuelle », s’excuse le modérateur de la BBC, sans aller plus loin. SXSW aurait pu être un laboratoire de réflexion sur l’information à l’ère des IA. Mais ici, on préfère esquiver. Comme si la neutralité était devenue la seule posture acceptable dans un monde polarisé. Ou peut-être est-ce juste une question de survie économique, tant les médias, eux aussi, dépendent de ces mêmes plateformes qu’ils devraient questionner.
Galloway, la dissonance contrôlée ?
Scott Galloway, autre futurologue star de SXSW, n’a, lui, pas fait dans la dentelle. Sur scène, il a livré une performance mêlant provocations et imitation d’une vulgarité trumpo-muskienne, ce qui pourrait bien expliquer pourquoi le replay de sa keynote a mystérieusement disparu de YouTube. Fidèle à son style, il a dénoncé le « domino de la lâcheté » chez les PDG de la tech, entre deux traits d’humour un peu limites nazis-virilistes. Son grand récit du moment ? Un monde où les jeunes hommes sont de plus en plus largués derrière les jeunes femmes, préférant se réfugier dans un ersatz de vie numérique filtré par les algorithmes, où un podcast suffira à renverser une élection et où nous surprotégeons les enfants dans le monde réel et les sous-protégeons en ligne. Galloway clôture d’ailleurs sa keynote sur un appel passionné à faire plus d’enfants.

Quand l’IA écrit l’histoire… et la politique
Lors de l’enregistrement en direct de son nouveau podcast avec son frère, IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, Michelle Obama s’interroge tout de même : « Qui voulons-nous être en tant que nation ? », avant d’enchaîner sur des sujets plus intimistes. À propos d’intimistes : Rubina Fillion (The New York Times), Aimee Rinehardt (AP) et Elin Wieslander (Aftonbladet) se présentent autant comme collègues que comme amies lors de leur panel « Octet par octet : décrypter l’impact de l’IA sur le journalisme ». Au programme : journalisme d’investigation (très utile en ces temps difficiles) boosté à l’IA au New York Times, avec toujours un humain dans la boucle. Les Suédois d’Aftonbladet, eux, poussent l’expérience bien plus loin avec leurs « election buddies », des robots-journalistes s’appuyant sur du RAG et des informations vérifiées par des humains, en privilégiant GPT-4o pour la langue suédoise. Associated Press, de son côté, se dit soucieux de son avenir et de la maîtrise des modèles de langage… sans jamais évoquer son partenariat avec OpenAI. À ce rythme, pourquoi s’arrêter aux élections ? Pourquoi ne pas automatiser aussi l’analyse politique et éditoriale ? Une IA pour poser les questions, une autre pour rédiger les articles… et le journalisme devient un système parfaitement bouclé.
La vérité, version IA : recyclée et optimisée
Une question que se pose aussi un panel qui réunit Nvidia, Typeform et des chercheurs de l’Université du Texas à propos de « l’Impact des données simulées sur l’IA et notre avenir ». À mesure que les modèles d’IA manquent de données réelles, la solution semble toute trouvée : générer le monde plutôt que l’observer. Jumeaux numériques, simulations, utilisateurs fictifs… Mais jusqu’où peut-on pousser l’illusion avant que l’IA ne tourne en boucle sur elle-même ? On parle de « labels nutritionnels » pour indiquer les marges d’erreur, de boucles de correction pour éviter les dérives. Pourtant, l’essentiel semble ailleurs : réduire les coûts, aller plus vite, produire plus. En 2023, l’IA a découvert plus de protéines via des données synthétiques qu’en plusieurs siècles de science – une révolution au service de l’humanité ou une simple fuite en avant ? Et si demain, l’IA ne faisait plus que recycler du simulé ? Si même les IA ne font plus que recycler du simulé, que devient la vérité journalistique ? On risque d’entrer dans un monde où tout semble neuf, mais où plus rien n’a de sens. Le risque d’un « model collapse », où l’IA ne produit plus que du prévisible, est réel. La vérité devient un luxe, la recherche utilisateur une variable d’ajustement. Entre génération infinie et perte du réel, les experts sont d’accord : les données humaines, elles, prendront de la valeur.
Le journalisme au-delà du web : s’adapter ou disparaître
Lors de l’AI x Journalism House, organisé par Hacks/Hackers et l’Online News Association, Der Spiegel a soulevé une question cruciale : quel rôle l’IA jouera-t-elle dans le journalisme indépendant ? Pour Stefan Ottlitz, co-DG et Head of Product, les médias doivent impérativement se tourner vers l’hyper-personnalisation sous peine de devenir obsolètes dans un écosystème informationnel de plus en plus fragmenté. L’information n’est plus figée : elle circule, se transforme et épouse les usages. L’article classique n’est plus qu’un point d’entrée parmi d’autres dans un univers en expansion, fait d’événements virtuels, de récits interactifs et d’expériences immersives. Le vrai défi ? Penser au-delà du web lui-même. Dans un monde où les chatbots dopés à l’IA s’apprêtent à remplacer les moteurs de recherche traditionnels, les médias doivent anticiper cette mutation – non seulement dans leur format, mais aussi dans leur fonction.
Si les utilisateurs ne cherchent plus l’actualité mais se la voient automatiquement proposée sous forme de réponses pré-filtrées, comment les médias peuvent-ils garantir qu’ils restent des sources d’autorité ? Que devient le journalisme quand il est réduit à une simple réponse, débarrassée de sa nuance, de son contexte et de sa capacité d’enquête ? Le secteur est à un tournant : utiliser l’IA pour renforcer l’intégrité éditoriale, ou être relégué au rang de simple fournisseur de contenu pour les algorithmes.
« Donner des instructions aux IA, c’est bien, mais une IA vous a-t-elle déjà donné des instructions ? »
Neil Redding
Prévisions plus ou moins justes
Comme chaque année, le MIT a présenté les 10 technologies les plus disruptives, en faisant, à l’instar de Scott Galloway, le bilan de leurs prédictions qui se sont avérées justes, celles qui ont été plutôt ratées et même, en totale transparence, celles qui n’ont pas été intégrées dans la liste cette année, comme les taxis volants ou, étonnamment, les agents IA : « encore trop basiques, mais probablement l’année prochaine ». Neil Redding, est allé un pas plus loin et pose, de son côté, la question « Donner des instructions aux IA, c’est bien, mais une IA vous a-t-elle déjà donné des instructions ? » Selon lui, l’ère agentique est en train d’émerger : avec des agents IA de plus en plus autonomes, le monde des affaires s’apprête à devenir à la fois plus étrange et terriblement efficace (tout devient « shoppable » par exemple). Une IA qui, peu à peu, semble se doter d’une vie propre.

En attendant, selon Prof G (le surnom de Scott Galloway pour les initiés), aucune entreprise n’est mieux placée que Meta pour prendre l’avantage en IA. Neuf internautes sur dix (hors Chine, toujours reine incontestée du Big Data) utilisent ses plateformes. Résultat : un accès à une masse de données linguistiques humaines uniques – autrement dit, des pépites brutes pour l’entraînement des modèles – bien supérieure à celle de Google Search, Reddit, Wikipédia et X réunis (toutefois pas plus qualitatives que celles des médias). Et l’IA générative tombe à pic dans une époque saturée d’options, où trop de choix tue le choix. Chaque année, nous passons l’équivalent d’une semaine à décider quoi regarder. « TikTok, c’est Netflix avec une couche d’IA qui supprime l’embarras du choix. » résume Scott Galloway.
« TikTok, c’est Netflix avec une couche d’IA qui supprime l’embarras du choix. »
Scott Galloway

La vraie guerre de l’attention
Et on le sait : ce n’est pas Netflix qui a gagné la fameuse guerre du streaming, mais YouTube. Evan Shapiro, brillant cartographe des médias, l’avait anticipé depuis longtemps. À SXSW, il en a profité pour décortiquer l’évolution des modèles médiatiques, loin des panels creux, à travers de vraies conversations, sans filtre. Pour le Content Crossroads avec le Future Media Hubs il a animé des discussions sur l’ère user-centric, l’évolution du fandom, l’optimisation des interfaces média et la mort apparente du DEI (Diversity, Equity, and Inclusion). Sur la scène podcast, Shapiro a frappé fort avec une donnée clé : un milliard de personnes regardent désormais des podcasts sur leur télévision. Plutôt que de répéter des évidences, il a consacré son temps à répondre aux questions des créateurs sur l’intégration vidéo et la monétisation dans l’économie des créateurs multi-revenus. Dans cette guerre de l’attention, les médias d’information ne sont même plus en première ligue. La bataille se joue ailleurs, entre plateformes, IA et créateurs.

AEO, le nouveau SEO
Et dans ce nouveau monde piloté par l’IA, il s’agira pour les créateurs de contenu, rédactions ou influenceurs, d’apprendre les nouvelles règles du référencement : exit le SEO, bienvenue au AEO (Answer Engine Optimization). Goodie AI a présenté une étude de six semaines, analysant plus de 6 000 requêtes aléatoires sur ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity pour quantifier les facteurs influençant le classement des recherches par IA, et voici le résultat sous forme de tableau périodique. Bonne nouvelle : c’est la qualité du contenu qui prime (Score: 9,25), un peu comme aux bons vieux débuts de Google… Mauvaise nouvelle : Ce n’est plus un algorithme qui classe l’information, mais une IA qui tranche sur ce que nous devons savoir. Les sources disparaissent derrière une seule réponse, calibrée, filtrée… mais selon quels critères et validée par qui ?

L’Internationale de l’innovation
Contexte politique oblige, la Maison du Canada est restée fermée, et les délégations chinoises se sont faites discrètes. À l’inverse, les Émirats ont marqué leur présence avec une annexe du Musée du Futur de Dubai, une installation immersive signée Refik Anadol, et des panels de haut niveau, dont celui animé par Felix Zeltner (de Remote Daily, le premier talk-show virtuel au monde), aux côtés de Patrick Noack (Dubai Future Foundation) et Matt Carmichael (What the Future – Ipsos), interrogeant la nature même du métier de futurologue. L’inertie, parfois sous-estimée, finirait par reprendre ses droits – même si, en ce moment, rien ne semble aller dans ce sens. Les experts présents en étaient convaincus : nous finirons par revenir à une époque plus prévisible. Espérons-le.

L’espoir viendrait-il de l’Europe ? En tout cas, le secteur culturel français a débarqué en force à SXSW avec une délégation de 60 acteurs majeurs, menée par Bpifrance, French Touch et we are_, en partenariat avec le CNC et Valeo. Panels, échanges et une présence remarquée lors de la présentation de la cérémonie d’ouverture des JO ou encore avec Hugo Travers, créateur de contenu de référence. Pour Nicolas Dufourcq, DG de Bpifrance, SXSW reste une plateforme incontournable : un pont entre l’écosystème ultra-innovant des entreprises américaines et le savoir-faire des industries culturelles et créatives françaises. Mais l’heure n’est plus au simple rayonnement. Dans son bilan de l’événement, il tire la sonnette d’alarme : « L’Europe doit faire des choix, se méfier de la prédation de ceux qu’on pourrait appeler les ‘olitarques’, les oligarques de la tech, mais aussi des groupes chinois qui vont dominer le hardware de la robotique, en fixant nos conditions : nous voulons des JV [Joint Ventures], du transfert de technologie, des interdictions s’il le faut, mais le tout dans le cadre d’un plan de rattrapage planifié comme dans les années d’après-guerre, qui suppose une Union Européenne forte et coordonnée, qui renonce à ses jalousies inter-étatiques pour enfin coopérer, vraiment. »
L’année dernière, l’entreprise française Enchanted Tools avait remporté le prix du meilleur design produit pour ses créations humanoïdes Miroki et Miroka, repensant l’usage réel des robots. Cette année encore, des entreprises françaises se sont distinguées aux SXSW Innovation Awards, dont Wandercraft, une société de robotique qui s’impose de plus en plus sur la scène internationale. L’avenir de l’IA est décidément physique, à condition de maîtriser les données.
La dystopie la plus efficace est celle que l’on ne remarque pas
De quoi sera fait notre avenir ? De bio-ordinateurs cultivés en laboratoire, d’élevages de mammouths, de taxis volants pilotés par des agents IA et d’un journalisme où des « buddies » automatisés animeront des débats plus neutres que neutres, pendant que les dernières rédactions humaines, devenues accessoires, hésiteront entre s’aligner sur la vision de leurs milliardaires-propriétaires ou publier un édito multi-formats liquides généré par GPT-10 ? L’information sera-t-elle instantanée, pré-mâchée, filtrée par des algorithmes trop perfectionnés pour être remis en question ? La vérité (ou la véracité) deviendra-t-elle alors un concept nostalgique, relégué aux archives, entre un reportage deepfake et un podcast conçu sur mesure pour flatter chaque bulle cognitive ?
Mais à force d’éviter le réel, on finit par transformer la tech en spectacle et les médias en figurants.
SXSW est censé décrypter l’avenir. Mais à force d’éviter le réel, on finit par transformer la tech en spectacle et les médias en figurants. Entre deux futurologues aux styles radicalement opposés – Amy Webb, qui revendique une approche fondée sur l’analyse de données massives, et Scott Galloway, adepte du pur « gut feeling » – lequel choisir ? SXSW reste un cocktail unique mêlant tech, cinéma, divertissement, business, le tout infusé de débats sur la société et la santé, un format introuvable ailleurs… sauf peut-être à Londres, où la première édition britannique du festival se tiendra début juin. Avec, qui sait, un brin plus d’audace politique ?

Ce qui est sûr, c’est que la technologie – et une IA de plus en plus incarnée (robotique, machines, nouveaux matériaux, technologies de santé, comme on l’a déjà vu au CES) – ne fait pas que du bien à nos cerveaux. Ce graphique du Financial Times le dit sans détour : on s’appuie sur elle comme une béquille, alors qu’elle devrait être un accélérateur de réflexion – pour paraphraser (un peu librement) Yoshua Bengio. Alors que la lumière faiblit sur l’information, au point d’effacer le doute et la nuance, il est peut-être temps de relever la tête. D’exiger autre chose qu’un futur préécrit par des algorithmes et des patrons de la Big Tech. Et surtout, de prouver que les rédactions humaines ont encore une raison d’être. Finalement, la plus grande dystopie n’est peut-être pas celle des IA qui contrôlent tout. C’est celle où l’on s’habitue à tout, sans même s’en rendre compte.
Photos : KB

SXSW 2025 : Amy Webb prédit l’arrivée de « l’intelligence vivante »
Après le supercycle technologique de 2024, nous voilà arrivés dans l’ère de la « Living Intelligence », une fusion des avancées de l’IA et de la biotechnologie. Amy Webb, figure incontournable du South by Southwest depuis près de vingt ans, où elle dévoile chaque année plusieurs centaines de tendances devant un public de fans conquis, observe que nous avons franchi un cap : nous sommes dans le « Beyond », un au-delà où la technologie évolue plus vite que notre capacité à en appréhender l’impact à moyen et long terme.
Par Kati Bremme, Directrice de l’Innovation et Rédactrice en chef de Méta-Media
Tout d’abord, la futuriste Open Source (dont le rapport de 1000 pages est disponible gratuitement) invite son audience à s’asseoir sur les petits dés en bois distribués aux heureux participants de sa keynote, « pour ressentir l’équivalent d’un caillou dans la chaussure », un obstacle qui nous empêcherait de prendre de bonnes décisions – cette pierre pouvant symboliser, par exemple, la masse obscène d’articles publiés chaque jour sur l’IA. Une mise en miroir avec un chiffre : d’ici 2030, plus de 125 milliards d’appareils connectés produiront en continu des données comportementales, renforçant la capacité des Large Action Models à apprendre et à agir de manière autonome. Imaginons alors de les connecter directement à la matière biologique…
Pour Amy Webb, nous avons franchi un cap : nous sommes arrivés dans l’« au-delà » (Beyond). Au-delà des explications possibles, nous avons dépassé un monde que la science pouvait encore pleinement décrire, surtout si l’on s’imagine que, selon les dernières recherches, la quantité de plastique présente dans notre cerveau pourrait équivaloir à celle contenue dans une cuillère (de plastique).

Les réseaux neuronaux fonctionnent désormais comme des boîtes noires, où des corrélations statistiques apprises à partir de milliards de paramètres produisent des résultats difficilement rattachables à des règles compréhensibles ou prédictibles (aussi peu prédictibles que les humains finalement), et l’homme augmenté par la science n’est plus une utopie, comme en témoigne l’idée d’un concours Enhanced Games (des Jeux augmentés), où l’optimisation du corps humain est poussée à l’absurde, les athlètes étant dopés aux technologies et substances les plus avancées (une idée qui a déjà séduit des investisseurs comme Peter Thiel, entre autres).
Ce qui est à la pointe aujourd’hui pourrait être dépassé d’ici la fin de la journée.
Amy Webb
Seule limite imposée : ne pas mourir avant de concourir. Tout évolue si vite que nous n’avons même pas le temps d’envisager où fixer les limites de ce progrès (ce qui arrange bien certaines entreprises), et même la futurologue la plus célèbre du monde y perd son latin, nous situant dans ce flou « Beyond ». De la FOMO (Fear of Missing Out), nous sommes passés à la FOMA (Fear of Missing Anything). Tout s’accélère : « What’s bleeding edge today might be old news later today » (Ce qui est à la pointe aujourd’hui pourrait être dépassé d’ici la fin de la journée).
IA & Capteurs, une équipe gagnante
Le premier des trois clusters mis en avant dans sa présentation cette année (en 2024, les thématiques étaient l’IA, l’IoT et la biotech) est celui de l’IA + Capteurs. L’IA et les Large Language Models deviennent de plus en plus accessibles : DeepSeek a prouvé qu’il n’était nullement nécessaire de disposer d’usines à gaz – pardon, de semi-conducteurs – pour obtenir des performances avancées, et Stanford a suivi cette tendance en dévoilant S1, un modèle au coût dérisoire de 50 dollars. Mais la véritable nouveauté réside dans les MAS (Multi-Agent Systems), des systèmes multi-agents capables de collaborer, de se répartir les tâches et de se superviser mutuellement, le tout sans aucune intervention humaine. Avec des résultats parfois inquiétants : elle cite une expérimentation menée par la DARPA, ainsi qu’une autre où des agents introduits dans la plateforme de jeux Minecraft, laissés sans supervision humaine, ont d’abord instauré leurs propres lois et réglementations, avant d’aller jusqu’à créer de nouvelles religions.

Avec un constat consternant : notre langage naturel, sur lequel sont basés les grands modèles de langage, ralentirait le travail de ces agents artificiels, qui préfèrent communiquer sans biais ni mauvaise interprétation. Microsoft, comme souvent, a la solution, sous la forme de DroidSpeak. On revient au langage machine, ces dernières n’ayant plus besoin de nous. Jensen Huang l’avait annoncé au CES (cf. notre papier sur l’événement cette année) : l’IA a besoin de devenir « physique » (ou incarnée) pour avancer. Et dans cette étape, elle a peut-être encore besoin d’un peu de matière biologique, comme dans cet exemple de RoHM, Robust Human Motion Reconstruction via Diffusion, proposé par Siwei Zhang.
Les réseaux de capteurs font évoluer l’IA d’un rôle d’observateur à une position de contrôle.
Amy Webb
Et quelle meilleure incarnation de l’IA qu’à travers nos cerveaux ? On peut depuis longtemps retracer le récit de nos rêves, pourquoi ne pas utiliser des cellules de cerveau pour alimenter les réseaux neuronaux ?

L’IA incarnée (Embodied AI) repose(ra) idéalement sur un protocole de contexte modèle (Model Context Protocol), un peu comme le HTTP pour Internet, permettant de connecter des données issues de capteurs d’IA. L’enjeu est de relier les modèles d’IA aux capteurs pour une interaction plus fluide entre le monde physique et les algorithmes. L’ultime incarnation de cette technologie reste notre propre cerveau, capable non seulement d’enregistrer des données mais aussi de les rejouer, ouvrant ainsi la voie à des formes avancées de mémoire numérique. Dans cette dynamique, les réseaux de capteurs transforment l’IA, qui passe du simple rôle d’observateur à celui de contrôleur, influençant directement son environnement. Mais jusqu’où cette fusion doit-elle aller ? Que se passe-t-il si votre employeur exige demain que vous vous fassiez implanter une puce (fournie par Elon Musk) ?
IA & Biologie, les frontières de la matière repoussées
Le deuxième cluster présenté, dans la même veine, est la combinaison de l’IA et de la biologie. Les règles de cette discipline scientifique sont autant ébranlées que celles de notre vieux monde des médias. La biologie générative se fraye un chemin, là encore plus rapidement que notre capacité à la comprendre. AlphaFold 3, développé par DeepMind de Google, marque une rupture dans la biologie computationnelle. Son serveur, accessible à tous, permet de prédire avec une précision inédite la structure des protéines et d’autres biomolécules.

Par exemple, AlphaFold 2 avait déjà prédit la structure de plus de 200 millions de protéines, couvrant pratiquement toutes celles connues de la science. La nouvelle version va plus loin en intégrant des interactions moléculaires complexes, avec des implications directes pour la conception de médicaments ou la biotechnologie. Ce type d’outil ne se limite pas à la recherche académique : il reconfigure aussi les stratégies des entreprises travaillant sur des produits physiques, qu’il s’agisse de matériaux, de thérapies ou d’agriculture.
Exit le métavers, trop conceptuel, place aux méta-matériaux : des matériaux synthétiques qui dépassent les limites de la chimie traditionnelle et du tableau périodique des éléments en introduisant de nouvelles propriétés et des comportements inédits. L’innovation pourra ainsi repousser les frontières du monde physique. Amy Webb explore alors des scénarios tout sauf skeuomorphiques : du riz combiné à des protéines de vache, des dents humaines cultivées dans des cochons (ah, en fait, celui-là est déjà une réalité), un mur de bâtiment fonctionnant comme un cerveau humain ou doté de propriétés élastiques et, enfin (on y arrive), l’utilisation de cellules cérébrales humaines pour accélérer le calcul des IA – une réponse possible à la forte demande énergétique de ces technologies. D’ailleurs, la nouvelle centrale nucléaire de Microsoft à Three Mile Island, rebaptisée Crane Clean Energy Center, devrait ouvrir en 2028…

La startup australienne Corticol Labs, cultive de véritables neurones directement sur des puces sur mesure, créant une intelligence qui « apprend de manière intuitive avec une efficacité remarquable ». Utopie ? Cortical Labs vient juste de dévoiler CL1, le premier bio-ordinateur fonctionnel proposé à 35 000 dollars, et devance en cela FinalSpark, une startup suisse qui travaille également sur le premier bioprocesseur, alternative aux puces classiques.

Les règles de l’informatique sont bouleversées avec l’arrivée de la première machine vivante…
Biologie & Capteurs, et IA
Le troisième cluster présenté par Amy Webb est celui de la combinaison de la biologie, des capteurs et de l’IA, qui nous amène dans une nouvelle ère de robots hyperefficaces et beaucoup moins maladroits que leurs ancètres. Les interfaces entre biologie et technologie s’affinent avec des innovations qui repoussent les frontières du vivant. Shoji Takeuchi explore l’idée du Skin Mask, une interface organique qui pourrait fusionner avec la peau, tandis qu’il affirme que nous sommes tous, en quelque sorte, des robots mous (squishy robots). Dans cette même dynamique, le moteur des flagelles bactériens permet à des microbes modifiés de générer leur propre électricité, ouvrant la voie à des bio-machines autonomes.
L’innovation ne s’arrête pas là : après les sperm bots introduits en 2016 par des chercheurs allemands, des wearables biologiques se développent en complément de la pharmacie traditionnelle, non plus pour les humains, mais pour leurs cellules – des dispositifs qui pourraient guider, réparer ou optimiser le fonctionnement des neurones ou même des gamètes. Une fusion toujours plus intime entre le vivant et l’artificiel. Les machines microscopiques nous donneront-elles du pouvoir sur la nature ? Pourquoi alors ne pas envisager la peau de rhinocéros synthétique comme alternative au métal ?

Selon Amy Webb, l’ère qui s’ouvre dépasse l’intelligence artificielle telle que nous la concevons aujourd’hui : une intelligence vivante émerge, mêlant IA, biologie et monde physique dans un écosystème interconnecté. Pourtant, nous ne sommes pas prêts. Chacun se concentre sur des avancées isolées sans prendre de recul pour comprendre l’ensemble du paysage. La robotique est déjà profondément impactée. Pendant des années, les robots ont stagné, incapables de gérer le désordre du monde réel, un obstacle majeur à leur adoption en dehors des environnements contrôlés. Mais les choses évoluent : DeepMind de Google vient tout juste d’apprendre à un robot à se lacer les chaussures, une avancée qui semble anodine mais qui marque une rupture.
Chacun se concentre sur des avancées isolées sans prendre de recul pour comprendre l’ensemble du paysage.
Amy Webb
L’autonomie des machines dans des tâches complexes du quotidien n’est plus une simple projection théorique, elle devient réalité. Anand Mishra explore une nouvelle frontière de la robotique avec des machines hybrides mêlant biologie et technologie. L’un des exemples les plus marquants est un robot dont le cerveau est composé de champignons, fusionnant ainsi des éléments organiques et artificiels pour créer une intelligence alternative. Cette approche biohybride se retrouve aussi dans des projets comme la méduse robotique développée par Caltech, combinant organismes vivants et structures mécaniques, à l’aide de l’impression 3D, une technologie fort utile dans de longs voyages à la conquête de l’espace par ailleurs. Après des décennies de promesses et de prototypes limités, l’ère des robots semble enfin être une réalité tangible, avec des machines, qui ne se contentent pas d’imiter l’humain.

De l’IA abstraite à l’IA incarnée : pourquoi nous sommes tous concernés
Pourquoi les Big Tech investissent-elles autant dans la robotique ? Parce que les robots sont une condition essentielle pour atteindre l’intelligence artificielle générale (AGI). Sans incarnation physique, l’AGI reste un concept abstrait, incapable d’interagir pleinement avec le monde réel. De la même manière que l’intelligence humaine ne peut exister sans un corps pour percevoir, agir et apprendre, une intelligence artificielle véritablement autonome a besoin d’une forme physique pour dépasser les limites du traitement purement numérique. Pour les géants de la tech, la robotique n’est donc pas un simple marché, mais un passage obligé vers une IA réellement intégrée au monde matériel. Une évolution qui avance à grands pas et dont nous ne pourrons pas rester simples spectateurs.
On pourrait alors se poser la question : en quoi cela nous concerne-t-il, nous, médias ? La réponse est simple, et double : ces technologies, de la vision par ordinateur à la robotique, auront inévitablement un impact sur nos outils et nos métiers de demain. Mais plus encore, elles transformeront la société dans son ensemble. Même si toutes ces technologies ne sont pas encore pleinement déployées ni totalement abouties, il est dès à présent essentiel de s’interroger sur la manière dont nous envisageons notre cohabitation avec des IA potentiellement de plus en plus puissantes… à moins qu’elles ne s’effondrent d’épuisement intellectuel dans un futur proche.
Il ne suffit pas de flairer les tendances, encore faut-il les transformer en scénarios activables, taillés sur mesure pour chaque entreprise, sous peine de se contenter de prédictions creuses. Le Future Today Institute l’a bien compris : en se rebaptisant Future Today Strategy Group, il affiche clairement son ambition d’accompagner le changement plutôt que de regarder l’Intelligence Vivante prendre les rênes. Car pendant que l’IA s’incarne, fusionne avec le biologique et colonise le physique, nous continuons à en débattre comme si le futur nous attendait sagement. Mais qui façonnera réellement la suite : des stratégies humaines ou des algorithmes livrés à eux-mêmes ? L’IA a besoin de s’incarner pour aller plus loin. Mais nous, humains, de quoi avons-nous besoin ?

Take-aways
Les 10 points clés à retenir des 1000 pages du rapport, selon Amy Webb :
· Intelligence vivante : IA, capteurs et biotech fusionnent pour créer des systèmes autonomes et évolutifs.
· Modèles d’action : L’IA passe de la parole aux actes, redéfinissant l’automatisation.
· Robots autonomes : Ils quittent les usines grâce à des avancées en adaptabilité.
· IA agentique : Des systèmes prennent leurs propres décisions et amplifient l’expertise humaine.
· Alliances tech : La demande en données et calcul pousse d’anciens rivaux à collaborer.
· Climat & innovation : Les crises accélèrent l’adoption de nouvelles technologies.
· Retour du nucléaire : L’IA dope les investissements dans les petits réacteurs modulaires.
· Informatique quantique : La correction d’erreurs ouvre la voie à des usages concrets.
· Métamatériaux : De nouvelles structures révolutionnent l’ingénierie.
· Espace cislunaire : Le privé investit entre Terre et Lune, transformant le commerce spatial.
Illustration de l’article : Capture de la présentation d’Amy Webb, avec Kevin, un chien qui pourrait bien bénéficier de la biotechnologie connectée pour retrouver son poids de forme…
L’Intelligence de la plume dans la plaie Artificielle
C’est au retour d’un périple en Afrique qu’Albert Londres eut cette formule en ouverture de son livre ‘Terre d’ébène’ : « Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » La formule est restée célèbre. Le reporter répondait ainsi aux violentes attaques du lobby colonial qui tentait de faire taire celui qui dénonçait les traitements inhumains réservés aux travailleurs noirs sur les travaux de la voie ferrée Congo Océan en 1929. Aujourd’hui, c’est une question autrement plus complexe qui agite (entre autres) le monde de l’information, l’usage de l’IA souvent perçu comme une menace particulièrement redoutable. Mise au goût du jour, la formule serait alors la suivante : L’intelligence de la plume dans la plaie artificielle.
Par Hervé Brusini, président du Prix Albert Londres, ancien rédacteur en chef de France Télévisions

The Sea Shepherds, AI documentary in Somalia (1976) Stanislas de Livonnière
Re-présenter un récit
Le document est confondant. Et cela dès la première image (disponible sur Youtube). Deux jeunes hommes noirs semblent nous fixer. Ils sont filmés à hauteur de buste. Derrière eux, un désert craquelé, et une vache étendue, morte. La caméra se déplace vers la droite et dévoile la présence d’un troisième personnage … En quelques secondes, le résumé iconique d’une situation humanitaire visiblement désespérée. En voix off, le commentaire anglais confirme : « Pasteurs depuis des millénaires, ils ne connaissent que leurs troupeaux, les points d’eau et le coran… Une errance ancestrale brutalement interrompue par la sécheresse… » Puis c’est un plan en hauteur tourné grâce à ce qu’on imagine être un drone. On aperçoit comme un village bidonville du désert. Un plan très rapproché du museau d’un chameau signale un retour sur terre plutôt sinistre. « 17 000 morts, 700 000 bovins, 200 000 chameaux, 2 millions 300 000 chèvres et moutons décimés, de larges étendues de territoire dévastées », poursuit le commentaire. Et de nous montrer une masse d’animaux en train d’agoniser. Lent travelling macabre, éclatant de couleurs sous un ciel brumeux, avec quelques rares nuages. Très au loin des montagnes, plus près, des cases en terre. Un décor de poussière, de mort. « Une ‘catastrophe’ à l’échelle de ce petit pays de 3 millions 500 000 âmes… » vient ponctuer le commentaire à la quarantième seconde de cette vidéo de 4 minutes 32, décidément édifiante.
La suite du récit est celle d’un transfert de population organisé avec les moyens de l’armée soviétique de l’époque. Convois de camions, avions Iliouchine, et les pasteurs de se retrouver au bord de l’Océan Indien. Tous devenus pêcheurs. Brutale transition pour ces femmes et ces hommes qui n’avaient jamais croisé ces machines, ces uniformes, cette mer… Tout cela, sous vos yeux, avec bruit de moteurs, clapotis des vagues, gros plans des visages et musique locale… A une remarque près, et la précision figure dès l’ouverture : « Histoire vraie » est-il affiché, mais avec « son et image de synthèse. Barawe, Somalie, 1975 ». Autrement dit, c’était il y a 50 ans, et tout ce qui est montré, comme tout ce qui se fait entendre est entièrement réalisé par IA. La stupéfaction est d’autant plus forte qu’à l’issue du document, une mention dévoile d’où vient cette histoire : « D’après un reportage de Christian Hoche prix Albert Londres 1978 ». Autrement dit, vous voilà en somme, en présence du premier prix Albert Londres de presse écrite reconstitué en vidéo via les technologies génératives. De quoi nourrir plus qu’une curiosité à l’endroit de l’auteur et de ses intentions. « Je travaille un peu comme un dessinateur de BD, explique Stanislas de Livonnière, responsable de la cellule Data et innovation au Parisien Aujourd’hui en France. Je suis passionné par le story board à mettre en place… Je suis tombé par hasard sur l’article de C. Hoche. Signé par un journaliste rigoureux, le texte constitue la base de ma fabrication. Je détermine ensuite les plans, les cadres en détaillant tout ce qui les compose au son comme à l’image, jusqu’au vieillissement des chemises des somaliens. Pour fabriquer ce film, j’ai mobilisé une douzaine de technos, vidéos ou photos, dont certaines sont interdites en France. Ça m’a pris à peine quelques jours, nous avons maintenant les moyens d’Hollywood à notre disposition pour illustrer, reconstituer, le passé, le présent ou le futur. C’est une véritable nouvelle frontière qui s’ouvre pour le journalisme. L’invention m’intéresse pour faire mieux. Un nouveau métier est en train de naître… »
Cette histoire d’histoires a des allures de parabole décodable au gré des points de vue.
Le refus de l’IA par principe
On peut y voir l’horreur à ne surtout pas commettre. L’intrusion de « l’image artificielle » dans le sanctuaire de l’information, du réel. La manipulation y est d’emblée liée au pixel. Par principe, l’opposition à l’innovation du moment, recommande de la combattre, ou à tout le moins de s’éloigner d’un pareil usage. Et la multiplicité des risques d’être passés en revue, du mensonge à la fake news, en passant par les biais les plus extravagants. Sans compter avec les cauchemars du reporter qui se verrait désormais inutile. La présence sur le terrain des guerres ou des catastrophes étant « imaginée » par l’artifice numérique, vivent les économies générées par le système du calcul au plein sens du terme.
Certes, ces périls sont bien réels et l’éducation aux médias come la vigilance du métier s’avèrent indispensables. Mais l’IA est bien là, comme une déferlante mondiale. Le souci salutaire de la déontologie oblige à mentionner le recours à ce moyen nouveau. Un garde-fou que l’on peut juger modeste. Son mérite est néanmoins de garantir une visibilité, même si – pour risquer une comparaison hasardeuse – le nutriscore n’empêche pas la consommation de produits délétères. De plus, à l’échelle européenne aussi, les dérives, les risques engendrés par la technologie nouvelle sont pris en compte par l’IA Act entré en vigueur ce 2 février. L’ambition étant de « construire une IA digne de confiance » grâce à la réglementation mise en place.
Un effet inattendu de l’IA

Pour autant, la parabole des « bergers de l’océan » peut avoir une autre lecture. On l’a vu, ici utilisée comme technique de reconstitution, l’IA oblige à un retour sur l’élément d’origine. Ainsi la mise en images de l’article de Christian Hoche interroge le propre travail du reporter. Comment a-t-il conduit son enquête ? Qui a-t-il interviewé ? Où s’est-il rendu ? Quel était l’environnement ? Comment était l’intérieur d’une maison, les vêtements portés, la lumière ambiante…? Les questions sont innombrables. A commencer par celle-ci : Que dit le reporter directement concerné par la « mise en images » de son papier paru dans l’Express il y a 50 ans ? Est-ce que le travail de re-présentation du jeune confrère expert en IA, correspond au vécu de l’ancien journaliste de terrain ?
« De fait, je n’ai pas été le témoin direct de cette histoire, affirme C. Hoche. Quand je suis arrivé en Somalie, ils ont été plusieurs à me la raconter. Alors j’ai commencé un travail d’enquête d’après- coup, si l’on peut dire. J’ai rencontré les interlocuteurs qui l’avaient vécue, dont le président Siad Barré, un employé de la FAO et bien d’autres encore. J’ai donc pu vérifier, recouper ce récit. Alors, j’ai relaté cette incroyable épisode du drame somalien que j’ai intitulé ‘Les bergers de l’océan’. »
Voilà donc une conséquence inattendue causée par l’usage de l’IA. Cette dernière interroge en retour le geste journalistique sur lequel elle s’appuie. La précision des indications données à la machine pour re-créer une réalité artificielle oblige à revenir à la source. Par cet effet feedback, par ce qui est l’apprentissage sans fin dont elle se nourrit, oserait-on dire que l’IA examine le journalisme ? En tout cas, elle pose de nombreuses questions de fond, et en premier lieu, celle de l’image dans l’information. On le sait, elle est prétexte, au cœur d’une action, explicative, illustrative, datée. Mais ce savoir est relatif. La nomenclature est quasi inexistante, elle est pourtant en quelque sorte mise à l’épreuve à chaque instant, en ces temps où l’on parle de ‘civilisation de l’image’ dans les médias sociaux, les plateformes et bien sûr les médias dits classiques. Peut-être ne faut-il pas de nomenclature…
Dans le cas précis des rapports entre IA et journalisme, cette interrogation en retour sur les pratiques professionnelles résonne de la même façon que dans les relations plus globales entre le monde numérique et le métier d’informer. Ce vaste débat a sans cesse pour référence, l’information dite de qualité. Un point crucial, souvent perçu comme une évidence au point de parfois virer à la tautologie. La qualité renvoyant à…la qualité. Avec certes au passage, la vérification, et l’honnêteté pour commencer timidement à définir ce « plus qualitatif » indispensable. Mais il reste bien du chemin à parcourir à travers l’histoire du journalisme pour l’aider à se comprendre, à se penser.
En somme, le vieux monde et sa plume dans la plaie se vivait comme une lutte face aux puissants et aux injustices de tout poil. Bourrage de crâne et censure étaient ses formes de répression. La modernité n’a guère changé l’existence de cette tension démocratique. En revanche, par la technologie, elle a ajouté un autre défi, le rapport de pouvoir intrinsèque celui-là aux discours, et donc au journalisme, dans son rapport au réel, à la vérité. Comment la produit-il ? Avec les mots, les images, l’écriture des histoires, la guerre des récits est à peu près partout déclarée. L’enjeu politique est considérable. Il y va aussi de l’écriture de l’Histoire.
Alors à n’en pas douter, pour relever un tel défi, il faudra un surcroît d’intelligence à la plume dans sa confrontation aux plaies artificielles.
CES 2025, l’IA partout, pour de vrai
« It gets physical », et pas seulement parce que la physique quantique figure parmi les thèmes (marketing) mis en avant lors du CES 2025, avec une demi-journée de conférences dédiée. L’« IA physique » – un concept clé issu de la keynote spectaculaire de Jensen Huang, PDG de Nvidia – illustre une tendance majeure. L’IA, incontestablement la vedette du salon, franchit cette année une nouvelle étape. Bien plus qu’un simple prototype, elle fait ses preuves, soutenue par un matériel de plus en plus accessible, au grand bonheur des gamers… et des modèles de fondation.
Nvidia incarne à merveille cette nouvelle dynamique où tout est connecté, tout devient intelligent. Une ascension qui lui a d’ailleurs récemment permis de dépasser Apple en capitalisation boursière. Bis repetita : une fois n’est pas coutume, la tendance se confirme en 2025 au CES et, bientôt, dans nos vies. L’IA s’immisce partout : dans tous les PC, les téléviseurs, les voitures et jusque dans nos foyers !
Par Vincent Nalpas, Directeur Innovation Produits, Yves-Marie Poirier, Ingénieur Direction de l’Innovation, et Kati Bremme, Directrice de l’Innovation et rédactrice en chef Méta-Media
Le CES, longtemps le rendez-vous incontournable des grandes annonces technologiques, a vu sa dynamique évoluer ces dernières années. Certaines grandes entreprises, comme Apple ou Google, ont réduit leur présence au salon, préférant des lancements plus ciblés pour maximiser leur visibilité. Pourtant, ce « labyrinthe étourdissant de gadgets », pour reprendre les mots d’un journaliste de Wired, reste un lieu unique où les startups et les entreprises en quête de reconnaissance peuvent transformer leur destin.
C’est aussi ici, au milieu des machines à sous, qu’en chaque début d’année, on peut prendre le pouls des professionnels (à travers des objets connectés toujours plus intelligents, bien sûr), distinguer ce qui relève du marketing de ce qui constitue un produit concret (Samsung, par exemple, présente pour la troisième fois son Ballie, mais cette fois avec un prix et une date de sortie annoncés) et, peut-être, tomber sur le produit capable de révolutionner nos usages.
Un exemple éloquent de cette dynamique est celui du Rabbit R1, présenté lors du CES 2024. Ce petit gadget orange promettait de révolutionner l’interaction utilisateur en automatisant des tâches aussi simples que commander un taxi ou acheter des billets de concert. Fort d’une promesse ambitieuse et d’une campagne médiatique percutante, il avait enregistré plus de 10 000 précommandes dès le premier jour. Mais à sa sortie, le produit a déçu par ses performances limitées, révélant les dangers d’une hype démesurée. Ce cas illustre à la fois la puissance et les pièges du CES, où le moindre prototype peut devenir viral avant même d’avoir prouvé sa valeur.
Rarely am I so captivated and inspired by a CEO’s keynote that it holds my attention for two hours, but Jensen Huang’s indefatigable energy (at 61 years old!) makes him one of the most inspiring and visionary leaders among tenured and authentic CEOs. His ability to innovate while… pic.twitter.com/fwAzGUHHZk
— Marc Benioff (@Benioff) January 7, 2025
Cette année, le contexte est particulier : Alors que Donald Trump s’apprête à revenir au pouvoir et que Sam Altman annonce l’avènement de l’intelligence artificielle générale (IAG), le paysage technologique semble à un tournant. Elon Musk, quant à lui, redessine les règles du jeu de la politique mondiale, avec ses multiples projets et provocations. Au croisement des conflits en Ukraine et à Gaza et de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, les tensions géopolitiques brouillent davantage les échanges technologiques mondiaux. D’après Bloomberg, l’administration Biden s’apprête à imposer une nouvelle salve de restrictions sur les exportations de puces d’intelligence artificielle vers la Chine. Malgré ces tentatives pour freiner l’accès d’entreprises comme ByteDance à des technologies de pointe, les acteurs chinois maintiennent leur présence sur les grandes scènes internationales. Au CES, ils constituent un quart des exposants…
“The IT department of every company is going to be the HR department of AI agents in the future.”
— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) January 7, 2025
– Jensen Huang (CEO @nvidia ) at CES 2025 pic.twitter.com/3L0qOol4M3
Ce que l’on a retenu : on a beau chercher dans les allées du CES, rares sont les produits qui ne mentionnent pas l’IA. Il va falloir faire avec, et surtout comprendre comment ces écosystèmes se mettent en place chez les industriels et les particuliers. Et ce ne sont pas les annonces de Nvidia, avec leur gamme déclinée autour de l’architecture Blackwell, qui viendront nous contredire.
Les smart glasses, ou lunettes connectées, reviennent également au cœur de cette édition 2025, avec de nombreux modèles présentés et une montée en gamme, même si le résultat n’est pas toujours convaincant. De même, on retrouve cette année encore des équipementiers en télécommunications exposer des voitures, tandis que les fournisseurs de contenus s’invitent au cœur des stratégies marketing des constructeurs automobiles connectés à la 5G. On n’achètera bientôt plus une voiture simplement pour son confort, son moteur ou sa sécurité, mais aussi – et peut-être un jour surtout – pour son offre de contenus de divertissement ou sa console de jeux. Une perspective d’autant plus crédible si cette voiture est autonome, une technologie qui pourrait enfin décoller cette année grâce au lobbying particulièrement intéressé d’Elon Musk.

Au CES, les tendances à plus ou moins long terme prennent forme de manière tangible. Certaines innovations annoncées il y a trois ans continuent de faire parler d’elles, comme la très attendue Afeela, fruit du partenariat entre Honda et Sony, qui s’accompagne cette fois d’un prix et d’une date de sortie. Du côté des constructeurs de téléviseurs, qui rivalisaient autrefois pour offrir les stands les plus impressionnants et les écrans les plus spectaculaires, on observe une certaine homogénéisation autour des mégas formats de 115 pouces – tout de même ! – et des déclinaisons de la TV-tableau, popularisée par le Samsung The Frame, pionnier du genre.
Un hall entier, consacré à la « mobilité avancée », met en lumière les véhicules et les équipementiers présentant des technologies destinées à renforcer la sécurité, à améliorer le confort intérieur, et à favoriser la circulation progressive des véhicules autonomes. La « mobilité urbaine » reste également à l’honneur cette année, avec une multitude de modèles électriques et quelques propositions futuristes, comme cet hélicoptère portable qui se range dans le coffre d’une voiture.
Waouh (2023), How (2024), Now : L’IA physique au croisement de l’industrie et des données
Nvidia a frappé un grand coup avec une série d’annonces qui feront date. En tête d’affiche, la nouvelle génération de cartes graphiques 50XX, reposant sur l’architecture Blackwell, promet des performances vertigineuses, que ce soit pour l’intelligence artificielle ou les jeux vidéo. Et ce n’est pas tout : le Projet Digits, un gadget à la fois compact et élégant, ouvre la voie à un « cloud IA personnel ». Autrement dit, un superordinateur de poche qui pourrait bien révolutionner la manière dont les particuliers et les entreprises interagissent avec l’IA.

Jensen Huang, PDG emblématique de Nvidia, a présenté trois axes stratégiques pour l’avenir de l’intelligence artificielle. D’abord, l’IA générative, capable de produire du contenu ; ensuite, l’IA Agent, qui permet de concevoir des agents autonomes ; enfin, l’IA physique, qui s’attaque à un défi colossal : recréer fidèlement les lois de la physique dans des environnements simulés. Ce dernier volet, véritable pierre angulaire du projet Nvidia Cosmos, prend la forme d’une initiative open source visant à reproduire le monde réel avec une précision chirurgicale. Un pied de nez à ceux qui affirment que les IA génératives ne comprennent pas la réalité. Avec l’IA physique, Nvidia envisage des percées spectaculaires, notamment dans l’entraînement des robots et des véhicules autonomes.
Jensen Huang shows off the NVIDIA GB200 NVL72: a data center superchip with 72 Blackwell GPUs, 1.4 exaFLOPS of compute and 130 trillion transistors pic.twitter.com/h4LaNrL7Hm
— Tsarathustra (@tsarnick) January 7, 2025
Pour Nvidia, l’IA physique s’inscrit dans une ambition plus vaste : dominer le marché des centres de données. La création de simulations d’une telle qualité exige des infrastructures colossales, à grand renfort de racks et de racks de puces accélératrices. Objectif : bâtir un monde où les robots viendront pallier la baisse des taux de natalité dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud. « Ces nations doivent impérativement miser sur des solutions robotiques pour maintenir leur productivité », martèle Huang.
Pendant ce temps, AMD n’entend pas rester sur la touche et riposte avec sa propre gamme de cartes graphiques et de puces pensées pour des PC boostés à l’IA. LG, de son côté, ne manque pas d’ambition non plus avec sa ligne de PC IA intégrant un assistant intelligent, sobrement baptisé Gram IA.
Toute cette puissance de calcul est nécessaire pour proposer enfin ces fameuses expériences ultrapersonnalisées annoncées depuis des années…
Le targeting social est mort, vive l’IA adaptative !
Lors des tables rondes, des experts tels que Shinal Shah (Zip Bank) n’ont pas mâché leurs mots à l’égard des outils actuels comme les jumeaux numériques, jugés trop approximatifs. Pour eux, la solution réside dans l’IA générative, qui inaugure une nouvelle ère pour la publicité : celle d’un contenu hyperpersonnalisé, réajusté en temps réel. Exit le ciblage traditionnel, place à des expériences interactives où l’engagement devient le nouvel indicateur clé. Les publicités se métamorphosent en conseillers virtuels capables de tenir une conversation fluide, comme le démontre déjà Advice. Et ce n’est que le début : dans certains cas, l’IA a carrément pris les rênes de la direction artistique. Qui sait ? Les agents créatifs artificiels pourraient bientôt ouvrir leur propre agence…
Du côté de Microsoft, l’IA devient la nouvelle interface utilisateur (UI), un saut de géant depuis les balbutiements d’Ask Jeeves en 1996. Alors que les IA conversationnelles avaient jusque-là des capacités limitées, l’année 2025 marque un véritable tournant. OpenAI avec O3, xAI grâce à Grok 3.0, ou encore Deepseek et son modèle open source 50 fois plus performant que ChatGPT, bousculent l’ordre établi. Les chatbots traditionnels laissent place à des agents intelligents, capables de s’adapter aux besoins complexes des utilisateurs.

Cette révolution technologique, loin de rester confinée aux entreprises, s’invite dans les foyers. Désormais, un assistant intelligent dans le salon peut aussi bien conseiller sur des projets complexes que servir de compagnon de discussion. Avec cette avancée fulgurante, les entreprises doivent impérativement ajuster leurs stratégies pour ne pas se retrouver sur la touche.
L’IA conversationnelle n’est plus un simple gadget, elle redéfinit la manière dont nous interagissons avec la technologie et transforme profondément notre quotidien. Et dans cette course, seuls ceux qui sauront embrasser l’IA adaptative en sortiront vainqueurs.
Maison connectée : à chacun son assistant intelligent
Samsung et TCL rivalisent d’ingéniosité avec des produits conçus pour se déplacer dans nos foyers et accomplir une série de tâches, parfois utiles… parfois accessoires. TCL a levé le voile sur HEYAIME, un prototype de robot équipé de caméras et de micros, propulsé par l’IA. Sa promesse ? Garder un œil sur les enfants et devenir le compagnon incontournable de la famille. Reste à voir si ce projet verra réellement le jour ou s’il rejoindra le cimetière des annonces spectaculaires sans lendemain.
Du côté de Samsung, Ballie, le robot compagnon pour la maison, sera enfin lancé sur le marché à la mi-2025. LG, pour sa part, joue la carte du majordome numérique avec un assistant dopé à l’IA capable d’orchestrer les objets connectés du domicile tout en prodiguant des conseils personnalisés aux habitants.
Meet your friendly neighborhood robot, Mirokaï, from @EnchantedTools. With real-time interactive facial expressions, Mirokaï fosters joy and connection through human interaction. @briantong 🤖 👋 pic.twitter.com/etWapsH2h5
— CES (@CES) January 7, 2025
Lundi, lors de sa conférence à Las Vegas, TCL a également présenté Ai Me, un concept de robot domestique au design pour le moins original, évoquant un œuf de Pâques géant. Si les spécifications techniques restent floues, Ai Me devrait, à l’instar de Ballie, orchestrer les objets connectés de la maison, reconnaître des images et engager des dialogues avec ses utilisateurs. Derrière ses allures mignonnes se cache cependant une collecte massive de données, indispensable au développement de l’IA, mais qui soulève inévitablement des questions éthiques.
Avec cette invasion d’assistants domestiques, le défi est clair : concilier la soif insatiable de données des IA avec la protection de la vie privée. Une solution prometteuse : l’utilisation du « on device » (ou edge computing), où le traitement des données se fait directement sur l’appareil, minimisant les risques d’interférences malveillantes.

Tout ce beau monde devra, dans l’idéal, être capable de communiquer pour offrir une expérience utilisateur fluide et sans failles. Bonne nouvelle : la certification Matter permettra aux appareils connectés pour la maison d’obtenir les badges « Works With » de Samsung, Google et Apple, simplifiant ainsi le processus pour les fabricants, a annoncé la Connectivity Standards Alliance.
La TV, le nouveau smartphone
Les téléviseurs continuent d’éblouir par leurs avancées technologiques, tout en redoublant d’efforts pour offrir « une valeur ajoutée » qui dépasse le simple écran. Mais parlons d’abord des écrans : quelle que soit la norme utilisée (MicroLed, MiniLed, QLed, etc.), on retrouve des téléviseurs toujours plus lumineux, avec des noirs d’une profondeur saisissante.
Les formats, eux, atteignent des proportions gigantesques. Cette année, Hisense a présenté le plus grand téléviseur MiniLed au monde, avec une diagonale impressionnante de 116 pouces. Samsung, de son côté, innove avec une nouvelle norme de TV « RGB Micro Led » qui promet une qualité d’image exceptionnelle, offrant des couleurs plus nettes, plus profondes et plus intenses, tout en réduisant la consommation énergétique. Une prouesse qui a valu à Samsung un Innovation Award. Autre nouveauté marquante chez le géant coréen : un écran Neo QLed « The Frame Pro » de 85 pouces, équipé d’un boîtier déporté sans fil. LG n’est pas en reste et suit la tendance avec sa nouvelle gamme de téléviseurs Oled de la série G5, intégrant un taux de rafraîchissement augmenté jusqu’à 165 Hz.

Avec ces avancées, les téléviseurs ne se contentent plus de simplement afficher des images : ils repoussent les limites de la technologie et redéfinissent l’expérience audiovisuelle. Du côté des écrans de gaming, les taux de rafraîchissement atteignent des sommets vertigineux : 500 Hz chez Samsung et jusqu’à 750 Hz chez Korui.
Mais c’est surtout que, cette année, ces écrans intègrent de multiples fonctionnalités intelligentes. La programmation télévisée grand public de Samsung propose une variété de fonctionnalités d’IA conçues pour tout faire, de l’amélioration de la qualité vidéo à l’identification des acteurs à l’écran. Les téléviseurs Samsung Vision AI sont dotés de traduction en temps réel, de la capacité à s’adapter aux préférences des utilisateurs, de la mise à l’échelle optimisée par IA et de résumés instantanés de contenu.
Même chose du côté de Google, qui, en pleine tempête de Google Overview, propose des résumés d’actualités propulsés par l’IA sur ses écrans, grâce à l’intégration de son assistant IA Gemini au sein de son système d’exploitation pour télévision, Google TV. TechCrunch évoque même la diffusion d’un résumé d’actualités automatique en vidéo. Baptisé “News Brief”, ces résumés seront constitués à partir de titres de vidéos d’information diffusées sur YouTube par des médias TV « considérés comme fiables » et d’articles d’actualité diffusés sur le web.
Il est évident que Google veut asseoir davantage encore ses positions dans le téléviseur, écosystème où il est de plus en plus présent via YouTube et Google TV. Google prévoit de déployer ces nouvelles capacités sur les appareils Google TV d’ici la fin de l’année, bien qu’il reste incertain si les résumés incluront des citations ou des liens vers les sources originales. Le groupe a aussi annoncé d’autres fonctionnalités autour de l’IA dans Google TV, comme le pilotage de la domotique et une interaction vocale avec le téléspectateur, là encore à partir de l’IA, avec la capacité de tenir une conversation naturelle.
Avec des contenus qui, grâce à l’IA générative, deviennent de plus en plus liquides (on peut passer aisément d’un texte à un format podcast ou encore vidéo), le téléviseur semble avoir encore quelques beaux jours devant lui.
2025, l’année YouTube
Delta Airlines, platinum sponsor de l’événement, confirme sa transformation en véritable compagnie de divertissement. Cette année, elle a choisi de marquer les esprits en organisant sa keynote dans la célèbre Sphere, une salle de spectacle immersive pouvant accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs. Mais la surprise ne s’arrête pas là : pour les divertissements proposés à bord de ses avions, Delta n’a pas opté pour Netflix, mais pour YouTube. Un choix stratégique visant à renforcer le lien entre les créateurs de contenus et les clients de la compagnie.
L’année 2024 restera gravée dans les mémoires comme celle où les médias des créateurs ont surpassé les médias d’entreprise en termes de pertinence mondiale. En 2025, la capitale mondiale des médias semble se déplacer, quittant Hollywood et New York pour s’installer dans la sphère des créateurs. Chaque jour, 1 milliard d’heures de YouTube sont visionnées sur des téléviseurs, faisant de la plateforme la chaîne la plus regardée à la télévision.
L’année 2025 confirmera-t-elle la domination de YouTube sur tous les écrans, y compris dans l’air ?
Les mondes infinies de Sony
Le conglomérat japonais a rappelé sa présence dans presque tous les aspects de la création de contenus, du matériel, avec ses caméras et ses casques (audio ou XR), au contenu, avec Crunchyroll, Playstation et les divers films, jeux et séries adaptés de leurs différentes licences, en passant par le sport. Sony a remis en avant ses partenariats dans le domaine sportif, notamment avec Hawk-Eye, Beyond Sport et des fédérations comme la NFL. Leur objectif est clair : offrir des retransmissions sportives en 3D temps réel, transformant l’expérience des spectateurs.
La conférence a aussi été l’occasion pour Sony de dévoiler sa plateforme Xyn, dédiée aux créateurs. Accompagnée du casque XR Xyn, cette plateforme est conçue pour faciliter la production de contenus immersifs.
Les lunettes connectées deviennent réalité
La croissance des casques AR/VR continue de ne pas répondre aux attentes. Les professionnels de l’AR/VR ne devraient pas trop désespérer – comme le montre l’industrie des voitures autonomes, les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre (du moins si la technologie s’améliore). Si les casques XR ont longtemps dominé les discussions sur la réalité augmentée, les lunettes connectées reprennent cette année le devant de la scène. Au CES 2025, elles attirent davantage l’attention que les équipements volumineux, grâce à des designs plus discrets et des fonctionnalités toujours plus avancées.

De manière générale, même hors CES, deux stratégies distinctes s’observent sur ce marché : certains fabricants cherchent à miniaturiser les casques volumineux, comme Apple avec son Vision Pro ou Meta avec la gamme Quest, tandis que d’autres partent de lunettes au design classique, essayant d’y intégrer un maximum de technologies sans compromettre leur esthétique, à l’image des Meta Ray-Ban.
Parmi les innovations présentées, certaines lunettes se contentent d’offrir des écrans discrets connectés à un smartphone ou à un ordinateur. Ces écrans, parfois intégrés directement dans les lentilles, permettent d’afficher du texte monochrome (pour les modèles les plus rudimentaires) avec des fonctions telles que la traduction ou la navigation, ou encore des vidéos en HD pour des usages plus immersifs.
D’autres modèles, comme la gamme Rayneo X Series de TCL, ajoutent des fonctionnalités audio, une caméra et un assistant IA, tout en conservant un design léger et fonctionnel. Enfin, certains modèles repoussent les limites en offrant de véritables expériences de réalité augmentée. Par exemple, les lunettes Xreal One Pro, la dernière proposition de Xreal dans le domaine, prennent en compte les mouvements de la tête de l’utilisateur, offrant une immersion inédite avec un design amélioré et plus compact.

Cependant, le marché attend encore le produit parfait, capable de combiner toutes ces innovations : un affichage de qualité, des interactions intuitives, une caméra performante, la compréhension de l’environnement, l’IA, et une connectivité sans fil. Bref, un produit réunissant toutes les qualités essentielles : design, performance, autonomie et connectivité.
Le grand retour de la voiture autonome
Longtemps reléguée à un rêve futuriste, faute d’un mariage réussi entre technologie et législation, l’optimisme autour des voitures autonomes fait son grand retour. Ce regain d’intérêt est porté par le succès concret de Waymo, qui déploie son service de robotaxis dans des villes comme San Francisco, et par l’impulsion donnée par Elon Musk, désormais en position de force pour imposer ses ambitions.
La présentation très médiatisée d’Elon Musk l’automne dernier, détaillant les projets de robotaxis de Tesla, a sans aucun doute contribué à insuffler cette nouvelle dynamique. Nvidia, de son côté, propose à nouveau des solutions adaptées, tandis que l’idée d’un Federal Legal Network pour harmoniser les réglementations se concrétise. Ce cadre légal fédéral permettrait un déploiement à grande échelle, une perspective qui ne devrait pas déplaire au patron de Tesla.
La France en force
Eureka Park, le hall dédié aux startups, a une fois de plus mis à l’honneur les entreprises françaises. Avec près d’une centaine de sociétés représentées, la délégation française affiche un léger recul par rapport à 2024, mais reste la deuxième délégation internationale, juste derrière la Corée.
Le Pavillon France reflétait une grande diversité d’activités au travers des innovations présentées. S’il est impossible de citer tous les domaines représentés, les principales thématiques incluent la santé et le bien-être, la Green Tech, la Sport Tech et la Mobilité. La vitalité des startups françaises reste indéniable, consolidant leur place sur la scène internationale de l’innovation.
La vérité est morte, vive la communauté
On serait tentés de ressortir la « Dead Internet Theory », cette idée apparue il y a quelques années (bien avant l’arrivée de l’IA générative), qui suggérait que l’activité humaine sur Internet avait déjà été largement remplacée par des bots et des IA. Aujourd’hui, le contenu généré par les machines, amplifié par la data, nous pousse encore plus à questionner la nature du monde qui nous entoure : vivons-nous réellement dans une réalité tangible ou dans l’un de ses innombrables jumeaux numériques ?
Des idées à emporter : réussir l’implémentation de l’IA générative
Les professionnels qui ont intégré l’IA générative avec succès partagent des conseils clés. Leur mantra ? « Move slow in order to move fast ». En d’autres termes, il est crucial de poser les bases avant de vouloir avancer à grande vitesse :
- Mettre en place les conditions du succès : constituer un AI Council, sensibiliser largement les équipes, et surtout, investir dans la montée en compétences des collaborateurs (upskilling) plutôt que dans l’expansion rapide des projets (upscaling).
- Prendre son temps : éviter de se précipiter dans l’adoption d’outils encore en phase de développement ou d’expérimentation. L’IA n’est pas une baguette magique : elle nécessite du temps pour être entraînée correctement, un peu comme un nouveau collègue qui aurait besoin d’un solide onboarding.
OpenAI, pour sa part, souligne un point fondamental : même avec les meilleurs outils du monde, les entreprises qui ne parviennent pas à « désiloter » leurs données ne tireront pas pleinement parti des solutions proposées. En d’autres termes, sans accès fluide et organisé aux données, l’IA restera sous-exploitée, quelle que soit sa puissance.

Aura-t-on bientôt un navigateur privé dédié à l’IA ? Qui accepterait vraiment de mélanger les préférences de son Copilot professionnel avec celles de sa vie privée ? Selon OpenAI, dans un monde où tout le monde peut tout faire simultanément, l’identité de marque est plus essentielle que jamais. Trois maîtres mots s’imposent pour répondre aux attentes des utilisateurs : timeliness, relevancy et helpfulness – avec, au cœur de tout, la question du pourquoi, qui nous ramène aux fondamentaux grâce à l’IA.
Les enjeux deviennent encore plus cruciaux avec les agents IA (une expression qui divise) : ils doivent être exemplaires. Lorsqu’un agent intervient, on s’attend à une véritable expérience, et non à une simple expérimentation. Pour la créativité, l’IA ne doit pas remplacer, mais démocratiser les outils et les opportunités.
Selon les experts (Microsoft, pour ne pas les nommer), nous vivons ce fameux « moment smartphone ». Souvenez-vous, au début de l’ère des smartphones, il était encore possible de s’en passer si on l’oubliait à la maison. Aujourd’hui, c’est impensable. Et demain ? Nous pourrions bien vivre la même chose avec nos agents IA : pour l’instant, on peut encore s’en passer. Mais très vite, oublier cet assistant à la maison sera aussi dramatique que réaliser qu’on a laissé son « prolongement/remplacement de cerveau » actuel
Au moins, on se sent moins seuls à ressentir cette bascule vertigineuse. Comme le constatent les professionnels sur scène : « Avec l’IA : plus j’en apprends, moins je sais. »
L’édition 2025 du CES confirme que l’intelligence artificielle s’impose comme une évidence, intégrée dans tous les produits. Elle redéfinit nos attentes dans des domaines aussi divers que la mobilité, les objets connectés ou le divertissement, tout en s’inscrivant dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Entre annonces ambitieuses et technologies déjà prêtes à révolutionner notre quotidien, cette année marque une étape décisive vers un futur toujours plus connecté, à condition de créer de la valeur pour l’utilisateur…
Slush 2024 : Qui remportera le jackpot de l‘IA ?
Slush, cet événement lancé par des étudiants de l’Université Aalto, a connu une croissance exponentielle pour devenir l’une des plateformes les plus influentes au monde en s’imposant comme le plus grand rassemblement mondial en termes d’investisseurs présents et de capitaux en jeu. Cette année, il a bien porté son nom : sous une alternance de pluie et de neige, les visiteurs ont bravé les éléments pour y participer, alors que le pays s’apprête à revêtir son manteau blanc hivernal. L’atmosphère était d’autant plus particulière qu’à Rovaniemi, les préparatifs dans la maison du Père Noël se déroulaient à quelques pas du plus grand exercice de l’OTAN jamais organisé dans l’Arctique.
Par Kati Bremme, directrice de l’Innovation et Rédactrice en chef Méta-Media
Résultat de la prise d’envergure de Slush : un habitué de Yle a lâché avec un sourire en coin « Cette année, c’est très adulte. » Et effectivement, même si l’ambiance boîte de nuit au pôle Nord reste intacte, les costumes (sans cravate, tout de même) se multiplient, et les stands adoptent un style plus « CES version Halloween », sans tomber dans l’excès du salon automobile végasien – ici, seule la suédoise Polestar représente la voiture de l’avenir.
Sur scène, les sujets attendus ont dominé : l’IA, Donald Trump et le concept d’ »EU Inc« , cette idée ambitieuse d’une entité paneuropéenne qui favoriserait l’émergence de véritables géants technologiques. Mais en coulisses, les échanges ont pris une tout autre tournure : quelles entreprises européennes d’IA disparaîtront en premier ou seront rachetées par un géant américain ? Pourquoi la nourriture est-elle entièrement végane ? Et pourquoi OpenAI a-t-il brillé par son absence au petit-déjeuner sur la régulation avec le président finlandais Alexander Stubb et plusieurs eurodéputés ?
La fin du rêve d’un Internet global ?
Alexander Stubb a justement inauguré ces deux journées de conférences et de rencontres en posant une question fondamentale : allons-nous construire une démocratie numérique ou basculer dans une dictature digitale ? Devons-nous fragmenter Internet au gré des opinions, ou continuer à aspirer à un espace qui rassemble ? Et, plus largement, notre travail est-il guidé par l’espoir ou par la haine ? Il a offert trois pistes de réflexion marquantes au public : réfléchissez à ce que la technologie vous apporte, mais aussi à ce qu’elle vous prend ; demandez-vous si votre entreprise technologique contribue réellement au bien commun ; et gardez à l’esprit que nous atteignons un point d’inflexion critique pour l’humanité.
Alors que notre autonomie est potentiellement menacée, il a souligné l’urgence de mettre en place des règles globales pour garantir que nous restions maîtres de notre destin collectif.
Alexander Stubb, Président de la Finlande
A la recherche du géant de la tech européen perdu
Le thème de Slush cette année, « Métamorphose », reflète les transformations que les entrepreneurs en pleine croissance et les investisseurs peuvent accomplir ensemble grâce aux nouvelles technologies. Un mot d’ordre qui semble avoir trouvé écho : Slush 2024 a attiré plus de 5 500 startups et opérateurs, ainsi que 3 300 investisseurs, établissant un nouveau record. Avec plus de 4 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion représentés, l’événement s’impose comme le plus grand rassemblement d’investisseurs au monde, selon sa présidente, Elin Dölker.
Index, l’une des plus grandes sociétés de capital-risque en Europe, a par ailleurs salué un événement de deux jours marqué par « un climat d’optimisme » pour la tech européenne, porté notamment par les investissements dans l’IA. Une tendance déjà observée l’année dernière s’est confirmée : les investisseurs sont devenus plus exigeants, privilégiant des start-ups capables de démontrer une rentabilité rapide. Toutefois, cette quête de garanties s’avère parfois laborieuse, surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir des réponses claires de la part des fondateurs. Parfois, il faut dix minutes pour comprendre si le produit existe réellement, s’il a dépassé la phase de preuve de concept (PoC) ou s’il n’est encore qu’une idée vague griffonnée sur un PowerPoint on un Figma.
Sana, une entreprise d’IA suédoise qui développe la prochaine génération d’outils de gestion des connaissances
Les financements pour les entreprises technologiques émergentes devraient connaître en 2024 une baisse pour la troisième année consécutive. Cependant, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour les introductions en bourse, souligne la société de capital-risque Atomico dans son rapport sectoriel publié mardi. Parmi les entreprises en lice figurent les fintechs britanniques Revolut et Zopa, ainsi que Bolt, la société estonienne de VTC.
Les discussions à Slush autour de la préservation de la compétitivité technologique européenne ont mis en lumière le projet EU Inc. : une initiative visant à unifier l’écosystème fragmenté des startups européennes au sein d’un marché unique paneuropéen. L’une des premières étapes envisagées serait la création d’une entité juridique harmonisée, un projet encore au stade d’une pétition soutenue par 600 fonds de capital-risque, 9 000 startups et 20 associations. Ursula von der Leyen a apporté son appui à cette initiative en déclarant : « Je propose un nouveau statut juridique à l’échelle de l’UE pour aider les entreprises innovantes à se développer. Il prendra la forme d’un « 28e régime », permettant aux entreprises de bénéficier de règles simplifiées et harmonisées dans certains domaines. »
L’Europe se trouve dans une position privilégiée pour devenir leader de l’innovation en intelligence artificielle, particulièrement dans la « couche applicative » : celle où l’IA s’attaque à des défis concrets dans des secteurs clés comme la santé, l’énergie, les transports …et les médias.
IA : la bataille de l’Open Source versus les modèles fermés, LLMs versus SLMs
L’Open Source peut-il sauver le monde de l’IA générale et de ses dérives potentielles ? Pour Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face, la réponse est claire : il faut démocratiser l’IA grâce à l’open source. En rendant les modèles et datasets largement accessibles, Hugging Face permet aux startups comme aux grandes entreprises d’innover à moindre coût. Selon lui, l’open source offre des avantages indéniables : réduction des dépenses, accélération du développement, collaboration mondiale continue et flexibilité pour personnaliser les outils selon les besoins spécifiques des utilisateurs.
Mais l’open source, selon Wolf, va au-delà d’une simple tendance technologique. Il ouvre la voie à des avancées révolutionnaires dans des secteurs comme la biomédecine, où l’innovation progresse à un rythme effréné et où la meilleure combinaison serait un modèle Open Source avec un jeu de données fermé. Cette logique s’impose si l’on considère l’IA comme une technologie fondamentale, au même titre qu’Internet. De plus, en plaçant la barre haut en matière de transparence et de collaboration, l’open source exerce une pression croissante sur les modèles propriétaires, les incitant (peut-être) à plus d’éthique et d’ouverture.
Ambiance au Messukeskus Helsinki
L’époque où la puissance d’un modèle d’IA se mesurait uniquement à sa taille semble révolue. Sakana.ai, un DeepMind japonais, en est l’exemple parfait. Aspirant à créer une « IA inspirée par la nature« , la startup affirme que son modèle peut être entraîné avec seulement 8 GPU. Une prouesse significative dans un environnement contraint en ressources comme le Japon, où il est difficile de rivaliser avec les modèles de fondation gigantesques développés par des laboratoires privés américains, tels que Facebook FAIR ou Google DeepMind. Le travail de Sakana AI sur des modèles plus compacts s’avère particulièrement pertinent pour des applications sur des dispositifs en périphérie, comme dans les secteurs industriels ou militaires.
Dans cette course à l’intelligence artificielle, ce qui distingue l’Europe n’est pas non plus une quête de puissance brute en matière de calcul – domaine où elle ne peut rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. Ce qui fait sa force, c’est son focus et sa finalité. Les innovateurs européens se démarquent par leur capacité à concevoir des solutions ciblées, capables d’apporter un impact concret dans des secteurs complexes et réglementés. Le leadership européen dans la « couche applicative » repose sur plusieurs piliers : un accès privilégié à des ensembles de données uniques et de haute qualité, comme les dossiers médicaux ou les données énergétiques ; une approche fondée sur des valeurs essentielles, intégrant confiance, éthique et durabilité ; et enfin, des pôles d’innovation en IA dans des villes comme Helsinki, Paris et Munich, qui favorisent l’émergence de talents et la collaboration. Ici, la précision et l’impact l’emportent sur la course à la taille.
Les success stories les plus emblématiques
Cette année, les scènes de Slush ont vu défiler des fondateurs à succès, venus partager les clés de leur réussite. Chris Malachowsky, cofondateur de Nvidia, a confié : « Notre premier produit était un échec. Nous avons dû pivoter rapidement. » Leur succès repose sur des choix stratégiques clairs : se concentrer sur les besoins des clients plutôt que sur les tendances technologiques, privilégier les gains à long terme même au prix de sacrifices à court terme, et bâtir une équipe soudée autour de valeurs communes comme la culture, la collaboration et l’engagement.
Le journaliste Tom Mackenzie de Bloomberg, Mati Staniszewski (fondateur ElevenLabs), Bryan Kim (Andreessen Horwitz)
ElevenLabs, célèbre pour ses voix IA ultra-réalistes, révolutionne l’univers de l’audio. Mati Staniszewski, son fondateur, a partagé l’origine de son succès, née d’un simple besoin utilisateur : en Pologne, les films étrangers sont doublés par les mêmes voix pour hommes et femmes, une expérience insupportable pour le jeune entrepreneur. Frustré, il a exploité le meilleur des technologies d’intelligence artificielle pour concevoir un outil de clonage vocal ultraperformant, qui s’est rapidement imposé comme leader du marché.
Bryan Kim, partner chez Andreessen Horowitz, a immédiatement reconnu le talent unique de Staniszewski, qu’il classe parmi les « gummy bear founders » (une référence à l’idée de glisser de la vitamine C dans des oursons en gélatine) : des créateurs capables de combiner une compréhension fine de leur produit et des besoins de leurs utilisateurs, soutenue par une solide expertise scientifique. Tandis que des géants comme OpenAI, Gemini ou Anthropic misent sur des modèles multimodaux, ElevenLabs, lui, se consacre à l’excellence dans le domaine de la voix.
Mais la vision d’ElevenLabs ne se limite pas à la génération vocale. La startup innove avec des contenus interactifs pour le gaming et l’e-learning, développe une marketplace mondiale mettant à l’honneur la diversité des accents et explore des récits audio multidimensionnels mêlant sons, musique et narration. Leur ambition est limpide : construire un écosystème qui redéfinisse notre rapport au son. Comme le résume Staniszewski : « L’audio est bien plus profond que ce que vous imaginez. »
May Habib, fondatrice de Writer AI, a également commencé son parcours IA par la traduction avant de développer un produit qui a suivi chaque génération de modèles transformeurs. Aujourd’hui, son IA générative s’intègre dans n’importe quel processus métier et compte parmi ses clients 40 entreprises du Fortune 500, dont Accenture, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, ou encore Nvidia.
Sa devise : plus les modèles deviennent performants – ou plutôt, plus la combinaison de plusieurs modèles s’améliore –, plus il devient possible de transformer des flux de travail humains en actions autonomes. Toujours en phase avec l’évolution technologique ultra-rapide, elle impose une culture d’adaptation permanente, y compris dans son équipe commerciale, qu’elle avertit : « Que Dieu vous vienne en aide si vous êtes surpris en train d’utiliser des slides datant de janvier. »
Mesbaul Anindo (Slush) avec Justin Kan
Être à l’écoute de ses utilisateurs, c’est bien-sûr aussi la clé du succès de Justin Kan, fondateur de Twitch, véritable rock star et DJ à ses heures perdues à Slush. Kan a commencé comme premier utilisateur de sa propre plateforme, avec son célèbre stream 24/7 « Justin.tv ». Depuis, il a su élargir sa vision : à côté du modèle B2C de Twitch, il se concentre désormais sur le B2B avec Stash, une plateforme visant à réduire les commissions prélevées par les app stores sur les jeux des développeurs.
Lors de son intervention, Kan a insisté sur une idée centrale : comprendre la différence entre la « zone de compétence », qui draine votre énergie, et la « zone de génie », qui rayonne et la diffuse autour de vous. Conclusion : Le succès ne réside pas dans le fait d’avoir toutes les réponses, mais dans la capacité à poser les bonnes questions. Et : La stratégie IA est la nouvelle stratégie mobile de 2024, selon Javier Olivan, COO de Meta.
Slush 2024, la Méta-Morphose des fondateurs et investisseurs
Alors, ‘AI eats the world?’
“Graphical computer interfaces are the future,” disait Bill Gates en 1980. En 2024, cette vision trouve un écho avec ChatGPT et les LLMs, des modèles de langage qui fascinent autant qu’ils interrogent. Mais comme le constate Benedict Evans dans sa présentation annuelle à Slush, après l’excitation initiale, la réalité est différente : la majorité des utilisateurs n’ont essayé ChatGPT qu’une seule fois. Alors, jusqu’où cette technologie peut-elle vraiment aller ?
Benedict Evans présente, comme chaque année, un condensé de vision en quelques minutes
La question clé, selon Evans, est celle de l’échelle. Les LLMs continueront-ils à grossir pour remplacer des systèmes entiers, ou vont-ils réduire leur envergure pour devenir de simples briques logicielles ? Déjà, des stratégies divergentes émergent : Meta distribue ses modèles open source gratuitement, tandis qu’Apple applique sa recette éprouvée – produire des outils « mieux, plus rapides, moins chers », comme elle l’a toujours fait dans l’univers informatique.
En 2013, le machine learning a prouvé son utilité en identifiant des motifs, par exemple reconnaître un chien sur une photo. Mais en 2024, l’IA générative pose une nouvelle question : à quoi sert-elle vraiment ? Evans rappelle une limite cruciale : les LLMs ne sont pas des bases de données. L’exemple d’Air Canada, condamné à verser des dommages et intérêts après que son chatbot a menti à un passager en deuil, illustre bien ce problème. Comment gérer les erreurs dans un système probabiliste et non déterministe ? Peut-elle remplacer Google ? Rien n’est moins sûr. En revanche, leur potentiel réside (toujours) dans leur capacité à devenir des « stagiaires infinis » (en rappelant sa formule de l’année dernière), automatisant les tâches répétitives pour libérer du temps pour des projets stratégiques.
Evans va plus loin et compare les LLMs à des fonctionnalités invisibles, comme le correcteur orthographique, qui s’intègrent dans des outils existants sans que l’utilisateur ait à y penser. Mais il insiste : pour réussir, les LLMs ne doivent pas forcer les utilisateurs à inventer leurs propres cas d’usage. « Les utilisateurs ne savent pas ce qu’ils veulent, » disait Steve Jobs. L’IA doit s’adapter, pas l’inverse. Selon lui, les LLMs doivent devenir une commodité, un peu comme les composants des ordinateurs.
Cette transformation, selon Evans, rappelle celle de VisiCalc, le premier tableur des années 1970, qui a rendu l’informatique indispensable pour les entreprises. Et comme VisiCalc, les LLMs ne remplaceront peut-être pas tout, mais ils transformeront profondément tout ce qu’ils toucheront, redéfinissant à la fois les outils et la manière dont nous travaillons.
Et pendant ce temps, « Software eats Media » …
Conclusion : Make Europe great again
Slush 2024 a montré que l’IA est à un tournant décisif : entre visions grandioses et pragmatisme nécessaire, le jackpot est encore à décrocher. Qui dominera cette révolution ? L’Europe avec ses valeurs et son focus sur l’impact concret ? Les États-Unis et leurs mastodontes technologiques ? Ou ces startups agiles qui transforment des limitations en opportunités ?
Une chose est sûre : la Finlande est définitivement plus cool que ce qu’on imagine (clin d’œil à un vieux slogan publicitaire). Et comme le rappelle le motto de cette année : les grandes histoires commencent par un chat, pas par un prompt…
Start-ups à emporter :
IKI.ai – Une startup néerlandaise qui propose une alternative à l’infobésité à travers un « assistant et un second cerveau pour les professionnels et les équipes » basé sur des LLM et du RAG.
ContentRadar – Une plateforme conçue pour automatiser la création, la planification et l’analyse des publications sur les réseaux sociaux et maximiser l’efficacité et l’impact des campagnes. Le siège de ContentRadar est basé à Londres, au Royaume-Uni, avec un hub opérationnel à Berlin.
Pyrpose – Une startup suisse qui promeut les initiatives de responsabilité sociale des entreprises grâce à une plateforme qui gère des projets durables et éthiques.
Transjt – une start-up ukrainienne qui comble le fossé entre créativité et technologie grâce à l’élimination de la barrière du codage pour les designers, permettant l’exportation fluide de designs originaux vers des expériences web comme HubSpot, Shopify, Contentful, or WordPress
Workki – une startup finlandaise qui aide à contrer les fausses informations avec une solution qui vérifie les sources et les références, garantissant ainsi la publication d’informations précises. La plateforme facilite la création de contenu en résumant rapidement des articles et des études, assurant un flux constant d’informations fiables.
Photos : KB
Journalist, Influencer: Who Will Be the Gatekeeper of Tomorrow’s Information?
“If the book we are reading doesn’t wake us up with a blow to the head, what are we reading it for?” – Franz Kafka
The days of carpet bombing and gatekeeping in media have indeed ended, even though in the artificial paradises of generative AI, there emerges anew a need for a recognized reference, or even a singular, labeled, watermarked, and triple-verified source of information.
By Kati Bremme, Director of Innovation at France Télévisions and Editor-in-Chief at Méta-Media
Recent studies by Reuters and the Pew Research Center have sounded an alarm: for 20% and 32% of young adults aged 18 to 24, TikTok is now the primary gateway to information. In light of this, traditional media must face a critical challenge: evolve to appeal to a young audience crucial for democracy, or risk losing this audience to charismatic influencers who captivate a generation often beset by doubt and concern with entertaining formats. Should we mimic them, integrate them, or challenge them?
In the last century, journalists inevitably played the role of influencers, being, through the media they worked for, the sole source of information for most people. Today, since the miracle of the Hudson River reported on the now-defunct Twitter, anyone can be a journalist, influencer, or rather a content creator, as they prefer to be called, whether they are macro, micro, or nano…
Once, the role of influencer was reserved for the media elite. Today, it is accessible to everyone thanks to digital tools. Unlike traditional newsrooms, creators rapidly adopt AI innovations to amplify their impact. They no longer need printing presses or broadcast stations to reach wide audiences. With automated means of creation, distribution, and personalization, they can now engage a vast and diverse audience, revolutionizing the media landscape.
Arianna Huffington was among the first to embark on the Internet in blog form (the web 1.0 version of the influencer). She was followed by journalists like Samuel Etienne, who kept the press alive on Twitch during the pandemic by playing the role of the « boomer » speaking to the young in a web 2.0 manner. What is the recipe for success of HugoDécrypte, Taylor Lorenz, Rana Ayyub, Squeezie, Fang Fang, Maria Ressa, Kara Swisher & Co? How can traditional media remain relevant as audiences increasingly turn to the 50 million content creators worldwide, including 150,000 in France, sharing their interests and skills online?
New Relationship, New Definition
Millions of young people already prefer influencers and creators as reliable information sources. This consumer trust isn’t necessarily based on the quality of reporting or the prestige of a brand, but on solid parasocial relationships. They don’t need the intermediary of a journalist: young internet users willingly dive into current topics that interest them using TikTok’s search bar to form their opinions, often influenced by popular online figures.
The Larousse dictionary still describes a journalist as “a person whose main, regular, and paid occupation is the practice of journalism in one or several written or audiovisual press organs.” But the profession itself is shifting toward new horizons. What defines a journalist today? A press card or their work? Working for a given media outlet, public or private, already signifies a certain reduction in independence, as the journalist must conform to a more or less directed editorial line. Television presenters, by their embodied role, were perhaps always a bit more “influencer” than their counterparts in the written press, like Bernard Pivot, who could propel the sales of a book featured on his iconic show. Today, televised information tends increasingly toward entertainment with immersive technologies, a development strongly influenced by American TV trends.

Bernard Pivot, one of the first “journalist-influencers” in culture
When the power dynamics of newsrooms with their audiences have not changed for centuries, influencers’ relationships with their followers are more bilateral: they listen, interact, take advice from their community, and sometimes even include them in their content. They often express a subjective and intimate perspective on personal topics and can discuss mundane or personal issues, balancing self-promotion and authenticity. Some “influencer-bloggers” have later managed to capitalize on their privileged rapport and understanding of audience needs, like Ezra Klein who started with a “web log,” and was among the first bloggers to obtain press accreditation for a political event in 2004, founding Vox Media in 2014.
Information-Entertainment
The notion of journalism as an institution aimed at educating, informing, and elevating is today shaken by commercial pressure that steers it toward entertainment. Against this current, a new citizen journalism has developed on social networks and the Internet. With generative AI, we are already witnessing the rise of virtual influencers, and tomorrow it will be easy to transform a text into a podcast or a video, abolishing the boundaries between classic information formats, serving either mass production or quality, according to the economic imperatives and editorial wills of each.
I still remember the reactions in newsrooms when they were introduced to the HugoDécrypte channel, by the young Hugo Travers who launched information formats on YouTube in 2015. “This isn’t journalism.” Not serious enough. Not formatted enough. Too embodied. Too entertaining. Too polarizing. “But it appeals to the younger generations.”
Hugo Travers created his YouTube channel, HugoDécrypte, in 2015
Thanks to their pedagogical approach and strong presence on social networks, content creators make news accessible to an audience often detached from traditional media. Journalist influencers like American YouTuber Philip DeFranco or Indian journalist Faye D’Souza use their platforms to present news in a direct and engaging manner. These professionals succeed in bridging the gap between traditional journalism and the expectations of a connected public, eager for immediacy and transparency. Information becomes more of a two-way communication.
Contrary to widespread discourse, the younger generations do make a distinction between journalists and influencers, as Anne Cordier explains: teenagers clearly differentiate between content creators—whom they often call “influencers”—who broadcast entertainment and testimony (like Squeezie, cited as a reference regarding video games, or Léna Situations, appreciated by young girls for her fashion posts)—and those who produce more serious informational content in their eyes (like Mister Géopolitix or Jemenbatsleclito, account of feminist creator Camille Aumont Carnel). And they prefer these formats for informing themselves, even as some newsroom managers still cry wolf when one wants to integrate TikTok into the information distribution model. The influencer landscape is a vast and constantly evolving space. Before denouncing the placid dumbing down of the reader or their manipulation by the proponents of the new media discourse, we must listen to American journalist Kara Swisher, who notes that the media should really worry: each day, the quality of blogosphere content increases while that of print newsrooms decreases.
New influence brands are emerging by integrating the new usages of younger generations (and increasingly those of older ones). Brut was among the first platforms that use short, impactful videos to broadcast news. Their visual and narrative approach (non-embodied at their beginnings, embodied today) has responded to the usages of a broad public. As our colleagues from Yle predict, soon, it will be necessary to broadcast information on Roblox if we still want to reach the Alpha generation, who now identify more with their avatars than their own reflections in the mirror.
From the Intent to Influence
What then does a journalist influencer do? Do they intend to influence public opinion? The amalgamation between influencers and journalists certainly harms young people’s understanding of what information is. In September 2023, Taylor Swift called her 280 million followers on Instagram to register on electoral rolls, prompting an immediate influx of 35,000 young people, and Léo Nora, with more than 17,000 followers on his TikTok account, published a video in English viewed nearly a million times since last November. “Don’t come to Paris for the Olympics.” From rumor to verified information, there is no hierarchy, no editor-in-chief on social networks.
Already in 2004, the Boston Chronicle emphasized the particular nature of information bloggers of the time, whose writing was characterized by a subjective style, at a time when smartphone video did not yet exist: “Anyone who owns a computer and home publishing software can qualify themselves as they wish. If it’s a couple of retirees who simply decide they have an opinion, that doesn’t make them a press organ. It just makes them a couple of retirees with an opinion and a website.” As information media, influencers often navigate this blurred space between journalism and advocacy, not hesitating to direct their audiences toward fundraising for parties and candidates in this “super-election year.” TikTok has always claimed an intent to entertain, but usages have evolved toward search engine and information consultation functions (with the war in Ukraine, the judicial saga between Johnny Depp and Amber Heard, and the Israeli-Palestinian conflict). Its rapid growth has attracted partisan political messages, misinformation, and conspiracy theories. Monitoring and investigating the spread of these messages are complicated by the lack of an approved API (application programming interface) to access the data flow generated on the Chinese platform.

Screenshot from the Instagram account @nextgenamerica
“Since 2016, the trend is that the most powerful messengers in politics are real people, community folks who look like your neighbors,” stated Bradley Beychok, president of the American Bridge 21st Century political action committee. Politicians increasingly rely on micro-influencers in their campaigns.
Digital journalism converges with the culture of influence. Traditional media highlight the biographies of journalists, and more and more video subjects are embodied. Must we all become influencers? The New York Times editorial board adopts a restrictive policy on this subject. Yet, the committee tasked with reviewing external projects of journalists approved more than 90% of the 200 projects proposed by journalists eager to develop their own brand. Other media integrate influencers directly into their editorial teams.
Performative Authenticity
Using the metaphor of a theoretical play, sociologist Erving Goffman described the concept of self-representation as an “actor.” A transposable interpretation in more recent history, where influencers invest in impression management. They use storytelling techniques, filters, edits, and strategic collaborations to shape a consistent and appealing image. Their success often depends on their ability to control and direct their audience’s perceptions.
The dynamics between influencers and their audience are interactive. Comments, likes, and shares serve as feedback, guiding future performances, the editorial line, and chosen themes. This interaction creates a feedback cycle where the audience influences the content and vice versa. Influencers adjust their content based on reactions, constantly optimizing their impact and reach, which can pose problems for informational content. A key paradox is the quest for authenticity in stylized performances: they must appear authentic while being performative. This tension, central to their success and credibility, is often managed by controlled disclosure of vulnerabilities or “real” moments, creating an emotional bond while maintaining narrative control.
On the other hand, the concealment of subjectivity is made all the easier as mechanical reproduction techniques erase the singularity of the original (the “aura” of Walter Benjamin). Perverse disembodiment since, far from entirely suppressing emotion, it rather shifts the object toward the satisfaction of a sort of vain spectacularization of life. In historical media, where there were previously sales departments to manage the optimized distribution of newspapers, today it is more the journalists themselves who must market information on social networks. They have then developed a love-hate relationship with the platforms. The “digital schizophrenia” leaves us perpetually torn between fascination and fear of new technologies.
Fragile Economic Balances
Nathan Myhrvold, former CTO of Microsoft, described the dilemma of newsrooms in the 21st century: “Who will pay for information?” We remember the courtship operations of social network executives with historical media to feed their content platforms in the early days of the digital revolution. Quickly, these platforms realized that they could generate better retention (an important indicator for advertising) with entertainment and funny videos rather than with in-depth analyses and verified news reports, thus endangering entire media that had built their economy on a distribution channel controlled by the tech giants. Recent changes to the Instagram algorithm to limit the visibility of political content have led to a drop in engagement from 70 major news accounts, decreasing their interactions by 26%, when it’s not Meta simply ending access to information on Facebook and Instagram for all users in Canada.
Despite a fragile and platform-dependent status of entrepreneur journalist, many young journalists, for whom the straitjacket of a historical newsroom seems too restrictive, dream of being influencers, the “coolest kids on the block,” encouraged to increase their audience and, in return, often their bank accounts. For others, this choice becomes a necessity imposed by the lack of opportunities available in traditional newsrooms. Still, the combination of influencers and social media algorithms is perhaps the most powerful form of advertising ever invented.
But the lone struggle on social networks is tough, and cultural relevance is not eternal. It’s a 24/7 job, social media algorithms do not forgive a moment’s rest, and the tech giants are unfamiliar with paid vacations. And each social network has its specifics. TikTok is the best place to quickly gain a wide audience, YouTube to monetize it in the long run, and Instagram is historically the place for deals with brands. For X, “it’s complicated.” It is true that the “influence investment” dons the finest attire: for 1 euro invested, the return averages 9.60 euros.
Influencers and journalists share their love-hate relationship with social networks
For now, journalism start-ups attract significant and devoted audiences but struggle to convert this loyalty into financial support. Most depend on philanthropic funding, which remains rare and fragmented. In a dual surge of editorial and economic independence, we observed during the global pandemic the departure of a number of journalists from major emblematic newsrooms to launch their own newsletters. They were then nicknamed the substackerati, after the platform that serves as their publication tool.
Another response to the quest for an economic model for influencers to avoid navigating the murky waters of mixing advertising and information might be Web3 technologies, this new participatory Internet, whose mass adoption is still awaited. One of the key elements of Web3 is a user-centered experience. This experience does not need a central platform, like X, TikTok, or YouTube, to mediate peer-to-peer interactions. Sites like WeAre8 or Good-Loop reward engaged users by sharing a percentage of revenues. Web3 also allows for the “ownership” of digital assets, as experimented by the magazine TIME. The principles of these technologies can be applied to journalism and create a new way to consume information. The next TikTok might not be a single platform, but a direct relationship with audiences. And the “cost per teleportation” in Roblox might be the next cost per click.
Long Formats and Investigative Journalism
Journalists leaving the secure haven of a newsroom and the ungrateful context of “hurried literature,” a term attributed by poet Matthew Arnold to journalism, is not a new phenomenon: the number of journalists who became writers is plentiful (some would even say that the best writers are those with a background in journalism). For a print press journalist, a book is somewhat akin to what a documentary is for a TV journalist. Isn’t the number of print runs of a book a bit like the equivalent of a number of likes? Faced with newsrooms that have been cutting their means to the bone, closing their foreign offices, and prioritizing the chase after hot news, often accompanied by superficial management of social networks, independent journalists who dedicate themselves to long formats and investigative journalism stand out by taking the time to develop their stories.
🏆#PrixAlbertLondres23
Prix presse écrite @wilsonfache pour ses reportages en Afghanistan, Tel Aviv & Ukraine
Prix audiovisuel @hlamtrong – « Daech, les enfants fantômes » @Cineteve_prod
Prix du livre @N_Legendre – « Silence dans les champs » @EditionsArthaudhttps://t.co/aKlzLaA7ia pic.twitter.com/W5FTb8p8s7— Prix Albert Londres (@albert_londres) November 27, 2023
What some independent journalists can afford at the cost of a multitude of tasks ranging from content production to managing their own marketing and finances, newsrooms can only put in place when there is collaboration or partnership. Or change of priorities. Or merger… Michael Moore explains that his documentaries express his opinions, letting each viewer form their own. Independent journalists can take time on a story, unlike many traditional newsrooms that struggle to update their priorities.
Influencers Under Influence in Asia
Influencers in Asia play a crucial role in shaping public opinion and spreading trends, especially in states on the fringes of democracy. As their popularity continues to grow, a growing mistrust of state media and government attempts to regain control over the presence of influencers online challenge an emerging model of freedom. In China, journalist Luo Changping uses social networks to criticize government policies, often at the risk of reprisals. Influencer Chen Qiushi gained notoriety during the Covid-19 epidemic by sharing firsthand accounts from Wuhan, highlighting gaps in official reports.
This dual role of reporting and influence allows them to shape public discourse while walking a tightrope of government regulations. In India, journalists like Faye D’Souza use social media to provide critical analyses and independent reports. In South Korea, figures like Joo-Jin Woo, an investigative journalist, are popular for their in-depth investigations into corruption and abuses of power. In Japan, journalists like Shiori Ito tackle issues of social justice and public policy (notably around gender equality), playing a crucial role during elections by sharing critical information and alternative perspectives, influencing public debates and electoral choices.
It’s time for #NLHafta!
This week, @AbhinandanSekhr, @ramankirpal, @javashree, and @tweets_prateekg are joined by @fayedsouza to discuss Maharashtra and Delhi polls, Pune’s #Porsche car crash, and more.
Tune in: https://t.co/q90ivqCSGk pic.twitter.com/udgJcrzJet
— newslaundry (@newslaundry) May 26, 2024
But governments quickly put in place measures aimed at framing the influence of digital celebrities and ensuring that their messages remain in line with official guidelines. The phenomenon of journalist influencers on Chinese social media platforms in particular reflects the unique interaction between journalism, social media, and state control. The central leadership of the Party has adopted a media monitoring function to strengthen its control over a failing administration and to highlight aspects of bureaucratic capitalism that had become so relentless that they compromised the very survival of the system.
A new surveillance journalism, embodied by influencers including foreigners, promises to reinforce the hegemony of the Party by smoothing the rough edges of the ongoing Chinese transformation and by monitoring the political, economic, and digital boundaries of an emerging authoritarian market society.
Embodying the Community
For some, journalism outside newsrooms is also the only way to assert themselves. Taylor Lorenz, a journalist at the Washington Post and a specialist in digital culture, has explored the story of content creators on the Internet and observes that “the first influencers were women because the media were not interested in their centers of interest.” Influencers use social platforms to tackle topics often under-represented in traditional media, thus offering a diversity of perspectives and enriching the public debate, taking on part of the work of a public service.
Even if efforts are ongoing in most media, building and strengthening one’s audience tomorrow will inevitably involve integrating minorities into content production to establish an authentic connection with younger audiences, and to counter an era fragmented, where the masses are difficult to reach. The Vice Guide to Culture 2023 had already pointed out that younger generations “turn to their peers and their trusted communities before choosing to trust outside experts. Moreover, they collectively boycott organizations in which they do not believe.” Dylan Page (10M), a young news content creator from the United Kingdom, has more followers and views combined than the BBC (2.6M) and the New York Times (570K) even on current topics like Gaza. Traditional war reporters not being able to go to Gaza, many of the most compelling accounts were told by residents, including a new generation present on social networks.
Screenshot from the Instagram account of Plestia Alaqad @byplestia
Plestia Alaqad is a resident of Gaza whose documentation on the daily hardships has brought a personal touch absent from mainstream media. Faced with these challenges, WhatsApp is becoming increasingly important for information. With the launch of Threads and Bluesky, the work of public engagement teams has become more demanding than ever. Major media are increasingly seeking to broaden the range of voices covering topics.
The expectations of consumers regarding the representation of minority communities are becoming more sophisticated, starting with the person, not the identifier such as gender, sexuality, or race. Minority communities are rewriting the rules of engagement with brands, seeking narratives and partnerships that complicate representation rather than simplify it. Ensuring that information is accessible to all is not just a matter of ethical responsibility, but also a legal obligation in the European Union.
Regulation of the Wild West
The European Council has approved conclusions to support influencers as online content creators in the EU. It encourages member states to dialogue with influencers and their organizations to clarify their role and applicable legislation. Furthermore, it asks the Commission to explore means of support at the European level, including media education, promoting online responsibility, and the use of EU funds and programs.
Europe is not the only region in the world looking at the regulation of increasingly influential influencers: in China, the cybersecurity law imposes severe restrictions on online content, with significant sanctions for offenses. In India, recent legislation requires social media platforms to monitor and regulate content published by influencers. In Japan, the code of ethics for influencers imposes clear rules on the disclosure of commercial relationships. Creators must also adhere to high standards of online conduct in South Korea, where consumer protection laws require enhanced transparency about sponsored content.
And the phenomenon is self-regulating a bit: the trend of “deinfluencing” (or “deinfluencing”) is a reaction to traditional influencer practices on social networks. Instead of constantly promoting products and encouraging consumption, “deinfluencers” urge their audience to be more selective and thoughtful in their purchases. This trend criticizes the often exaggerated recommendations of influencers and focuses on reducing overconsumption, which has benefits for the environment and personal well-being, …and the informational ecosystem. When just a few years ago, the early social networks served as a new coffee machine where we shared our experiences (of watching television programs live) in a sort of Agora, we now live in a fragmented world where it is easier than ever to completely ignore what others consume. It is also easier than ever to attach undue importance to information or trends that may seem popular but are actually very confined. In this new world, where recommendation algorithms prevail over the old model of followers, the only tech giants are the gatekeepers of knowledge on how information circulates on their platforms, especially if they also hold the Holy Grail of generative AI.
Artificial Journalists and Disinformation
With the arrival of AI in newsrooms, the future of journalism raises many questions. Julian Assange urges journalists to adopt a scientific approach, relying on verifiable sources. In this new world, half-real, half-artificial, we witness the emergence of unwitting presenter-influencers: Nota Bene and Cyprien have seen their images used without their consent by AI, while Julien Bugier and Anne-Claire Coudray found themselves promoting products in advertisements without their knowledge. Our 2023 notebook was devoted to AI in newsrooms, a phenomenon accelerated by the launch of ChatGPT. We will therefore only deal with this subject in the margins here. But faced with a profession that has been constantly questioned in recent years, the emergence of automatic pens adds yet more questions to an already long series of challenges.
Image extracted from one of the deepfakes showing Anne-Claire Coudray and Maître Gims
After the digital transformation, we are now living through a virtual transformation. AI-based tools that modify the language of information to improve relevance and understanding for specific audiences will increasingly be present in the information landscape in the years to come. Chatbots, apps, and browser extensions will increasingly spread their influence. Key Chinese opinion leaders (KOLs), particularly in the e-commerce industry, are already turning to digital clones to generate content 24/7. According to MIT Technology Review, the Nanjing-based company Silicon Intelligence can create a simple AI clone for only 8,000 yuan (about 1,000 euros), a price that can increase for more complex programming. The company only needs a minute of video footage of a human to train a virtual videographer. Lately, “Virtual Mourners” have become a trend on social networks. In the world of influencers, where everyone seeks to stand out, how far can one go too far?
Ancients Against Moderns
Today, more young people aspire to be influencers than journalists. It is so tempting to escape economic uncertainty by winning hearts (and minds) on the Internet, even if the economic balance remains fragile. If content creators are the new media industry, what then becomes of traditional media? Could we not simply bring together the best of both worlds under the same roof?
This dynamic pushes the media to innovate and adapt their formats to remain relevant. Collaborations between traditional media and influencers, like that of Samuel Etienne on Twitch with France Télévisions, streamer Quineapple with Arte, or ecological content creators participating in 2050Now, the new media of the Les Echos-Le Parisien group, show that integrating influencer techniques can enrich the media offering.
Screenshot of the @girl_go_green account for the media 2050now
The Deutsche Welle Akademie and its partners in Serbia, where social networks are full of unmoderated hateful comments, collaborate with YouTube influencers to make media education more captivating for young people. This project transforms adolescent idols into educators. When they talk about cybersecurity, hate speech, or harassment, YouTubers, credible authorities, carry more weight. Furthermore, UNESCO facilitates exchanges of skills between journalists and influencers, thus affirming the interest in valuing collaboration between these two spheres rather than considering them in opposition.
Imagining the New Journalistic Cuisine
This new dynamic with audiences marks a turning point for public service media. Gone are the days when only commercial indicators like the number of subscribers or visits dictated their success. Today, the impact is also measured through interaction and direct feedback from audiences. Newsrooms, traditionally oriented toward a top-down dissemination of information, are transforming into true listeners of the public. This approach recalls that of journalists who, in the past, would meet with their audience for lack of digital means. A practice brought up to date by SVT with the Fika med SVT approach, where journalists shared snacks with citizens to better grasp and reflect their perspectives. Newsrooms are becoming more like communicating vessels with their audiences, including the youngest (a vital evolution to avoid the “cringe” effect around the question of the right emoji or embarrassing “daddy dancing” moments).
Our children live in a different digital world. The future might well resemble fragments of the present, where individual influencers command vast audiences, and where social networks and text media take a back seat to video platforms with recommendation-focused algorithms, sometimes featuring ultra-violent news.
In the meantime, among the testimonials we have collected from journalism students in France, very few mention influencers. They do not primarily choose the web and social networks option offered by schools and still aspire to join a media outlet, a reassuring fact. And a certain number of people (including young ones) do not even have a presence on social networks marked by influencers.
Even if (or because) young people are the first to use social networks to inform themselves, media and information literacy integrating content creators is essential to avoid the mixing of genres in this new dynamic of influencers-journalists. Finding the right balance between attracting young people and maintaining traditional audiences is essential. Beyond buzzwords like AI, immersion, or gaming, it is important to forge a better relationship with our audiences. “Video didn’t kill the radio,” and influencers do not signify the end of journalism. Creators are redefining the codes of information. HugoDécrypte’s social networks now cumulate over 14 million followers, thus surpassing Le Monde, and MrBeast has more subscribers than Netflix. Let’s learn from each other. Influencers will be a bit more influenced by journalists, and journalists will become a bit more like influencers.* Happy reading!
*in the sense of the impact so sought after by public service media, not in the pejorative sense of manipulation, of course.
Journaliste-Influenceur : moins de média, plus de service ?
Nous y sommes ! Les réseaux sociaux d’HugoDécrypte cumulent plus de 14 millions de followers, surpassant ainsi Le Monde, et MrBeast compte plus d’abonnés que Netflix. Selon le dernier Digital News Report du Reuters, les jeunes, pour s’informer, citent davantage les créateurs de contenu que les marques média traditionnelles. Le journalisme n’est plus l’apanage des médias depuis la révolution des réseaux sociaux, qui a transformé chacun en potentiel journaliste, influenceur ou plutôt créateur de contenu, comme ces derniers préfèrent être appelés. L’époque du carpet bombing et du gatekeeping est bel et bien révolue pour les médias, même si, dans les paradis artificiels de l’IA générative et en pleine « super-année électorale », on ressent de nouveau le besoin d’une référence identifiée, voire d’une source unique de l’information labellisée, watermarkée et triplement vérifiée.
Par Kati Bremme, Directrice de l’Innovation et rédactrice en chef Méta-Media
Face à cette réalité, les médias traditionnels doivent relever un défi majeur : évoluer pour séduire un public jeune, indispensable à la démocratie, ou risquer de perdre cette audience au profit d’influenceurs charismatiques qui captivent une génération souvent en proie au doute et à l’inquiétude avec des formats divertissants. Faut-il les imiter, les intégrer ou les défier ? On cherchera la réponse dans ce nouveau cahier de tendances Méta-Media, qui réunit « anciens » et « modernes », y compris des journalistes en l’herbe encore en école, autour de témoignages, décryptages et solutions.
Au siècle dernier, le journaliste jouait inévitablement le rôle d’influenceur, étant, par l’intermédiaire du média qui l’employait, la seule et unique source d’information pour la plus grande partie de la population. Aujourd’hui, depuis le miracle de l’Hudson River rapporté sur feu Twitter, tout le monde peut être journaliste, influenceur ou plutôt créateur de contenu, comme ces derniers préfèrent être appelés, qu’ils soient macro, micro ou nano…
Autrefois, le métier d’influenceur fut réservé à l’élite médiatique. Aujourd’hui, il est à la portée de tous grâce aux outils numériques. Contrairement aux rédactions traditionnelles, les créateurs adoptent rapidement les innovations de l’IA pour amplifier leur impact. Ils n’ont plus besoin de presse à imprimer ou de stations de radiodiffusion pour atteindre de larges audiences. Avec des moyens de création, de diffusion et de personnalisation automatisés, ils peuvent désormais toucher un public vaste et diversifié, révolutionnant ainsi le paysage médiatique.

De gauche à droite, captures des comptes de : Dylan Page, UnderTheDeskNews et Salomé Saqué
Arianna Huffington fut parmi les premières à se lancer sur Internet sous forme de blog (la version web 1.0 de l’influence). Elle a été suivie par des journalistes comme Samuel Etienne, qui faisait vivre la presse sur Twitch pendant la pandémie en incarnant le rôle du « boomer » parlant aux jeunes façon web 2.0. Quelle est la recette du succès de HugoDécrypte, Taylor Lorenz, Rana Ayyub, Squeezie, Fang Fang, Maria Ressa, Kara Swisher & Co ? Comment les médias traditionnels peuvent-ils rester pertinents alors que les audiences se tournent de plus en plus vers les 50 millions de créateurs de contenu dans le monde, dont 150 000 en France, partageant leurs intérêts et compétences en ligne ?
Nouvelle relation, nouvelle définition
Des millions de jeunes préfèrent déjà les influenceurs et créateurs comme sources d’information de confiance. Cette confiance des consommateurs n’est pas nécessairement basée sur la qualité du reportage ou le prestige d’une marque, mais sur de solides relations parasociales. Elle n’a pas besoin de l’intermédiaire d’un journaliste : les jeunes internautes plongent volontairement dans les sujets d’actualité qui les intéressent en utilisant la barre de recherche de TikTok pour construire leur avis, souvent influencés par des figures populaires en ligne.
Le Larousse décrit toujours le journaliste comme une « personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice du journalisme dans un ou plusieurs organes de presse écrite ou audiovisuelle ». Mais le métier lui-même est en train de glisser vers de nouveaux horizons. Qu’est-ce qui définit un journaliste aujourd’hui ? La carte de presse ou son travail ? Travailler pour un média donné, qu’il soit public ou privé, signifie déjà une certaine réduction de l’indépendance, le journaliste devant se plier à une ligne éditoriale plus ou moins orientée. Les journalistes présentateurs télé, par leur rôle incarné, ont d’ailleurs peut-être toujours été un peu plus « influenceur » que leurs homologues de la presse écrite, à l’instar de Bernard Pivot, capable de propulser les ventes d’un livre présenté dans son émission emblématique. Aujourd’hui, l’information télévisuelle tend davantage vers le divertissement à coup de technologies immersives, une évolution fortement influencée par les tendances des chaînes télévisées américaines.

Bernard Pivot, l’un des premiers « journalistes-influenceurs » culture, INA
Quand le rapport de force des rédactions avec leurs publics n’a pas changé depuis des siècles, les relations des influenceurs avec leurs followers sont plus bilatérales : ils sont à l’écoute, interagissent, suivent les conseils de leur communauté, et parfois même les incluent dans leurs contenus. Ils expriment souvent une perspective subjective et intime sur des sujets personnels et peuvent discuter de questions banales ou personnelles, équilibrant autopromotion et authenticité. Certains « influenceurs-blogueurs » ont plus tard su capitaliser sur leur rapport privilégié et leur compréhension des besoins des audiences, à l’instar d’Ezra Klein qui a commencé par un « web log », et qui fut parmi les premiers blogueurs à avoir obtenu une accréditation presse pour un événement politique en 2004, en fondant en 2014, Vox Media.
L’Information-Divertissement
La notion du journalisme comme institution visant à éduquer, informer, et élever est aujourd’hui ébranlée par la pression commerciale qui l’oriente vers le divertissement. À contre-courant, un nouveau journalisme citoyen s’est développé sur les réseaux sociaux et Internet. Avec l’IA générative, nous assistons déjà à l’essor d’influenceurs virtuels, et il sera facile demain de transformer un texte en podcast ou en vidéo, abolissant les frontières entre les formats classiques de l’information, au service d’une production de masse, ou de qualité, selon les impératifs économiques et les volontés éditoriales des uns et des autres.
Je me souviens encore des réactions dans les rédactions quand on leur présentait la chaîne HugoDécrypte, du jeune Hugo Travers qui s’était lancé dans des formats d’information sur YouTube en 2015. « Ce n’est pas du journalisme ». Pas assez sérieux. Pas assez formaté. Trop incarné. Trop divertissant. Trop clivant. « Mais ça plaît aux jeunes ».
Hugo Travers crée en 2015 sa chaîne YouTube, HugoDécrypte
Grâce à leur approche pédagogique et leur forte présence sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu rendent l’actualité accessible à un public souvent détaché des médias traditionnels. Des journalistes influenceurs comme le YouTubeur américain Philip DeFranco ou la journaliste indienne Faye D’Souza utilisent leurs plateformes pour présenter l’actualité de manière directe et engageante. Ces professionnels réussissent à combler le fossé entre le journalisme traditionnel et les attentes d’un public connecté, avide d’immédiateté et de transparence. L’information devient davantage communication, et ceci dans les deux sens.Contrairement aux discours répandus, les jeunes générations font bien une différence entre journalistes et influenceurs, comme nous l’explique Anne Cordier : les adolescents distinguent nettement les créateurs de contenu – qu’ils appellent alors souvent « influenceurs » – qui diffusent du divertissement et du témoignage (comme Squeezie, cité comme référence à propos des jeux vidéo, ou Léna Situations, que les jeunes filles apprécient pour ses publications sur la mode) – et ceux qui produisent du contenu informationnel plus sérieux à leurs yeux (comme Mister Géopolitix ou Jemenbatsleclito, compte de la créatrice féministe Camille Aumont Carnel).
Grâce à leur approche pédagogique et leur forte présence sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu rendent l’actualité accessible à un public souvent détaché des médias traditionnels. Des journalistes influenceurs comme le YouTubeur américain Philip DeFranco ou la journaliste indienne Faye D’Souza utilisent leurs plateformes pour présenter l’actualité de manière directe et engageante. Ces professionnels réussissent à combler le fossé entre le journalisme traditionnel et les attentes d’un public connecté, avide d’immédiateté et de transparence. L’information devient davantage communication, et ceci dans les deux sens.Contrairement aux discours répandus, les jeunes générations font bien une différence entre journalistes et influenceurs, comme nous l’explique Anne Cordier : les adolescents distinguent nettement les créateurs de contenu – qu’ils appellent alors souvent « influenceurs » – qui diffusent du divertissement et du témoignage (comme Squeezie, cité comme référence à propos des jeux vidéo, ou Léna Situations, que les jeunes filles apprécient pour ses publications sur la mode) – et ceux qui produisent du contenu informationnel plus sérieux à leurs yeux (comme Mister Géopolitix ou Jemenbatsleclito, compte de la créatrice féministe Camille Aumont Carnel).
Et ils préfèrent ces formats pour s’informer, au même moment où certains managers de rédactions historiques crient encore au loup quand on veut faire entrer TikTok dans le modèle de distribution de l’information. Le paysage des influenceurs est un espace vaste et en constante évolution. Avant de dénoncer l’abêtissement placide du lecteur ou sa manipulation par les tenants du nouveau discours médiatique, il faudra écouter la journaliste américaine Kara Swisher, qui remarque que les médias devraient réellement s’inquiéter : chaque jour, la qualité des contenus de la blogosphère augmente tandis que celle des rédactions print baisse.
De nouvelles marques d’influence émergent en intégrant les nouveaux usages des jeunes générations (et de plus en plus ceux des plus anciennes). Brut a été parmi les premières plateformes qui utilisent des vidéos courtes et percutantes pour diffuser l’actualité. Leur approche visuelle et narrative (non incarnée à leurs débuts, incarnée aujourd’hui) a permis de répondre aux usages d’un large public. Comme le prédisent nos collègues de Yle, bientôt, il faudra diffuser l’information sur Roblox, si l’on veut encore toucher la génération Alpha qui s’identifie désormais plus à leur avatar qu’à leur propre reflet dans un miroir.
De l’intention d’influer
Que fait alors un journaliste influenceur ? A-t-il l’intention d’influencer l’opinion publique ? L’amalgame entre influenceurs et journalistes nuit certainement à la compréhension des jeunes de ce qu’est l’information. En septembre 2023, Taylor Swift a appelé ses 280 millions d’abonnés sur Instagram à s’enregistrer sur les listes électorales, provoquant un afflux immédiat de 35 000 jeunes, et Léo Nora, plus de 17 000 abonnés sur son compte TikTok, a publié une vidéo en anglais visionnée près d’un million de fois depuis novembre dernier. « Ne venez pas à Paris pour les Jeux olympiques ». De la rumeur à l’info vérifiée, sur les réseaux sociaux il n’y a aucune hiérarchie, aucun rédacteur en chef. Question d’actualité : Un influenceur peut-il être payé pour faire la promotion d’un parti politique ?
Déjà en 2004, le Boston Chronicle soulignait la nature particulière des blogueurs d’information de l’époque, dont l’écriture se caractérisait par un style subjectif, à une époque où la vidéo sur smartphone n’existait pas encore : « Quiconque possède un ordinateur et un logiciel de publication à domicile peut se qualifier comme il le souhaite. Si c’est un couple de retraités qui décide simplement qu’ils ont une opinion, cela ne fait pas d’eux un organe de presse. Cela fait juste d’eux un couple de retraités avec une opinion et un site web. » En tant que médias d’information, les influenceurs naviguent souvent dans cet espace flou entre le journalisme et le plaidoyer, n’hésitant pas à orienter leurs audiences vers des collectes de fonds pour des partis et des candidats dans cette « super-année électorale ».
TikTok a toujours revendiqué une volonté de divertissement, mais les usages ont évolué vers des fonctionnalités de moteur de recherche et de consultation d’information (avec la guerre en Ukraine, le feuilleton judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard et la guerre israélo-palestinienne). Sa croissance rapide a attiré des messages politiques partisans, de la désinformation et des théories du complot. La surveillance et l’enquête sur la propagation de ces messages sont compliquées par l’absence d’une API (interface de programmation d’application) approuvée pour accéder au flux de données générées sur la plateforme chinoise.
« Depuis 2016, la tendance est que les messagers les plus puissants en politique sont des gens réels, des gens de la communauté qui ressemblent à vos voisins », a déclaré Bradley Beychok, président du comité d’action politique American Bridge 21st Century. Les politiques s’appuient de façon croissante sur des micro-influenceurs dans leur campagne.
Le journalisme numérique converge avec la culture de l’influence. Les médias traditionnels mettent en avant les biographies des journalistes, et de plus en plus de sujets vidéos sont incarnés. Devons-nous tous devenir influenceurs ? La rédaction du New York Times adopte une politique restrictive à ce sujet. Pourtant, le comité chargé d’examiner les projets extérieurs des journalistes a approuvé plus de 90 % des 200 projets proposés par des journalistes désireux de développer leur propre marque. D’autres médias intègrent directement des influenceurs dans leurs équipes rédactionnelles.
L’authenticité performative
En utilisant la métaphore d’une pièce de théâtre théorique, le sociologue Erving Goffman a décrit le concept de la représentation de soi en tant qu’« acteur ». Une interprétation transposable dans l’histoire plus récente, où les influenceurs investissent dans la gestion des impressions. Ils utilisent des techniques de storytelling, des filtres, des montages, et des collaborations stratégiques pour façonner une image cohérente et attrayante. Leur succès dépend souvent de leur capacité à contrôler et à diriger les perceptions de leur audience.
La dynamique entre les influenceurs et leur audience est interactive. Les commentaires, likes et partages servent de feedback, guidant les performances futures, la ligne éditoriale et les thématiques choisies. Cette interaction crée un cycle de rétroaction où l’audience influence les contenus et vice versa. Les influenceurs ajustent leur contenu en fonction des réactions, optimisant constamment leur impact et leur reach, ce qui peut poser problème pour des contenus d’information. Un paradoxe clé est la quête d’authenticité dans des performances stylisées : ils doivent sembler authentiques tout en étant performatifs. Cette tension, centrale à leur succès et crédibilité, est souvent gérée par la divulgation contrôlée de vulnérabilités ou de moments « réels », créant un lien émotionnel tout en gardant un contrôle narratif.
D’un autre côté, la dissimulation de la subjectivité est rendue d’autant plus facile que les techniques de reproduction mécanique gomment la singularité de l’original (« l’aura » de Walter Benjamin). Désincarnation perverse puisque, loin de supprimer entièrement l’émotion, elle en déplace plutôt l’objet vers la satisfaction d’une sorte de spectacularisation vaine de la vie. Dans les médias historiques, où il y avait auparavant des départements de ventes pour gérer la distribution optimisée des journaux, ce sont aujourd’hui davantage les journalistes eux-mêmes qui doivent marketer l’information sur les réseaux sociaux. Ils ont alors développé une relation d’amour-haine avec les plateformes. La « schizophrénie numérique » nous laisse perpétuellement tiraillés entre la fascination et la peur des nouvelles technologies.
Équilibres économiques fragiles
Nathan Myhrvold, ex-CTO de Microsoft, a décrit le dilemme des rédactions au 21ème siècle : « Qui paiera pour l’information ? » On se souvient des opérations de séduction des dirigeants des réseaux sociaux auprès de médias historiques pour alimenter leurs plateformes de contenus de qualité aux débuts de la révolution numérique. Rapidement, ces premiers se sont aperçus qu’ils pouvaient générer une meilleure rétention (indicateur important pour la publicité) avec le divertissement et les vidéos drôles plutôt qu’avec des analyses approfondies et des reportages d’information vérifiés, mettant ainsi en danger des médias entiers qui avaient construit leur économie sur un canal de diffusion contrôlé par les GAFAM. Les récentes modifications de l’algorithme d’Instagram pour limiter la visibilité du contenu politique ont entraîné une baisse de l’engagement de 70 grands comptes d’actualités, diminuant de 26 % leurs interactions, quand ce n’est pas Meta qui met simplement fin à l’accès aux informations sur Facebook et Instagram de tous les utilisateurs au Canada.
Malgré un statut de journaliste entrepreneur fragile et dépendant des plateformes, beaucoup de jeunes journalistes, pour qui le carcan d’une rédaction historique paraît trop restrictif, se rêvent en influenceur, en « enfants les plus cool du quartier », incités à accroître leur audience et, en retour, souvent leur compte en banque. Pour d’autres, ce choix devient une nécessité imposée par le manque d’opportunités disponibles dans les rédactions traditionnelles. Il reste que la combinaison des influenceurs et des algorithmes des médias sociaux est peut-être la forme de publicité la plus puissante jamais inventée.
Mais la lutte solitaire sur les réseaux sociaux est rude, et la pertinence culturelle n’est pas éternelle. C’est un job 24/7, l’algorithme des réseaux sociaux ne pardonne pas la relâche, les GAFAM ne connaissent pas les congés payés. Et chaque réseau social a ses spécificités. TikTok est le meilleur endroit pour rapidement gagner une large audience, YouTube pour la monétiser sur le long cours, et Instagram est historiquement le lieu des deals avec des marques. Pour X, « it’s complicated ». Il est vrai que l’« investissement influence » se pare des plus beaux atours : pour 1 euro investi, le retour s’élève en moyenne, à 9,60 euros.
Pour l’instant, les start-ups de journalisme attirent des audiences importantes et dévouées, mais peinent à convertir cette fidélité en soutien financier. La plupart d’entre elles dépendent de financements philanthropiques, qui restent rares et fragmentés. Dans un double élan d’indépendance à la fois éditoriale et économique, on a pu observer pendant la pandémie mondiale le départ d’un certain nombre de journalistes des grandes rédactions emblématiques pour lancer leur propre newsletter. On les surnommait alors les substackerati, d’après la plateforme qui leur sert d’outil de publication.
Une autre réponse à la quête de modèle économique des influenceurs pour éviter la navigation dans les eaux troubles du mélange de publicité et d’information sont peut-être les technologies du Web3, ce nouvel Internet participatif, dont l’adoption grand public se fait attendre. Un des éléments clés du Web3 est une expérience centrée sur l’utilisateur. Cette expérience n’a pas besoin d’une plateforme centrale, comme X, TikTok ou YouTube, pour médier les interactions de pair à pair. Des sites comme WeAre8 ou Good-Loop récompensent les utilisateurs engagés en partageant un pourcentage de revenus. Le Web3 permet également la « propriété » d’actifs numériques comme l’a expérimenté le magazine TIME. Les principes de ces technologies peuvent être appliquées au journalisme et créer une nouvelle manière de consommer l’information. Le prochain TikTok ne sera peut-être pas une seule plateforme, mais une relation directe avec les publics. Et « le coût par téléportation » dans Roblox sera peut-être le prochain coût par clic.
Formats longs et journalisme investigatif
Les journalistes qui quittent le havre sécurisé d’une rédaction et le contexte ingrat de la « littérature pressée », qualificatif attribué par le poète Matthew Arnold au journalisme, ne datent pas d’hier : le nombre de journalistes devenus écrivains est pléthore (certains diront même que les meilleurs écrivains sont ceux qui ont un background de journaliste). Le livre pour un journaliste de presse papier est un peu ce qu’est le documentaire pour un journaliste télé. Le nombre de tirages d’un livre n’est-il pas un peu l’équivalent d’un nombre de likes ? Face à des rédactions qui réduisent leurs moyens à peau de chagrin, ferment leurs bureaux à l’étranger et ont privilégié pendant des années la course après l’actu chaude, souvent accompagnée d’une gestion superficielle des réseaux sociaux, des journalistes indépendants qui se consacrent à des formats longs et au journalisme d’investigation se démarquent en prenant le temps de développer leurs histoires.
🏆#PrixAlbertLondres23
Prix presse écrite @wilsonfache pour ses reportages en Afghanistan, Tel Aviv & Ukraine
Prix audiovisuel @hlamtrong – « Daech, les enfants fantômes » @Cineteve_prod
Prix du livre @N_Legendre – « Silence dans les champs » @EditionsArthaudhttps://t.co/aKlzLaA7ia pic.twitter.com/W5FTb8p8s7— Prix Albert Londres (@albert_londres) November 27, 2023
Ce que certains journalistes indépendants peuvent se permettre au prix d’une multitude de tâches allant de la production de contenu à la gestion de leur propre marketing et finances, les rédactions peuvent seulement le mettre en place quand il y a collaboration ou partenariat. Ou changement de priorités. Ou fusion… Michael Moore explique que ses documentaires expriment ses opinions, laissant chaque spectateur se faire la sienne. Des journalistes indépendants peuvent prendre le temps sur une histoire, contrairement à beaucoup de rédactions traditionnelles qui peinent à mettre à jour leurs priorités.
Influenceurs sous influence en Asie
Les influenceurs en Asie jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique et la diffusion des tendances, d’autant plus dans des États à la marge de la démocratie. Alors que leur popularité continue de croître, une méfiance croissante envers les médias d’État et les tentatives des gouvernements de reprendre le contrôle de la présence des influenceurs en ligne remettent en question un modèle de liberté émergent. En Chine, le journaliste Luo Changping utilise les réseaux sociaux pour critiquer les politiques gouvernementales, souvent au risque de représailles. L’influenceur Chen Qiushi a gagné en notoriété pendant l’épidémie de Covid-19 en partageant des témoignages directs de Wuhan, mettant en évidence les écarts dans les rapports officiels.
Ce double rôle de reportage et d’influence leur permet de façonner le discours public tout en marchant sur une corde raide de régulations gouvernementales. En Inde, des journalistes comme Faye D’Souza utilisent les médias sociaux pour fournir des analyses critiques et des reportages indépendants. En Corée du Sud, des figures comme Joo-Jin Woo, journaliste d’investigation, sont populaires pour leurs enquêtes approfondies sur la corruption et les abus de pouvoir. Au Japon, des journalistes comme Shiori Ito, y abordent des questions de justice sociale et de politiques publiques (notamment autour de l’égalité des sexes), et jouent un rôle essentiel pendant les élections en partageant des informations critiques et des perspectives alternatives, influant les débats publics et les choix électoraux.
It’s time for #NLHafta!
This week, @AbhinandanSekhr, @ramankirpal, @javashree, and @tweets_prateekg are joined by @fayedsouza to discuss Maharashtra and Delhi polls, Pune’s #Porsche car crash, and more.
Tune in: https://t.co/q90ivqCSGk pic.twitter.com/udgJcrzJet
— newslaundry (@newslaundry) May 26, 2024
Mais très vite, les gouvernements ont mis en place des mesures qui visent à encadrer l’influence des célébrités numériques et à s’assurer que leurs messages restent conformes aux directives officielles. Le phénomène des journalistes influenceurs sur les plateformes de médias sociaux chinois en particulier reflète l’interaction unique entre le journalisme, les médias sociaux et le contrôle de l’État. La direction centrale du Parti a adopté une fonction de surveillance médiatique pour renforcer son contrôle sur une administration défaillante et pour mettre en lumière les aspects du capitalisme bureaucratique devenus si implacables qu’ils compromettaient la survie même du système.
Un nouveau journalisme de surveillance, incarné par des influenceurs y compris étrangers, promet de renforcer l’hégémonie du Parti en lissant les aspérités de la transformation chinoise en cours et en surveillant les frontières politiques, économiques et numériques d’une société de marché autoritaire émergente.
L’incarnation de la communauté
Pour certains, le journalisme en dehors des rédactions est aussi le seul moyen de s’affirmer. Taylor Lorenz, journaliste au Washington Post et spécialiste de la culture numérique, a exploré l’histoire des créateurs de contenu sur Internet et observe que « les premiers influenceurs étaient des femmes parce que les médias ne s’intéressaient pas à leurs centres d’intérêt ». Les influenceurs utilisent les plateformes sociales pour aborder des sujets souvent sous-représentés dans les médias traditionnels, offrant ainsi une diversité de perspectives et enrichissant le débat public, en prenant en charge une partie du travail d’un service public.
Même si des efforts sont en cours dans la plupart des médias, construire et renforcer son audience demain passera forcément par l’intégration des minorités dans la production de contenu pour établir un lien authentique avec des publics plus jeunes, et pour contrer une époque fragmentée, où les masses sont difficiles à atteindre. The Vice Guide to Culture 2023 avait déjà souligné que les jeunes générations « se tournent vers leurs pairs et leurs communautés de confiance avant de choisir de faire confiance à des experts extérieurs. En outre, ils boycottent collectivement les organisations en lesquelles ils ne croient pas ».
Dylan Page (10M), jeune créateur de contenu d’information du Royaume-Uni, compte plus de followers et de vidéos vues que la BBC (2,6 M) et le New York Times (570K) réunis, même sur des sujets d’actualité comme Gaza. Les reporters de guerre traditionnels n’ayant pas pu se rendre à Gaza, bon nombre des témoignages les plus convaincants ont été racontés par des habitants, y compris par une nouvelle génération présente sur les réseaux sociaux.
View this post on Instagram
Plestia Alaqad est une habitante de Gaza dont la documentation sur les difficultés de la vie quotidienne a apporté une touche personnelle absente des médias grand public. Face à ces enjeux, WhatsApp prend de l’importance pour l’information. Avec le lancement de Threads et de Bluesky, le travail des équipes chargées de l’engagement du public est devenu plus exigeant que jamais. Les grands médias cherchent de plus en plus à élargir l’éventail des voix qui couvrent les sujets.
Les attentes des consommateurs en matière de représentation des communautés minoritaires sont de plus en plus sophistiquées, en commençant par la personne, et non l’identifiant tel que le genre, la sexualité ou la race. Les communautés minoritaires réécrivent les règles d’engagement avec les marques, recherchant des récits et des partenariats qui compliquent la représentation au lieu de la simplifier. Veiller à ce que l’information soit accessible à tous n’est pas seulement une question de responsabilité éthique, mais aussi une obligation légale dans l’Union européenne.
Régulation du Far West
Le Conseil européen a approuvé des conclusions pour soutenir les influenceurs en tant que créateurs de contenu en ligne dans l’UE. Il incite les États membres à dialoguer avec les influenceurs et leurs organisations pour clarifier leur rôle et la législation applicable. Par ailleurs, il demande à la Commission d’explorer des moyens de soutien au niveau européen, y compris l’éducation aux médias, la promotion de la responsabilité en ligne, et l’utilisation des fonds et programmes de l’UE.
L’Europe n’est pas la seule région au monde à se pencher sur l’encadrement des influenceurs de plus en plus influents : en Chine, la loi sur la cybersécurité impose des restrictions sévères sur les contenus en ligne, avec des sanctions importantes pour les infractions. En Inde, les législations récentes exigent des plateformes de réseaux sociaux qu’elles surveillent et régulent les contenus publiés par les influenceurs. Au Japon, le code d’éthique pour les influenceurs impose des règles claires sur la divulgation des relations commerciales. Les créateurs doivent également respecter des normes élevées de conduite en ligne en Corée du Sud, où les lois sur la protection des consommateurs exigent une transparence renforcée au sujet des contenus sponsorisés.
@faganchelseaIt has to end!!!♬ original sound – faganchelsea
Et le phénomène est en train de s’auto-réguler un peu : la tendance du « désinfluence » (ou « deinfluencing ») est une réaction (plus ou moins sincère) aux pratiques traditionnelles des influenceurs sur les réseaux sociaux. Au lieu de promouvoir constamment des produits et d’encourager la consommation, les « désinfluenceurs » incitent leur public à être plus sélectif et réfléchi dans leurs achats. Cette tendance critique les recommandations souvent exagérées des influenceurs et se concentre sur la réduction de la surconsommation, ce qui a des avantages pour l’environnement et le bien-être personnel, …et l’écosystème informationnel.
Quand il y a quelques années encore, les réseaux sociaux des débuts faisaient office de nouvelle machine à café où l’on s’échangeait nos expériences (de visionnage des programmes télés en direct) dans une sorte d’Agora, nous vivons aujourd’hui dans un monde fragmenté où il est plus facile que jamais d’ignorer totalement ce que les autres consomment. Il est également plus facile que jamais d’accorder une importance démesurée à des informations ou à des tendances qui peuvent sembler populaires mais qui sont en réalité très confinées. Dans ce nouveau monde, où les algorithmes de recommandation l’emportent sur l’ancien modèle des followers, les seuls géants de la Tech sont les gatekeeper de la connaissance sur la façon dont l’information circule sur leurs plateformes, d’autant plus s’ils détiennent en même temps le Saint Graal de l’IA générative.
Journalistes artificiels et désinformation
Avec l’arrivée de l’IA dans les rédactions, l’avenir du journalisme soulève de nombreuses questions. Julian Assange exhorte les journalistes à adopter une approche scientifique, en s’appuyant sur des sources vérifiables. Dans ce nouveau monde mi-réel mi-artificiel, on assiste à l’apparition de présentateurs-influenceurs malgré eux : Nota Bene et Cyprien ont vu leur image utilisée sans leur consentement par l’IA, tandis que Julien Bugier et Anne-Claire Coudray se sont retrouvés à promouvoir des produits dans des publicités à leur insu. Notre cahier 2023 était consacré à l’IA dans les rédactions, un phénomène accéléré par le lancement de ChatGPT. Nous ne traiterons donc de ce sujet qu’en marge ici. Mais face à une profession qui est constamment remise en question ces dernières années, l’émergence de plumes automatiques ajoute encore quelques interrogations dans une série déjà longue de défis.

Image extraite d’une des deepfakes montrant Anne-Claire Coudray et Maître Gims, Vrai ou Faux
Après la transformation numérique, nous vivons désormais une transformation virtuelle. Les outils basés sur l’IA qui modifient le langage de l’information afin d’améliorer la pertinence et la compréhension pour des publics particuliers seront de plus en plus présents dans le paysage de l’information dans les années à venir. Les chatbots, les applications et les extensions de navigateur répandront de plus en plus leur influence. Les leaders d’opinion clés chinois (KOL), en particulier dans l’industrie du commerce électronique, se tournent déjà vers des clones numériques pour générer du contenu 24 heures sur 24.
Selon le MIT Technology Review, l’entreprise Silicon Intelligence, basée à Nanjing, peut créer un clone IA simple pour seulement 8 000 yuans (environ 1 000 euros), prix qui peut augmenter pour une programmation plus complexe. La société n’a besoin que d’une minute de séquences vidéo d’un être humain pour former un vidéaste virtuel. Dernièrement, les « Pleureurs Virtuels » sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux. Dans le monde des influenceurs où chacun cherche à se démarquer, jusqu’où peut-on aller trop loin ?
Anciens avec modernes
Aujourd’hui, plus de jeunes aspirent à devenir influenceurs que journalistes. Il est tellement séduisant de pouvoir échapper à l’incertitude économique en gagnant les cœurs (et les esprits) de l’Internet, même si l’équilibre économique reste fragile. Si les créateurs de contenu sont la nouvelle industrie médias, que deviennent alors les médias traditionnels ? Ne pourrait-on pas tout simplement réunir le meilleur des deux mondes sous le même toit ?
Cette dynamique pousse les médias à innover et à adapter leurs formats pour rester pertinents. Des collaborations entre médias traditionnels et influenceurs, comme celle de Samuel Etienne sur Twitch avec France Télévisions, de la streameuse Quineapple avec Arte ou encore des créateurs de contenus écologiques qui participent à 2050Now, le nouveau média du groupe les Echos-le Parisien, montrent que l’intégration des techniques des influenceurs peut enrichir l’offre médiatique.

Capture girl_go_green pour 2050Now
La Deutsche Welle Akademie et ses partenaires en Serbie, où les réseaux sociaux regorgent de commentaires haineux non modérés, collaborent avec des influenceurs YouTube pour rendre l’éducation aux médias plus captivante pour les jeunes. Ce projet transforme les idoles des adolescents en éducateurs. Lorsqu’ils parlent de cybersécurité, de discours haineux ou de harcèlement, les YouTubeurs, autorités crédibles, ont plus de poids. Par ailleurs, l’UNESCO facilite des échanges de compétences entre journalistes et influenceurs, affirmant ainsi l’intérêt de valoriser une collaboration entre ces deux sphères plutôt que de les considérer en opposition.
Imaginer la nouvelle cuisine journalistique
Cette nouvelle dynamique avec les audiences marque un tournant pour les médias de service public. Fini le temps où seuls les indicateurs commerciaux comme le nombre d’abonnés ou de visites dictaient leur succès. Aujourd’hui, l’impact se mesure aussi à travers l’interaction et le retour direct des audiences. Les rédactions, traditionnellement orientées vers une transmission d’information descendante, se transforment en de véritables écouteurs du public. Cette approche rappelle celle des journalistes qui, autrefois, allaient à la rencontre de leur public faute de moyens numériques. Une pratique remise au goût du jour par la SVT avec la démarche Fika med SVT, où les journalistes partageaient le goûter avec des citoyens pour mieux saisir et refléter leurs perspectives. Les rédactions deviennent davantage des vases communicants avec leurs audiences, y compris les plus jeunes (évolution vitale pour éviter l’effet « cringe » autour de la question du bon émoji ou des moments embarrassants de « daddy dancing »).
Nos enfants vivent dans un monde numérique différent. L’avenir pourrait bien ressembler à des fragments du présent, où des influenceurs individuels commandent de vastes audiences, et où les réseaux sociaux et les médias textuels passent au second plan au profit de plateformes vidéos dotées d’algorithmes axés sur les recommandations, qui mettent parfois en scène des actualités ultra-violentes.
En attendant, parmi les témoignages que nous avons récoltés auprès d’étudiants en journalisme en France, très peu évoquent les influenceurs. Ils ne choisissent pas en priorité l’option web et réseaux sociaux proposée par les écoles et aspirent toujours à intégrer un média, fait rassurant. Et un certain nombre de personnes (y compris des jeunes) n’ont même pas de présence sur les réseaux sociaux marqués par les influenceurs.
Même si (ou parce que) les jeunes sont les premiers à utiliser les réseaux sociaux pour s’informer, une éducation aux médias et à l’information intégrant les créateurs de contenu est essentielle pour éviter le mélange de genres dans cette nouvelle dynamique influenceurs-journalistes.
Trouver le juste équilibre entre l’attraction des jeunes et le maintien des audiences traditionnelles est essentiel. Au-delà des mots à la mode comme IA, immersion ou gaming, il est important de forger une meilleure relation avec nos publics. « Video didn’t kill the radio », et les influenceurs ne signifient pas la fin du journalisme.
Les créateurs redéfinissent les codes de l’information. Apprenons les uns des autres. Les influenceurs seront un peu plus influencés par les journalistes, et les journalistes deviendront un peu plus influenceurs.*
Accédez au cahier complet Journaliste-Influenceur
Bonne lecture !
*dans le sens de l’impact tant recherché par les médias de service public, pas dans un sens péjoratif de la manipulation, bien sûr.
Couverture du cahier #23 : Anna Wanda Gogusey