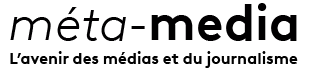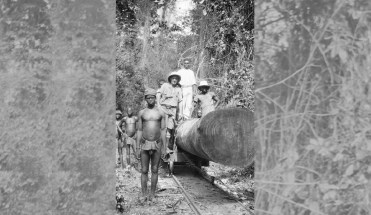Débrancher les dieux – Manifeste pour une insurrection de la pensée

Les frontières entre réalité et illusion s’effacent sous l’effet des intelligences artificielles et une prédiction formulée dès les années 1990 par Nicholas Negroponte dans son ouvrage Being Digital semble s’accomplir : la dématérialisation croissante des interactions humaines. Jamais l’accès au savoir n’a paru aussi vaste, jamais la science n’a été aussi performante, et pourtant jamais les faits n’ont paru aussi fragiles, réduits à de simples croyances effeuillées sur les pages d’un missel en silicone — sacré numérique d’un monde sans dieu.
Par Clément Labréa (pseudonyme)
Loin d’un rejet nostalgique du progrès, je demeure un admirateur inconditionnel des puissances techniques, de la beauté — pour moi inintelligible — du code, de la grâce des systèmes bien conçus. Mais cette fascination n’exclut pas la vigilance. Aimer la technologie ne signifie pas s’y soumettre ; cela implique, au contraire, d’en interroger sans relâche les usages et les dérives.
Peut-être faut-il admettre que ce désordre ne nous est pas tombé dessus : il est le fruit de nos abandons successifs, de notre complaisance, et d’une fainéantise existentielle érigée en norme. Notre époque évoque le paysage dépeint par Douglas Coupland dans Génération X : une société saturée d’informations, où le sens profond et les repères s’érodent, engloutis dans une mer d’indifférence.
La technologie promettait une société éclairée, connectée et informée où l’Homme gagnerait en autonomie, mais elle accompagne paradoxalement — en l’armant — une montée sans précédent de populismes et de dérèglements, rendant à nouveau possibles l’impensable et l’indicible.
Désormais, ce ne sont plus des interfaces, ni même des outils : ce sont des entités logicielles, des agents intelligents, dotés d’autonomie fonctionnelle, de capacité d’adaptation, et d’un objectif assigné : optimiser nos intérêts. Ces entités logicielles apprennent, déduisent, trient nos flux, planifient nos actions, engagent nos ressources. Invisibles, elles deviennent nos délégués, parfois nos substituts. Elles choisissent, nous acquiesçons. Elles décident, nous consommons. C’est là que réside le glissement décisif : ce confort délégué, devenu norme tacite, achève de nous délester du peu qu’il restait à faire. Et c’est ainsi, dans une logique d’efficience algorithmique, qu’elles nous libèrent de la nécessité même de penser et de choisir, actes souvent perçus comme des souffrances.
Qu’il est bon de reléguer le fardeau de l’intention aux machines : cette abdication consentie devient addiction à la paresse, et fait déjà tomber nos inhibitions, nos garde-fous, notre capacité à résister.
Qu’il est bon de reléguer le fardeau de l’intention aux machines : cette abdication consentie devient addiction à la paresse, et fait déjà tomber nos inhibitions, nos garde-fous, notre capacité à résister. Et pendant que la pensée se délite, les despotes en claquettes s’installent tranquillement, t-shirt Prada, pantalon The Row, sneakers Common Projects. Steve Jobs avait ouvert la voie : New Balance 990 de retraité californien, jean neige sans grâce, col roulé noir d’apparatchik zen. Il avait inventé l’uniforme du faux moine, la tenue liturgique du prophète milliardaire, version Cupertino. Il incarnait déjà cette esthétique de l’ascèse, en mode stealth wealth. Une manière de dominer sans bruit, d’écraser en coton peigné. Derrière le minimalisme, la toute-puissance. Derrière le confort, la soumission.
Beaucoup dénoncent la technologie à la légère, comme on fustige un écran en terrasse ou un robot conversationnel sans en comprendre la logique profonde. Cette critique facile m’agace : elle ignore que nous sommes tous, déjà, technologiquement constitués. Il ne s’agit pas de condamner l’outil — mais de refuser qu’il dicte nos formes de vie. Je suis technophile, mais je refuse l’obéissance automatique. Technicien, mais jamais soumis.
Face à cette nouvelle forme de réalité, où le progrès coexiste avec l’obscurantisme et la délégation croissante de notre agentivité à l’intelligence artificielle, la question s’impose avec force : pourquoi continuer à penser, à raisonner, à chercher la vérité si l’ignorance, le cynisme et l’indifférence semblent offrir plus de garanties ? Dans ce contexte troublé, la réflexion n’est-elle devenue qu’un luxe inutile ? Se moquera-t-on un jour de ceux qui persistent à penser ? Raillera-t-on ceux qui lisent encore, doutent encore, refusent de s’en remettre à la machinerie des certitudes algorithmiques ? La machine ne brûle pas les livres, elle les rend silencieux. On m’a dit un jour : tout ce qui ne vient pas du Livre est œuvre du Diable. Aujourd’hui, ce n’est plus un dogme religieux qui interdit la pensée, mais une norme automatisée qui l’étouffe.
Dans ce contexte troublé, la réflexion n’est-elle devenue qu’un luxe inutile ? Se moquera-t-on un jour de ceux qui persistent à penser ?
« The future is in the past », disait Nigo. Le pire n’est pas à craindre : il est là, sous nos yeux, banalisé, absorbé, digéré par l’époque. Nous ne sommes pas à l’aube d’une dystopie, nous vivons déjà dans sa version bêta, sans rébellion, sans sursaut. Et nous sommes, oh nous, frères humains, les seuls responsables. Alors que le progrès technique atteint des sommets inédits, nous tolérons que la pensée se délite, que la science se relativise, que la vérité devienne opinion parmi d’autres. Comment a-t-on laissé faire ? Comment a-t-on laissé revenir la barbarie algorithmique, politique, ordinaire ?
Ce texte ne propose pas un bilan, mais une dissection : de la dépossession douce de nos esprits à l’érosion de nos repères, des prophètes en sneakers aux puissances numériques en roue libre, il trace les contours d’un monde où tout est devenu conditionnel — sauf notre abdication.
L’éthique hacker : des origines libertaires à l’ère de la fermeture
L’éthique hacker naît dans le creuset d’une contre-culture technologique, à la croisée des utopies cybernétiques et des idéaux libertaires des années 1960-70. Elle se structure non pas comme un programme politique, mais comme une praxis, une manière d’habiter les machines en les comprenant, en les détournant, en les partageant. Dans les laboratoires du MIT ou dans les garages californiens, les hackers voyaient dans l’ordinateur non un instrument de pouvoir, mais un vecteur d’émancipation. Il s’agissait de démocratiser l’accès à la machine, de repousser les frontières du possible, de refuser toute centralisation du savoir. L’ordinateur personnel n’était pas encore un produit : il était une extension de l’esprit, un outil de libération cognitive.
Steven Levy en formalise les principes dans son ouvrage fondateur Hackers: Heroes of the Computer Revolution (1984), dressant une typologie morale : ouverture de l’information, méfiance vis-à-vis de l’autorité, culte du mérite technique, et surtout, foi dans le potentiel social de l’informatique. Cette philosophie trouve un écho retentissant dans les initiatives de Richard Stallman, programmeur emblématique du MIT et figure fondatrice du mouvement du logiciel libre. Visionnaire, presque messianique, Stallman voit dans le logiciel libre non seulement un enjeu technique, mais une lutte éthique contre la privatisation du code et l’aliénation numérique. À travers le projet GNU et la Free Software Foundation, il érige le logiciel libre comme un droit fondamental : pouvoir exécuter, comprendre, modifier, partager – autant de gestes politiques dans un monde numérique naissant.
Cet esprit d’ouverture se cristallise également autour du Homebrew Computer Club, espace communautaire fondé sur le partage du hardware, du savoir-faire, des circuits imprimés bricolés et des systèmes d’exploitation artisanaux. Steve Wozniak y conçoit l’Apple I puis l’Apple II dans cette optique d’ouverture – produits que chacun peut démonter, réparer, comprendre. L’informatique est encore une exploration collective, un territoire à conquérir main dans la main.
L’informatique est encore une exploration collective, un territoire à conquérir main dans la main.
Mais cette utopie va rapidement se heurter aux logiques de marché, à l’impératif de rentabilité, à la conquête du contrôle. Le tournant symbolique s’incarne dans le lancement du Macintosh en 1984. Steve Jobs, inspiré par les recherches du Xerox PARC— et profondément marqué par la légendaire Mother of All Demos de Doug Engelbart en 1968, impose une vision industrielle du produit numérique : fini les circuits accessibles, place à l’interface soignée, au système fermé, à l’expérience utilisateur prémâchée. Le Macintosh devient une boîte noire esthétique : belle, fluide, mais hermétique. On ne comprend plus la machine, on la consomme.
Ce glissement ne relève pas du hasard, mais d’un choix stratégique : verrouiller pour fidéliser, maîtriser pour monétiser. Là où l’éthique hacker valorisait l’expérimentation, la bidouille, la subversion des normes, le modèle industriel d’Apple inaugure l’ère des écosystèmes clos, où chaque interaction est calibrée, chaque usage anticipé. Derrière l’obsession de la simplicité se cache la dépossession de l’usager, réduit à un rôle de consommateur captif.
La fermeture devient peu à peu la norme. Le code source se privatise, les formats deviennent propriétaires, les systèmes d’exploitation se referment sur eux-mêmes. Même le Web, initialement conçu comme un espace décentralisé, libre, interopérable, est progressivement phagocyté par des plateformes qui filtrent, hiérarchisent, modèrent, monétisent. L’esprit hacker, réduit à une esthétique marginale, est exilé des grandes architectures numériques contemporaines. Les entreprises qui se présentaient autrefois comme les héritières des pionniers libertaires (Apple, Google, Facebook) sont devenues les gardiennes d’un ordre technologique opaque, centralisé, gouverné par des logiques d’optimisation algorithmique et de verrouillage systémique.
Il faut donc interroger cette dérive non comme une simple trahison morale, mais comme une mutation structurelle : l’éthique hacker n’a pas disparu par désintérêt, mais parce qu’elle s’oppose frontalement aux mécanismes de captation et d’extraction de valeur qui dominent l’économie numérique. Dans cette ère de fermeture, ce ne sont plus des passionnés qui façonnent la technique, mais des architectes de l’opacité, des stratèges de la rétention attentionnelle, des ingénieurs du contrôle.
…l’éthique hacker n’a pas disparu par désintérêt, mais parce qu’elle s’oppose frontalement aux mécanismes de captation et d’extraction de valeur qui dominent l’économie numérique.
Et c’est ainsi que les héros de la révolution numérique, porteurs d’une promesse d’autonomie, sont devenus les agents d’une dépossession méthodique. Le hacker bricoleur, libre et subversif, a été supplanté par le codeur salarié, invisible, soumis aux deadlines, intégré dans des flux de production opaques. Les outils qu’ils fabriquaient pour libérer sont devenus les armes de notre aliénation.
De l’économie de l’attention à la captation algorithmique
La révolution numérique grand public a commencé avec une promesse : celle d’un Internet ouvert, accessible, émancipateur. Un espace décentralisé où chacun pourrait publier, échanger, créer. L’économie numérique naissante se rêvait en écosystème égalitaire. Les fondateurs de Google affichaient l’ambition naïve de ne « pas faire le mal », Facebook se voulait réseau social apolitique, et Amazon… une librairie.
Mais dès la fin des années 1990, les choses se structurent autrement. Derrière les interfaces épurées, les lignes de code s’optimisent pour autre chose : la captation de flux. En 1998, Google introduit PageRank, algorithme capable de hiérarchiser les pages en fonction de leur popularité. L’idée semble simple, mais elle est décisive : la donnée comportementale devient une ressource stratégique. Ce n’est plus l’information qui a de la valeur, mais la trace laissée par celui qui la consulte. Le clic devient actif, mesurable, actionnable.
Ce n’est plus l’information qui a de la valeur, mais la trace laissée par celui qui la consulte.
Les géants du Web comprennent rapidement ce levier. L’économie de l’attention émerge comme un modèle fondé sur la rétention, non sur la satisfaction. Il ne s’agit plus de proposer une réponse, mais de maintenir l’utilisateur dans la boucle. La valeur n’est plus dans le produit, mais dans le comportement qu’il déclenche. Le scrolling infini, les notifications, les recommandations automatiques : autant de mécanismes conçus pour maximiser la durée d’engagement. Ce que les neurosciences ont confirmé plus tard, les ingénieurs l’ont déjà implémenté.
Dans cette dynamique, la loi de Metcalfe agit comme un amplificateur systémique. Plus il y a d’utilisateurs sur une plateforme, plus sa valeur et son attractivité augmentent. Le réseau devient dominant par effet d’échelle. Facebook écrase MySpace. Google élimine Altavista. Amazon étouffe tout concurrent par sa maîtrise de la logistique et de la donnée. Chacun construit son jardin clos, ses walled gardens : des écosystèmes fermés, où tout est intégré — de la recherche à la publicité, du contenu au paiement. L’utilisateur ne sort plus. Il est à l’intérieur, instrumentalisé, profilé, exploité.
Dès les années 2005-2006, le ciblage publicitaire s’affine avec l’essor des cookies tiers, du tracking inter-app, et des premières bases de données comportementales massives. La publicité programmatique devient centrale : il ne s’agit plus de montrer un produit, mais d’anticiper un désir. Google Analytics, Facebook Ads, Amazon Marketplace… Chaque interaction est mesurée, chaque action est un signal. Les plateformes observent, testent, modifient en temps réel. Le comportement est découpé, modélisé, optimisé. C’est un changement structurel : la donnée devient non plus un sous-produit, mais le produit.
La publicité programmatique devient centrale : il ne s’agit plus de montrer un produit, mais d’anticiper un désir.
À partir de 2010, une bascule s’opère. L’accumulation massive de données personnelles alimente une nouvelle technologie en pleine émergence : l’intelligence artificielle. Les systèmes de machine learning — et bientôt de deep learning — transforment la donnée en prédiction. Les modèles comportementaux apprennent à adapter l’interface, à filtrer les contenus, à affiner les suggestions. YouTube ne vous recommande plus ce qui est pertinent, mais ce qui retiendra votre attention. Facebook ne vous montre plus ce que vous aimez, mais ce qui suscitera une réaction émotionnelle. On entre dans l’ère des architectures cognitives manipulatoires.
C’est aussi à ce moment qu’apparaît une voix interne, discordante : Tristan Harris, designer éthique chez Google, alerte dès 2013 sur la dérive en cours. Son fameux Time Well Spent met en lumière ce que les plateformes savent déjà : elles ne sont plus neutres. Elles orientent, sélectionnent, poussent. L’attention est exploitée comme une matière première, la conscience humaine devient un espace de marché. Ce n’est plus un service, c’est une dépendance organisée.
Mais personne n’écoute vraiment. Les résultats sont là, les courbes montent. Les dirigeants restent dans la course à l’optimisation. Harris quitte Google. L’industrie, elle, double la mise. Le modèle est trop performant, trop rentable pour être révisé. Et la prochaine étape est déjà enclenchée : modéliser l’intention avant même qu’elle n’émerge. Non plus seulement vous retenir, mais vous orienter. Non plus répondre à vos besoins, mais les générer.
En 2013, les conditions sont réunies pour le grand verrouillage : infrastructures fermées, économie de l’attention à maturité, explosion du mobile, et montée en puissance de l’intelligence artificielle. Ce qui suit n’est plus un perfectionnement : c’est une inflexion éthique. Les fondateurs de l’Internet libre, grisés par leur succès, vont progressivement se transformer, non plus en innovateurs, mais en gestionnaires d’empire. La pensée critique est écartée. Les principes sont archivés. La croissance devient un absolu.
Et c’est ainsi que les pionniers du lien deviennent les maîtres de la captation.
Et c’est ainsi que les pionniers du lien deviennent les maîtres de la captation. Pas par malveillance, mais par abandon. Parce qu’ils n’ont pas vu — ou pas voulu voir — que la machine qu’ils avaient créée avait cessé de leur obéir.
La compromission des valeurs fondatrices au profit de la domination
Il fallait bien que des visages émergent, que des figures incarnent la trajectoire vertigineuse du numérique : son enthousiasme initial, ses dérapages, ses mutations. Ce sont eux, les édiles de la Silicon Valley, enfants terribles du code et du capital, devenus les chefs spirituels d’un monde sans transcendance. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel, mais aussi Larry Page ou Reid Hoffman : autant d’individualités marquées par une double culture — celle du génie technique et de l’idéologie libertarienne. Dans leurs trajectoires, dans leurs discours, dans leurs choix, on lit une rupture nette : celle du renoncement à l’idéal d’un Internet commun pour embrasser une logique de conquête totale.
Au départ, leur vision du monde repose sur une forme de foi. Une foi dans la technique comme force de progrès, dans l’individu comme moteur du collectif, dans le marché comme instance de régulation. Peter Thiel résume cet imaginaire lorsqu’il affirme que la liberté ne peut exister qu’en dehors de la démocratie. Derrière ce paradoxe provocateur se cache une conception très américaine de l’autonomie : la liberté radicale, la volonté de faire sécession, de bâtir hors du cadre, au nom d’une vérité supérieure — l’innovation.
S’ils investissent dans l’espace, ce n’est pas uniquement pour explorer : c’est pour réinitialiser.
Ce que beaucoup en Europe n’ont jamais totalement saisi, c’est ce fond mythologique qui structure la Silicon Valley : la ruée vers l’Ouest, l’idée d’une terra incognita à conquérir, d’un espace vierge à modeler selon ses propres règles. Ce n’est pas un hasard si l’espace — au sens strict — devient l’horizon de leurs ambitions : SpaceX pour Musk, Blue Origin pour Bezos. “Sky is not the limit” devient une devise réelle, un programme politique. Ils ne veulent pas seulement innover : ils veulent s’arracher au monde. Recommencer ailleurs. S’ils investissent dans l’espace, ce n’est pas uniquement pour explorer : c’est pour réinitialiser.
Mais cette volonté de dépassement finit par contourner une exigence fondamentale : l’éthique. Car tout ne peut pas être soumis à la seule volonté individuelle, surtout lorsque celle-ci est soutenue par des moyens illimités. Et c’est là que réside le renoncement : non dans l’ambition elle-même, mais dans le refus d’en assumer les conséquences humaines, sociales, politiques. Ces dirigeants ont cessé d’ajuster leur action à une boussole morale. Fascinés par l’ampleur de leur pouvoir, ils en ont oublié l’origine : un idéal partagé de progrès collectif.
Prenons Amazon. Partie d’une simple librairie en ligne, l’entreprise de Jeff Bezos est devenue une infrastructure planétaire. Commerce, logistique, hébergement cloud, assistant vocal, données de santé, services publics délégués : Amazon est partout. Chaque semaine, un à deux colis Amazon arrivent dans ma boite à lettre. C’est une prouesse technique et organisationnelle hors norme. Mais à quel prix ? Le traitement des travailleurs, l’obsession de la productivité, l’évitement fiscal, la pression sur les villes, la déshumanisation de la relation commerciale — tout cela signe une rupture. Amazon n’est plus un acteur du progrès, c’est un système qui s’impose par saturation.

Twitter, racheté par Elon Musk en 2022, est l’exemple le plus caricatural — mais pas le moins symptomatique — d’un effondrement éthique. Ce réseau, autrefois fragile agora d’opinions, est devenu un jouet idéologique. Musk, oscillant entre provocateur libertarien, entrepreneur mégalomane et prophète de la disruption, a détruit en quelques mois les mécanismes déjà précaires de régulation et de modération. Derrière l’alibi de la liberté d’expression, c’est un chaos rentable qui s’est installé. Les algorithmes deviennent opaques, la parole haineuse remonte à la surface, les repères explosent. Ce n’est plus une plateforme : c’est un champ de bataille algorithmique, gouverné par l’imprévisible.
Facebook, devenu Meta, représente un cas à part. Là où Amazon fascine et inspire par sa performance logistique et où Google impressionne par ses avancées scientifiques (notamment avec DeepMind), Facebook est devenu une mécanique toxique. Captation de données massives, manipulation électorale, promotion de contenus radicaux, opacité délibérée des systèmes : la plateforme a méthodiquement trahi ses promesses. Son obsession du “temps passé” a conduit à la destruction méthodique du débat public, à la polarisation massive, à l’effondrement de la confiance sociale. Zuckerberg, muré dans son monde virtuel, n’a jamais assumé ces dérives. Meta est devenu le miroir froid d’un monde dysfonctionnel qu’il prétendait connecter.
Google, lui, offre un tableau plus ambivalent. S’il participe au modèle attentionnel et exploite massivement les données, il reste l’un des seuls acteurs à avoir maintenu une forme de ligne intellectuelle. Ses travaux sur l’IA (notamment via DeepMind), son investissement dans la recherche, son refus partiel du sensationnalisme algorithmique, laissent une trace d’intégrité scientifique. Cela ne suffit pas à absoudre, mais cela nuance. Apple, enfin, tient une position à part. Son modèle repose moins sur la captation de l’attention que sur la vente d’un environnement maîtrisé. Oui, l’écosystème est fermé, exclusif, élitiste et surtout premium. Mais la protection de la vie privée est réelle, assumée. Dans ce paysage, Apple reste peut-être la seule grande entreprise technologique à n’avoir jamais misé sur l’addiction comme stratégie de croissance.
Au fond, ce n’est pas tant le pouvoir de ces entreprises qui pose problème, que le fait qu’elles ne reconnaissent plus aucune forme de contre-pouvoir. Leur domination s’est construite sur une idéologie de la performance, qui a fini par remplacer toute forme d’éthique. La régulation est perçue comme un obstacle, la critique comme une attaque, la responsabilité comme une option. Le renoncement ne se manifeste pas par un grand discours, mais par une série de petits gestes : une fermeture, un silence, une fuite en avant. Ils étaient les pionniers d’un monde ouvert. Ils sont devenus les maîtres d’un monde clos.
Ils étaient les pionniers d’un monde ouvert. Ils sont devenus les maîtres d’un monde clos.
Il ne faudrait pas oublier Sam Altman, dernier venu dans cette galerie des prophètes dévoyés, qui incarne à sa manière la transition vers une nouvelle ère : celle des intelligences génératives. Ancien président de Y Combinator, figure respectée de la Valley, Altman fut couronné un temps « meilleur entrepreneur de la Silicon Valley ». Il coche toutes les cases : charisme de conférence TED, croyance affichée dans le progrès exponentiel, discours sur l’avenir de l’humanité sous stéroïdes technologiques. Il est le promoteur acharné d’une IA mainstream qui n’est plus simplement un outil, mais une infrastructure possiblement cognitive. Avec OpenAI, qu’il transforme progressivement en société commerciale adossée à Microsoft (49 % du capital), il impose une nouvelle mythologie : celle du modèle fondationnel, totalisant, incontournable.
Pourtant, rien n’est véritablement inventé. OpenAI a bâti son empire sur un socle conceptuel produit ailleurs : le modèle Transformer, détaillé en 2017 dans la publication fondatrice de Google Attention Is All You Need, sert de base à GPT. L’intuition originale vient de chez Google Brain. OpenAI a affiné, entraîné, industrialisé — mais à partir d’une technologie conçue par d’autres. Derrière la révolution annoncée, il y a donc un recyclage stratégique, un timing parfait, un flair entrepreneurial. Et une forme de captation.
À ses côtés, Ilya Sutskever, cofondateur et directeur scientifique, incarne le génie pur : ex-Google Brain, ancien élève de Geoffrey Hinton, capable de plier les réseaux neuronaux à sa volonté. Visionnaire, mais insaisissable. Il est le reflet exact de cette époque : surdoué, isolé, convaincu d’œuvrer pour un bien supérieur, tout en acceptant que ce bien soit financé, capté, canalisé par une multinationale cotée en bourse. Jusqu’à ce qu’il vacille. En novembre 2023, il participe à l’éviction de Sam Altman — geste rare, presque tragique, signe d’une conscience en surchauffe face aux dérives de l’entreprise qu’il a contribué à créer. OpenAI, qui se voulait à l’origine une organisation non lucrative pour “sauver l’humanité de l’IA”, est aujourd’hui une pièce maîtresse du portefeuille Microsoft. Là encore : idéal au départ, stratégie en définitive.
Il est le promoteur d’une hyper-réalité algorithmique, où le vrai, le faux, l’inutile et l’intense se mélangent au point de neutraliser toute perception claire.
Altman, comme Musk, Bezos ou Zuckerberg, incarne cette ambivalence permanente : entre avant-garde intellectuelle et cynisme tactique, entre messianisme et capitalisme dur. Il ne dissipe pas la confusion générée par ses systèmes, il l’exploite. Il ne guide pas vers la connaissance, il organise la dépendance cognitive. Il est le promoteur d’une hyper-réalité algorithmique, où le vrai, le faux, l’inutile et l’intense se mélangent au point de neutraliser toute perception claire.
Concentration financière et domination du marché
À la fin de l’année 2024, les cinq grandes entreprises technologiques américaines — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) et Meta — ont atteint une concentration financière inédite dans l’histoire du capitalisme. Ensemble, elles représentaient environ 25 % de la capitalisation boursière totale des États-Unis, pour une valeur combinée proche de 15 000 milliards de dollars. Microsoft dominait ce classement avec une capitalisation de 3 260 milliards de dollars, devant Apple et Amazon, confirmant la centralité stratégique de l’industrie numérique dans les équilibres macroéconomiques contemporains.
Mais cette concentration n’est pas uniquement financière. Elle est aussi fonctionnelle. Ces entreprises contrôlent désormais les principaux leviers d’infrastructure, d’information et d’influence. Dans le domaine du cloud, trois acteurs — Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud — se partagent plus de 70 % du marché mondial, qui a généré à lui seul 90 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre 2024. En matière de systèmes d’exploitation mobiles, Apple et Google totalisent à eux deux près de 99 % du marché mondial (iOS et Android). Du côté des messageries, des moteurs de recherche, des services de cartographie, de la publicité programmatique ou encore des objets connectés, la situation est identique : oligopoles consolidés, barrières à l’entrée infranchissables, architecture technique verrouillée.
Cette domination horizontale s’est progressivement accompagnée d’une extension verticale vers des secteurs non technologiques. Amazon est désormais un acteur incontournable du domaine logistique, de la distribution alimentaire (Whole Foods) et de la santé (One Medical, Amazon Care). Google investit dans les biotechnologies et les neurosciences via Calico, Verily ou DeepMind Health. Microsoft contrôle de facto le secteur de l’IA générative par l’intermédiaire de sa prise de participation stratégique dans OpenAI (49 %), devenant ainsi copropriétaire de l’infrastructure cognitive mondiale. Elon Musk, de son côté, a unifié ses ambitions industrielles sous une logique transhumaniste : espace (SpaceX), transport (Tesla), intelligence artificielle (xAI), interface neuronale (Neuralink), communication satellitaire (Starlink), plateformes sociales (X). Tous ont franchi un seuil : celui où l’innovation n’est plus un produit, mais une stratégie de puissance globale.
Ce sont désormais des structures totales, déployées sur tous les plans : économique, technologique, cognitif, politique. Ce capitalisme tardif ne se contente plus de produire des biens — il fabrique des croyances, des récits, des normes. Il agit sur la superstructure au sens marxiste : cette couche idéologique qui, censée reposer sur les fondations économiques, en vient ici à les devancer, les redessiner, les absorber. Leur trajectoire illustre un basculement du capitalisme numérique vers une logique démiurgique, où les PDG ne se contentent plus d’opérer des entreprises, mais cherchent à reconfigurer les structures mêmes du monde. Ils affirment une autonomie radicale par rapport aux institutions, aux lois, voire à la réalité elle-même. L’espace en est l’emblème ultime : “Sky is not the limit” n’est pas un slogan marketing, c’est une déclaration géopolitique.
Mais cette surpuissance n’est pas neutre. Elle s’accompagne d’une dégradation rapide de l’ancrage éthique et du contrat social implicite entre ces firmes et la société. En amont de l’élection présidentielle américaine de 2025 — marquée par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche — plusieurs de ces entreprises ont méthodiquement vidé leurs politiques internes de toute ambition sociétale. Meta et Amazon, notamment, ont suspendu ou supprimé leurs programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), en anticipant un alignement avec les orientations politiques de la nouvelle administration fédérale. Ces gestes ne sont pas anecdotiques : ils marquent un renoncement explicite aux principes de responsabilité éthique et d’engagement social dont ces programmes constituaient, à tort ou à raison, la vitrine. L’innovation ne s’accompagne plus d’un récit de progrès partagé. Elle devient pure optimisation.
À travers eux, c’est une certaine forme de subjectivité technologique qui se dévoile : celle du CEO-empire, à la fois investisseur, législateur, architecte et évangéliste.
La posture publique de leurs dirigeants accompagne cette inflexion. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk ont tous trois opéré un retournement de leur image : d’icônes du progrès et de l’entrepreneuriat éclairé, ils sont devenus les figures d’une puissance brutale, cynique, parfois revancharde. Musk joue la provocation algorithmique, Zuckerberg a déserté l’utopie sociale du métavers pour plonger dans l’hyper-optimisation publicitaire et l’IA générative, et Bezos investit dans l’immortalité biologique et la colonisation orbitale. À travers eux, c’est une certaine forme de subjectivité technologique qui se dévoile : celle du CEO-empire, à la fois investisseur, législateur, architecte et évangéliste. Ils ne répondent plus à aucune autorité. Leur autorité c’est leur stack.
Il ne faut pas s’y tromper : ces entreprises, malgré leurs dérives, restent des structures fascinantes, d’un point de vue organisationnel, technologique, logistique. Amazon incarne une forme d’optimisation intégrale de la chaîne de valeur. Twitter (devenu X) s’impose comme un laboratoire sociopolitique en temps réel. Google, par ses travaux sur l’intelligence artificielle, continue d’alimenter la recherche scientifique mondiale à un niveau sans équivalent. Et Apple, figure à part dans ce panthéon technocapitaliste, exerce une fascination qui échappe à la seule rationalité fonctionnelle. Je ne m’en exclue pas : je suis moi-même entièrement équipé, et mon Mac est devenu le prolongement immédiat de mon système nerveux. Il y a, dans cette dépendance assumée, quelque chose de l’ordre du pacte : lucidement contracté, mais difficile à rompre.
Rien n’illustre mieux le paradoxe contemporain : alors même que nous dénonçons leur emprise, nous épousons leurs écosystèmes. Leur puissance n’est plus seulement industrielle ou financière : elle est cognitive, affective, symbolique. Elles ne s’imposent pas par la contrainte, mais par la forme même de nos usages. Elles redessinent les gestes, reconfigurent les attentes, reformulent le réel. Ce ne sont pas des outils : ce sont des structures d’habitude. Et cette grammaire imposée du quotidien devient leur levier géopolitique majeur.
Ces entreprises ne colonisent pas seulement des marchés. Elles redessinent les modalités du réel.
Ce qui avait commencé comme une aventure entrepreneuriale, portée par des figures marginales, animées par des idéaux de liberté, d’ouverture et de progrès partagé, s’est progressivement métamorphosé en une forme d’empire privé aux ambitions planétaires. Les fondateurs du web ouvert sont devenus les gestionnaires de systèmes clos. Les promoteurs de l’émancipation individuelle sont devenus les architectes de la dépendance cognitive. Mais cette mutation ne s’arrête pas à la seule sphère du marché. Ce pouvoir, autrefois purement économique et culturel, glisse insensiblement vers la sphère politique, et commence à redéfinir la souveraineté elle-même.
Derrière les plateformes, ce sont les États qui apprennent, observent, copient, instrumentalisent. L’outil technologique, initialement neutre, est reconfiguré par les régimes qui s’en emparent. Et l’on assiste à un phénomène inédit dans l’histoire moderne : la constitution progressive de structures techno-étatiques, dans lesquelles la technologie ne sert plus seulement à administrer ou à produire, mais à orienter les comportements, à normaliser les consciences, à modéliser le social. Ce n’est plus la loi qui précède la norme : c’est l’algorithme. La promesse d’un espace numérique libérateur s’est refermée en architecture de contrôle.
Ce glissement n’est pas une fatalité. Il est le produit d’un paradoxe anthropologique plus large : l’homme moderne est capable de produire des systèmes d’une puissance technique inégalée, mais demeure structurellement incapable d’en penser les usages dans un cadre éthique stable et universel. À mesure que la puissance s’accroît, la capacité à la contenir semble se dissoudre. Ce n’est pas tant l’outil qui est mauvais, que notre fragilité face à lui — notre fascination, notre paresse, notre propension à déléguer les choix les plus essentiels aux systèmes les plus opaques.
Ce n’est pas tant l’outil qui est mauvais, que notre fragilité face à lui.
C’est ainsi que les puissances traditionnelles, porteuses d’histoires philosophiques, scientifiques et spirituelles complexes, se retrouvent aujourd’hui confrontées à une même tension fondamentale : comment articuler leur héritage intellectuel avec une modernité numérique qui semble hors de contrôle ? Comment préserver l’idéal humain quand la technique tend à l’absorber, le dériver, l’instrumentaliser ?
Les cas des États-Unis, de la Chine, de l’Inde et de la Russie révèlent cette tension entre grandeur intellectuelle et fragilité morale, entre savoirs anciens et usages dérégulés, entre puissance et responsabilité.
Des empires de pensée aux machines de gouvernement : quatre puissances face à leur dérive numérique
Chine
La Chine fut l’un des berceaux de la pensée humaine. Confucius, Laozi, Zhuangzi : autant de figures dont les œuvres ont organisé pendant des siècles un rapport au monde fondé sur l’équilibre entre l’individu et le collectif, entre le savoir et la retenue, entre la parole et le silence. Cette civilisation a offert au monde la boussole, le papier, l’imprimerie à caractères mobiles, la médecine intégrative. Elle a pensé l’ordre sans dogme, la hiérarchie sans brutalité, la durée sans fixité. Longtemps, elle a incarné une sagesse politique fondée sur la modulation, la gradation, la continuité.
Mais aujourd’hui, cet héritage entre en dissonance avec une modernité technologique marquée par la vitesse, la mesure, l’automatisation. Depuis une décennie, la Chine a déployé ce qui constitue sans doute le système de surveillance de population civile le plus avancé jamais conçu. Le réseau Skynet, constitué de plus de 500 millions de caméras de haute définition réparties sur l’ensemble du territoire, permet une identification faciale quasi instantanée en milieu urbain. Ces dispositifs sont couplés à des bases de données centralisées, qui croisent les identités biométriques, les historiques de navigation, les géolocalisations, les enregistrements vocaux, les réseaux sociaux, les comportements d’achat.
Le crédit social, en place depuis 2014 à titre expérimental puis progressivement généralisé, constitue l’instrument normatif central de ce dispositif. Il ne s’agit pas seulement de punir : il s’agit de classer, de recommander, d’interdire, d’accorder — en temps réel. Un individu noté “faible” pourra se voir refuser l’accès à certains trains à grande vitesse, à des prêts bancaires, à des emplois publics. Des comportements aussi divers que fumer dans un train, traverser au feu rouge ou publier des propos critiques à l’égard du Parti peuvent déclencher une dégradation algorithmique du score. L’idéal confucéen d’un ordre fondé sur l’exemplarité est ici absorbé par une normativité automatisée, où la réputation devient une variable computationnelle.
L’idéal confucéen d’un ordre fondé sur l’exemplarité est ici absorbé par une normativité automatisée, où la réputation devient une variable computationnelle.
La technologie ne contrôle pas seulement les actes : elle anticipe. Des programmes pilotes d’IA prédictive sont déployés dans certaines provinces pour identifier les individus à “haut risque de déviance”. Les critères sont flous, évolutifs, souvent opaques. Ce n’est plus uniquement une surveillance rétrospective : c’est une préemption sociale. L’algorithme précède l’événement. Il détecte des intentions supposées. Il classe avant que l’acte n’ait eu lieu — comme dans Minority Report, où des êtres semi-conscients, les PreCogs, détectaient les crimes avant qu’ils ne soient commis. À ceci près que l’oracle, aujourd’hui, est froid, statistique et sans appel.
Dans cette architecture, la parole humaine — critique, ambiguë, faillible — tend à être remplacée par des modèles de comportement. Le langage n’est plus médiateur de sens, il devient signal. Le politique se déplace du forum vers le protocole. Le débat se réduit à un paramétrage. Ce qui se joue ici n’est pas une dérive isolée, mais une réorientation systémique de la gouvernance : une fusion entre ingénierie sociale, capitalisme de données et centralisation autoritaire. Ce n’est pas une dystopie : c’est un système en place, fonctionnel, assumé. Il est fondé sur un pacte implicite entre hyper-sécurité et renoncement à certaines formes de liberté intérieure.
L’écart entre la tradition intellectuelle chinoise — celle de la retenue, de la lenteur, du respect du vide — et l’actuelle organisation numérique de la vie civile est saisissant. Là où la sagesse ancienne valorisait le discernement progressif, la Chine contemporaine tend à substituer à l’interprétation la détection, à la justice la notation, à la délibération la prédiction. L’ordre est maintenu. Mais à quel prix ? Et selon quelle finalité ?
Inde
L’Inde fut l’un des pôles les plus féconds de la pensée humaine. Terre du zéro, des mathématiques abstraites, de la logique jaïniste, de la non-dualité (advaita), mais aussi de la tolérance religieuse, de l’hétérogénéité linguistique, de la dialectique ouverte. La pensée indienne, depuis les Védas jusqu’aux textes de Shankara, n’a cessé de faire coexister les contraires, d’explorer les limites du langage, d’intégrer les oppositions au sein d’un système fluide — jamais figé, jamais totalisant. Elle portait en elle une idée de la paix non pas naïve, mais active : une paix du discernement, de l’équilibre, de la reconnaissance de l’Autre.
Mais cette tradition se trouve aujourd’hui confrontée à une modernité technologique qui bouscule ses fondements philosophiques. Depuis 2015, avec le lancement du programme Digital India, le pays a connu une numérisation accélérée de ses structures : identité biométrique centralisée (Aadhaar), connectivité de masse, généralisation des paiements numériques, intégration algorithmique de l’administration. Ce basculement n’a pas été neutre. Il a exposé un espace démocratique immense à une volatilité informationnelle sans précédent.
Les plateformes comme WhatsApp, Facebook, YouTube sont devenues les vecteurs d’une désinformation industrielle, mobilisée à des fins politiques, communautaires ou nationalistes. Lors des élections générales, des campagnes coordonnées ont manipulé des récits via des groupes fermés, relayant parfois des propos haineux, voire des appels à la violence. Des deepfakes, des vidéos trafiquées, des slogans viralisés ont saturé le débat public, court-circuitant les structures de vérification et d’analyse. Ce n’est plus la parole qui convainc, mais l’image qui frappe.
Ce n’est plus la parole qui convainc, mais l’image qui frappe.
Ce climat d’hyper-réactivité algorithmique s’est trouvé encore aggravé par la montée d’un populisme numérique porté par le pouvoir exécutif lui-même. Le Premier ministre Narendra Modi, fort de centaines de millions d’abonnés sur les réseaux, gouverne aussi par présence, par saturation, par récits performés. Il ne s’agit plus de convaincre — il s’agit de préempter le réel, de rendre impossible l’émergence de récits alternatifs. Dans ce contexte, les valeurs historiques de pluralité, de modération et de cohabitation s’effritent. L’Inde, jadis laboratoire de l’hétérogène, glisse vers l’uniformisation émotionnelle.
C’est dans ce climat que s’inscrit le conflit frontalier de mai 2025 avec le Pakistan. Une escalade de violence, apparemment circonscrite, mais hautement symbolique : drones kamikazes SkyStriker, missiles de précision BrahMos, frappes ciblées sur des infrastructures pakistanaises, puis riposte par drones turcs côté Islamabad. Le tout dans un ballet algorithmique où les décisions d’attaque et d’interception sont partiellement automatisées, assistées par l’IA, connectées à des systèmes de détection prédictive. Le S-400 russe, activé côté indien, les drones tactiques côté pakistanais — autant de pièces d’une guerre où le facteur humain tend à se réduire à des autorisations protocolaires.
La question n’est pas ici militaire. Elle est anthropologique. Une culture forgée sur la lenteur de la pensée, sur la profondeur du discernement, sur l’attention au réel, est en train de déléguer à des machines — souvent conçues ailleurs, souvent formées sur des données biaisées — la charge du discernement stratégique. L’Inde reste debout : vibrante, inventive, puissante. Mais le socle sur lequel elle s’est élevée — celui de la nuance, du débat, du relatif — vacille. Il ne s’agit pas de trahison. Il s’agit d’un glissement. Et il est décisif.
Russie
La Russie a longtemps été un empire de l’esprit. Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, mais aussi Soloviev, Berdiaev, Grossman : des écrivains pour qui la littérature n’était pas un divertissement mais une manière d’interroger l’âme, le mal, le destin, la liberté. Cette tradition n’était pas décorative, elle structurait une pensée du tragique, une culture de la profondeur, un rapport lucide à la condition humaine. À cela s’ajoutait une tradition scientifique d’avant-garde : Lobatchevski inventant la géométrie non-euclidienne, Tsiolkovski posant les bases de l’astronautique, Sakharov explorant la fusion nucléaire tout en luttant pour les droits de l’homme. La Russie a produit à la fois la dissuasion thermonucléaire et la pensée de ses limites. Ce pays a su articuler conquête et questionnement.
Aujourd’hui, cette puissance réflexive semble étouffée sous une stratégie techno-militaire totalisante. Le conflit en Ukraine n’est pas seulement une guerre territoriale, c’est une guerre d’information, de perception, de narratifs. La Russie y déploie une combinaison inédite de hacking systémique, de désinformation algorithmique, de propagande distribuée. Des usines à trolls aux chaînes Telegram, des réseaux d’influence jusqu’aux deepfakes, tout est mobilisé pour saturer l’espace cognitif de signaux contradictoires. Le chaos devient une méthode. La vérité, une variable contextuelle.
Mais ce qui frappe, c’est l’ampleur structurelle du dispositif. La stratégie informationnelle russe n’est pas un supplément, c’est une doctrine. Depuis la “guerre de la conscience” formalisée dès les années 1990, jusqu’aux cyberattaques coordonnées sur des systèmes énergétiques, administratifs ou électoraux en Europe, tout concourt à une redéfinition de la souveraineté par la maîtrise des flux. L’entreprise Vulkan, révélée en 2023, n’est qu’un maillon : derrière, il y a une vision du numérique comme champ de bataille permanent, invisible, sans frontières, sans cesse reconfiguré.
La stratégie informationnelle russe n’est pas un supplément, c’est une doctrine.
Cette approche inclut désormais l’intelligence artificielle : modèles génératifs pour produire de fausses preuves, outils de détection comportementale, logiciels de reconnaissance faciale dans les zones occupées. L’espace numérique n’est plus un espace de médiation. Il devient un territoire occupé — codé, verrouillé, redirigé. La conquête spatiale elle-même, autrefois promesse d’universel, est réinscrite dans une logique de dissuasion et de rivalité technologique. Ce qui fut rêvé par les cosmistes russes comme dépassement de la finitude humaine devient aujourd’hui un segment de stratégie militaire orbitale.
L’écart est vertigineux. Entre la grandeur intellectuelle d’une civilisation qui interrogeait la faute, la rédemption, le sens du sacrifice — et un système qui instrumentalise la technique pour dominer l’opinion, désorienter la conscience, fragiliser les institutions. Entre l’exploration de la complexité humaine et la réduction de l’humain à un nœud d’informations à exploiter.
Il ne s’agit pas ici de commenter une actualité. Il s’agit d’interroger une bascule anthropologique : lorsque la science cesse d’être critique, lorsqu’elle cesse d’ouvrir et se referme sur elle-même, elle ne produit pas la lumière — elle organise l’opacité. Et encore une fois, ce ne sont pas les machines qui décident. Ce sont des hommes. Des hommes qui programment, orientent, valident. Des hommes qui, au lieu de prolonger la pensée, préfèrent la remplacer.
Etats-Unis
Les États-Unis furent les architectes d’un ordre numérique mondial. De la constitution fédérale à la révolution cybernétique, de l’esprit des Lumières pragmatiques à l’invention de l’informatique moderne, de la défense des droits civiques à la conquête spatiale, ce pays a construit sa légitimité sur l’alliance du progrès technique et de l’émancipation individuelle. Il est le creuset de la pensée opérationnelle, du design industriel, de la puissance symbolique du code.
Mais cette promesse d’un espace libre et universel s’est progressivement transformée en une architecture d’influence. Dès les années 1990, comme le théorisait Alvin Toffler dans War and Anti-War, la technologie devient une arme intégrée dans la stratégie militaire : durant la guerre du Golfe, la supériorité technologique américaine n’est pas un appui — elle est la guerre elle-même. Ce paradigme s’est depuis généralisé.
Aujourd’hui, les États-Unis ne contrôlent pas seulement les infrastructures de l’Internet. Ils en déterminent les règles, les normes, les langages. L’espace numérique est un territoire — et ils en sont les premiers souverains. Cette hégémonie technologique s’est muée, à l’intérieur même du pays, en une fragmentation sociale et cognitive sans précédent. L’économie de l’attention — dont les grandes plateformes sont à la fois les architectes et les bénéficiaires — a réorganisé la vie publique autour de la captation émotionnelle.
La logique de l’engagement a supplanté celle du débat. Les algorithmes de recommandation, conçus pour maximiser les interactions, ont favorisé la polarisation, l’indignation, la simplification. Les États-Unis sont devenus un théâtre de l’hyper-réaction, un espace saturé où chaque prise de parole est immédiatement absorbée dans un flux contradictoire de réponses, de détournements, de controverses programmées. La société de l’innovation se retrouve ainsi en tension avec elle-même. La technologie qui devait relier isole. La parole qui devait libérer devient une transaction. L’information n’informe plus : elle segmente. Et l’individu, exalté comme sujet souverain, se perd dans l’architecture de ses propres traces.
La technologie qui devait relier isole. La parole qui devait libérer devient une transaction.
Parallèlement, la machine de surveillance d’État — révélée notamment à travers les programmes PRISM ou XKeyscore — déploie une logique de suspicion systémique, justifiée par la sécurité nationale mais incompatible avec les principes fondateurs de transparence et de consentement. L’alliance entre le complexe militaire, le secteur privé technologique et les agences de renseignement a généré une forme d’hybridation institutionnelle où la frontière entre protection et contrôle devient floue. Ce n’est pas une trahison. C’est une mutation.
Les États-Unis n’ont pas cessé d’innover. Mais ils ont oublié que l’innovation sans horizon moral n’est qu’une optimisation de la puissance. Et cette puissance — militaire, cognitive, algorithmique — n’est plus exercée dans un vide. Elle agit. Elle formate. Elle remplace. Ce pays, qui fit naître Internet dans des laboratoires universitaires, en fait aujourd’hui un outil d’affrontement interne. Et ce monde qu’il avait rêvé d’unir, il contribue à le fragmenter.
Le paradoxe technologique des grandes puissances
À l’échelle des grandes civilisations, la technologie n’est pas un outil : elle est un révélateur. Elle révèle les structures mentales, les peurs fondamentales, les hiérarchies implicites, les visions de l’homme que chaque culture porte en elle. Ce n’est pas l’innovation qui est universelle — c’est sa mise en tension avec un fond symbolique. La Chine, l’Inde, la Russie, les États-Unis : tous ont accédé à une maîtrise technique avancée, parfois vertigineuse. Mais aucun n’a su, jusqu’ici, encadrer cette maîtrise par une éthique à sa hauteur.
L’excellence technologique ne protège de rien. Elle peut coexister avec le déni, l’instrumentalisation, l’aveuglement. Elle peut même les amplifier. Partout, la même fracture : entre des traditions intellectuelles d’une rare élévation — philosophies de la coexistence, de la parole, du discernement — et des systèmes numériques qui automatisent, classent, prédisent, isolent. La pensée est lente, la machine rapide. La parole est incertaine, l’algorithme catégorique. Le tragique, c’est que l’homme, face à cette asymétrie, abdique souvent volontairement.
Et ce ne sont pas les civilisations qui échouent. Ce sont les hommes — majoritairement des hommes — qui les trahissent. Par indifférence, par précipitation, par paresse morale. Ce ne sont pas les machines qui oppressent. Ce sont les systèmes qu’ils codent, qu’ils imposent, qu’ils délèguent à d’autres. Ce constat nous conduit à un seuil. Car derrière les structures de pouvoir et les récits géopolitiques, une mutation plus souterraine, plus intime, plus insidieuse est en cours. Elle ne concerne plus l’État, mais le quotidien. Plus les nations, mais les corps. Plus les doctrines, mais la solitude.
Absurdistan numérique
Il fallait un terrain d’expérimentation. Ce fut notre vie. Pas celle des États. La nôtre. Individuelle. Sensible. Concrète. Ce que la technologie a d’abord modifié, ce ne sont pas les lois, mais les gestes. Pas les Constitutions, mais les pupilles. Pas la souveraineté, mais la façon dont on regarde, marche, attend, aime, désire, touche, ou évite de toucher.
C’est ici que la dérive devient absurde. Non plus par excès de puissance, mais par vacuité. Nous avons tout connecté, et nous ne nous regardons plus. Nous avons tout automatisé, et plus rien n’est spontané. Nous avons tout numérisé, et nous n’écrivons plus rien. Le numérique a remplacé le monde, mais il ne le contient pas.
Le numérique a remplacé le monde, mais il ne le contient pas.
L’absurdistan numérique, ce n’est pas un pays : c’est une ambiance. Une fatigue. Une tension permanente entre la promesse de lien et l’expérience de l’isolement. Un vertige de présence sans présence. D’un monde où chacun est joignable, mais personne n’est là. La technique, après avoir servi le pouvoir, est devenue le théâtre d’un autre effondrement : celui du lien humain.
De l’hyperconnexion à l’humain-zombie
Il suffit de monter dans une rame de métro. Tout le monde est là — et personne n’est là. Une foule silencieuse, les yeux baissés, absorbés par des rectangles lumineux. Personne ne se regarde. Personne ne se parle. Le simple fait de croiser un regard est devenu gênant, suspect, presque transgressif. Les corps sont là, les âmes ailleurs. Dans la rue, au café, au travail, même dans l’intimité : les écrans se sont interposés entre les gestes, entre les mots, entre les affects. Ce n’est plus de l’usage : c’est une présence.

Je ne parle pas de loin. J’écris ce texte sur un terminal bardé d’extensions. Mon téléphone m’accompagne comme un organe greffé. Mon quotidien est optimisé par des assistants, des filtres, des automatisations. Je suis un être technique — et c’est depuis cette réalité que je pense la dérive. L’enjeu n’est pas de fuir, mais de discerner.
La connexion permanente, autrefois promesse d’ouverture, est devenue un écosystème de fuite. Fuite du contact direct. Fuite du risque relationnel. Fuite de la maladresse. On se parle en messagerie instantanée, on se séduit par application. Même la solitude est médiée. L’univers numérique s’est emparé de l’espace de l’intime, et ce qu’il y installe, ce n’est pas l’érotisme — c’est la gestion. Gestion des désirs, des correspondances, des fantasmes, des refus. L’humain n’explore plus. Il sélectionne.
Au travail, c’est le même théâtre du vide. Les visioconférences se succèdent, standardisées, enregistrées, neutralisées. Le non-dit y est permanent, la parole codée, la spontanéité effacée par la peur d’offenser. Tout est protocole. Tout est liturgie corporatiste. Et ce que l’on ne peut plus se dire, l’IA le reformule, le résume, le transmet — plus proprement. Plus efficacement. Les comptes rendus sont générés automatiquement. On assiste, passifs, à la transcription de ce que l’on n’a pas osé dire. Le sens est caviardé par avance, absorbé dans une boucle stérile d’optimisation.
On assiste, passifs, à la transcription de ce que l’on n’a pas osé dire.
Le paradoxe est total : jamais nous n’avons été aussi reliés, et jamais nous ne nous sommes sentis aussi seuls. L’hyperconnexion contemporaine atteint son point de retournement : elle ne relie plus, elle isole. Elle ne connecte pas : elle désincarne. Elle transforme l’échange en flux, la présence en avatar, le dialogue en ping technique. Elle ne fait pas silence. Elle fait vacarme — mais sans voix.
Et dans ce vacarme, quelque chose glisse. Lentement. Insidieusement.
Nous ne sommes plus exactement humains. Du moins plus comme avant. Nous avons franchi un seuil, sans l’acter. Ce que nous appelions jadis “libre arbitre” est devenu friction. Ce que nous appelions “choix” est devenu surcharge. Et ce que nous appelions “pensée” — lente, non productive, tâtonnante — est devenu un coût. Alors, nous déléguons. À des assistants. À des agents autonomes. À des routines intelligentes. Nous laissons les machines gérer notre agenda, nos trajets, nos émotions, nos formulations. Elles prédisent nos mots. Corrigent nos fautes. Proposent des réponses avant même que nous ayons formulé une question. Elles nous connaissent. Nous les laissons faire.
Ainsi naît le techno-zombie : créature post-futuriste, mi-vivante mi-algorithmique, anesthésiée par le confort, privée d’initiative, dépendante de ses extensions numériques.
Ainsi naît le techno-zombie : créature post-futuriste, mi-vivante mi-algorithmique, anesthésiée par le confort, privée d’initiative, dépendante de ses extensions numériques. Ni cyborg conquérant, ni humain libre : un automate biologique à l’interface du calcul. Il ne ressent pas moins — il ressent sous contrôle. Il n’agit pas moins — il agit dans les limites fixées par l’assistance intelligente. Il n’a pas renoncé à la volonté : il en a oublié le goût.
Cette transition est-elle déjà engagée ? Sommes-nous en train de devenir ces êtres ambigus, à la fois utilisateurs et utilisés, présents et absents, décidés et dirigés ? Et surtout : jusqu’où sommes-nous prêts à glisser, tant que cela reste fluide, tant que cela ne dérange pas, tant que cela “fonctionne” ?
La vraie question n’est pas celle du progrès. C’est celle du seuil.
L’humain post-futuriste
Il fut un temps où l’humain doutait, trébuchait, hésitait. C’était ce qui le rendait pensant. Il se trompait — mais il décidait. Il se fatiguait — mais il voulait. Il se contredisait — mais il parlait. Il vivait dans l’ambiguïté, l’imperfection, le ralentissement, la friction : autant de symptômes de la conscience. Aujourd’hui, ces symptômes ont disparu. Tout va vite, tout est fluide, tout est calibré. Et personne ne sait plus très bien s’il vit encore vraiment.
L’homme post-futuriste n’est pas un héros augmenté. Il n’est pas l’hybride cybernétique des fantasmes transhumanistes. Il n’a rien de Nietzsche, ni de Cronenberg. Il n’est ni surhomme, ni mutant. Il est beaucoup plus banal, beaucoup plus tragique : il est un être assisté, nourri de prompts, guidé par des algorithmes de suggestion, libéré de toute nécessité de discernement. Il glisse. Il swipe. Il acquiesce. Il délègue sa pensée à des moteurs, ses désirs à des plateformes, ses intentions à des patterns comportementaux.
Il est devenu une créature sans projet, sans mémoire de la lenteur, sans résistance intérieure. Il vit dans une interface. Il respire dans des notifications. Il n’agit plus : il réagit. Il ne décide plus : il clique. Il ne sait même plus ce que signifie vouloir — sinon éviter le désagrément, l’effort, le silence.
Sa vie est gérée par des agents intelligents. Il ne sait plus lire une carte, car Waze le guide. Il n’organise plus ses idées, car GPT les rédige. Il ne cherche plus, il scrolle. Il ne contemple plus, il enchaîne. Son imaginaire est externalisé. Son désir, indexé. Son langage, prédictif. Il n’est pas abruti — il est neutralisé.
Il ne souffre pas. Il ne se révolte pas. Il est satisfait. Et c’est là que réside le nœud du problème. Ce n’est pas la violence qui nous transforme — c’est le confort.
Ce n’est pas la violence qui nous transforme — c’est le confort.
On a longtemps pensé que l’extinction de la liberté viendrait sous la forme d’une tyrannie. Nous étions dans Orwell. Mais elle est venue sous la forme d’une assistance douce, d’un renoncement général à la charge du libre arbitre. Nous sommes dans Huxley. Et même au-delà : dans une fusion étrange entre la servitude volontaire et l’automatisation invisible de toute friction.
Nous n’avons pas perdu notre humanité. Nous l’avons externalisée. Elle est dans le cloud, dans les serveurs d’OpenAI, dans les modèles génératifs, dans les prévisions météo émotionnelles. Elle ne nous appartient plus. Et l’angoisse moderne n’est plus de mourir — c’est de rater une mise à jour.
Le techno-zombie n’a pas de conscience de sa zombification. Il n’est pas enchaîné. Il est entouré. Il n’est pas contraint. Il est occupé. Il ne marche plus. Il est porté. Chaque décision qu’il ne prend pas est un soulagement. Chaque responsabilité déléguée, une bénédiction. Et c’est cela, précisément, la forme contemporaine du néant : un confort continu, sans aspérité, sans réveil.
La philosophie n’a pas vraiment prévu cette créature. Ni Sartre, ni Heidegger, ni Arendt. Car elle ne doute pas, ne s’engage pas, ne juge pas. Elle ne pose plus la question du bien et du mal. Elle pose celle du plus rapide, du plus pratique, du plus optimisé. Tocqueville, peut-être, lorsqu’il évoquait — dans de lumineuses pages de De la démocratie en Amérique — ce « pouvoir immense et tutélaire, absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », qui veille à nos besoins, facilite nos plaisirs, et aspire à « ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ». Mais il n’aurait jamais imaginé que cette puissance molle prendrait un jour la forme d’un réseau neuronal profond, d’un assistant vocal, d’un système de recommandation. Ce n’est plus l’État qui infantilise : c’est l’interface. Ce n’est plus le despotisme éclairé qui étouffe l’individu : c’est la surcouche logicielle. Ce zombie de la volonté est désormais un techno-zombie — programmable, serviable, satisfait.
La transition vers cet état zombie est déjà entamée. Ce n’est pas une hypothèse. C’est un fait observable. Et le plus ironique, c’est que nous ne sommes même pas sûrs de vouloir en sortir. Car y rester — c’est doux, c’est simple, c’est efficient. Il reste peut-être un sursaut possible. Non pas dans les systèmes. Mais dans les corps. Dans ce qu’il nous reste de frictions, de maladresse, de résistance. Une faille, minuscule, entre l’optimisé et l’imprévisible. Et c’est là, peut-être, que tout pourrait recommencer.
Mais alors une question se pose, brutale, définitive, punk :
À quel moment cessons-nous d’être vivants, lorsqu’il ne reste plus de frictions, plus de luttes, plus d’exigence — mais seulement la continuation algorithmique de nos automatismes ?
Sommes-nous encore là ? Ou déjà ailleurs ?
Sortir de l’absurdité : une révolte humaniste punk
Ce ne sont pas les machines qu’il faut accuser. Ce sont les hommes. L’abandon ne vient jamais des objets. Il vient de ceux qui les fabriquent, les installent, les légitiment, les désirent — puis s’y soumettent. L’homme, avec un grand H, a toujours voulu alléger le fardeau de vivre. Moins d’effort. Moins de hasard. Moins de risque. Moins de douleur. Il a cherché des outils pour s’éviter lui-même. Et chaque fois qu’il les a trouvés, il est allé trop loin. Pas par malveillance. Par lassitude. Par refus d’avoir à décider. À choisir. À perdre. Il voulait vivre mieux — il a préféré vivre moins.
Il n’y a rien de neuf. L’histoire de la technologie est celle d’un glissement. On invente pour s’aider. On finit par se faire remplacer. L’homme a toujours voulu un outil pour l’épauler, jamais un système pour penser à sa place. Et pourtant, il n’a jamais su dire non.

Il ne sait pas s’arrêter. Parce qu’il ne sait pas créer. Créer la vie, pas une ligne de code. Créer de ses mains, pas une API. Créer un monde, pas un dispositif. Il ne sait pas enfanter. Il invente donc des armes. Des systèmes. Des appareils. Pour combler le vide — celui de ne pas pouvoir faire naître. L’homme crée ce qu’il ne peut porter. Et il se perd dans sa création. Encore une fois. Toujours.
La technologie n’est qu’un prolongement de cette incapacité à se tenir seul dans le réel. Elle n’a pas trahi. Elle a obéi. Elle a fait ce qu’on lui a demandé : faciliter, accélérer, optimiser, prédire, désencombrer. Elle a tout bien fait. Trop bien. Et c’est là que l’échec moral est total : les machines ne pensent pas. Mais nous avons cessé de penser dès l’instant où elles ont commencé à exécuter.
Alors que faire ? S’effondrer, proprement, en silence, escortés par nos assistants ? Ou se relever, brutaux, conscients, frontaux ?
La technologie n’est qu’un prolongement de cette incapacité à se tenir seul dans le réel.
Il faut une révolte. Une vraie. Punk, viscérale, physique, déterminée. Pas une tribune, pas un podcast, pas une pétition. Une insurrection humaine contre l’optimisation généralisée. Il faut reprendre la main. Réappropriation violente, consciente et non négociable des outils, des flux, des réseaux. Retour à la bidouille, au fil dénudé, au code visible. Hacker, détourner, désosser. Débrancher. Casser les interfaces lisses. Faire bugger les systèmes. Ralentir la machine. Réinjecter du bruit.
Il faut désapprendre à obéir. Réapprendre à rater. À douter. À ne pas savoir. L’humanité ne renaîtra pas dans une super-IA alignée. Elle renaîtra dans le malaise, dans la faille, dans l’angle mort. Dans la brèche laissée par ceux qui refusent de rendre leur vie prévisible. Et il faut aussi penser. Réinventer une éthique. Pas une charte molle de laboratoire. Une techno-éthique radicale, crue, désillusionnée, incarnée. Quelque part entre Hans Jonas et un squat anarchiste. Une éthique de la limitation, du refus, de l’intention consciente.
Il faut rendre la technique inoffensive. La soumettre. La dominer. Pas pour la gloire. Pas pour le pouvoir. Mais pour le soin. Pour le réel. Pour ce que l’on peut toucher. Sentir. Pour le poids des corps. Pour la fatigue. Pour l’imprévu. Pour l’odeur des autres. Pour le regard qu’on soutient. Pour le silence qu’on partage. Pour la main qu’on tend — pas celle qui swipe, pas celle qui clique — mais celle qui se tend, physiquement, dans un monde qui recommence à avoir de la résistance.
Ce ne sera pas propre. Ce ne sera pas sobre. Mais ce sera vivant.
Parce qu’il est temps, enfin, de désobéir à l’absurde. De dire non. Non à la machine qui promet de tout faire à notre place. Non à l’homme qui se rêve en dieu parce qu’il est incapable d’être humain.
Il faut débrancher.
Et respirer.
Conclusion
Il est devenu trop facile de désigner la technologie comme responsable. Trop commode de faire d’elle un bouc émissaire. Les algorithmes, l’IA, les plateformes, les écrans : tout cela n’est que le miroir fidèle de ce que nous avons voulu fuir. Ce n’est pas la machine qui pense à notre place — c’est nous qui avons cessé de vouloir penser. Pas par incapacité. Par confort.
Ce que nous vivons n’est pas une défaite imposée. C’est un renoncement accepté. Une lente capitulation, méthodique, quotidienne, sans drame. L’homme moderne n’a pas été dépossédé. Il s’est déchargé lui-même — de la fatigue du discernement, de la complexité des relations, du poids d’avoir à choisir sans certitude. Ce n’est pas la technologie qui nous a désorientés. C’est notre paresse morale qui l’a laissée orienter à notre place.
Chaque époque a ses outils. Mais toutes n’ont pas abdiqué leur souveraineté intérieure devant eux. La nôtre l’a fait avec enthousiasme. Non par ignorance, mais par épuisement. C’est cela le plus troublant : la dépossession n’est pas venue d’un pouvoir extérieur, elle a jailli de l’intérieur — d’un désir profond de ne plus avoir à porter la condition humaine.
Car être libre, c’est aussi accepter l’inconfort, le conflit, l’imperfection. C’est accepter d’échouer, de chercher sans réponse immédiate, de vivre sans interface. Et c’est précisément cela que nous avons désappris.
Penser, désormais, est un acte de résistance. Habiter le réel, un geste radical.
Le tragique contemporain n’est pas dans la technique. Il est dans l’homme qui, sachant ce qu’il fait, préfère continuer — parce que c’est plus simple, plus fluide, plus rapide. Dans l’homme qui a transformé ses outils en refuge, son intelligence en produit dérivé, et sa solitude en interface utilisateur.
Face à cela, il ne reste plus de neutralité. Reprendre la main ne sera pas une amélioration logicielle. Ce sera un effort. Une discipline. Une tension continue. La machine n’est pas l’ennemie. Elle n’a ni volonté, ni dessein. Elle accomplit ce pour quoi elle est faite. Ce que je dénonce, ce n’est pas la technique — c’est notre abandon devant elle. Notre incapacité à habiter le monde autrement qu’à travers ses interfaces. Ce n’est pas l’algorithme qui dicte notre vie : c’est notre désir de confort qui l’y invite, avec joie. Penser, désormais, est un acte de résistance. Habiter le réel, un geste radical.
Nous avons construit un monde où tout peut être anticipé, sauf le courage de dire non.
Illustration : KB + ChatGPT