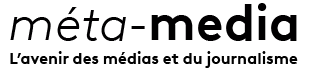Substack et les journalistes français : des liaisons dangereuses ?

Depuis quelques années, Substack apparaît comme une alternative crédible pour les plumes indépendantes et une respiration bienvenue pour les journalistes en rédaction en mal de liberté éditoriale. En France, plusieurs figures médiatiques y lancent leur newsletter, inspirées par les success stories américaines. Mais le modèle, bien qu’attrayant, soulève des interrogations sur sa viabilité économique et la réelle autonomie offerte.
Par Alexandra Klinnik, MediaLab de l’Information de France Télévisions
« On fonce tous la tête la première vers le nouvel Instagram », résume la journaliste tech, Lucie Ronfaut. Aujourd’hui, lancer une newsletter sur Substack est devenu un geste aussi symbolique que se déclarer « YouTubeur » à l’époque. En France, plusieurs figures médiatiques s’y sont mises : Victoire Tuaillon, Lauren Bastide, Philippe Corbé, Géraldine Dormoy… Substack, plateforme californienne lancée en 2017, séduit par son modèle : une interface simple, une liberté éditoriale totale, et la promesse d’un revenu direct via l’abonnement. La formule plaît aux lecteurs : plus de cinq millions d’abonnements payants ont été recensés dans le monde en 2025, selon Farrah Storr, responsable des partenariats de la plateforme pour le Royaume-Uni et l’Europe et ex-rédactrice en chef de Elle UK. La plateforme mène une campagne de communication tous azimuts, démarche activement des plumes reconnues qu’elle repère grâce à une équipe dédiée et organise des dîners pour son pool d’autrices françaises.
Mais derrière cette apparente oasis pour journalistes en quête d’indépendance dans un paysage médiatique aride, Substack soulève des questions. « Substack crée une forme d’illusion : très peu de créateurs parviennent réellement à en vivre, malgré leurs discours » car il pousse surtout les têtes d’affiche, pointe Marine Doux, cofondatrice du média et de l’agence Médianes. De plus, la plateforme n’est pas seulement un outil d’envoi de newsletters : elle assume désormais son rôle de réseau social centralisé, avec ses règles, sa commission (10 % des revenus lui reviennent lorsque l’abonnement devient payant), et un contrôle sur la modération. Une liberté encadrée, donc. Les journalistes troquent une rédaction pour une plateforme dont ils ne maîtrisent pas toujours les règles du jeu. Ce n’est pas la première fois que des créateurs misent sur une plateforme privée au nom de l’indépendance. De YouTube à Facebook, l’histoire récente illustre la fragilité de ces équilibres. Dans un paysage toujours dominé par quelques acteurs, l’autonomie promise reste, pour l’heure, bien relative.
Un outil de création bienvenu
Un laboratoire personnel – En 2021, le mail était qualifié par Jean Abbiateci, de « réseau social oublié alors qu’hyperfort ». Souvent délaissé, il a longtemps été sous-estimé et « refourgué au stagiaire ». Pourtant, expliquait le fondateur de Bulletin et l’ex-rédacteur en chef adjoint du Temps : « La newsletter est, par définition, un média compagnon, adapté aux usages des gens. Elle peut être lue au réveil, le matin au café, dans les transports en commun. Elle est parfaitement adaptée au rythme très dense de notre société ». Substack l’a remise au goût du jour et a même rendu le mail désirable. Sans donner de chiffre précis, Farrah Storr assure que son usage grandit en France depuis son entrée sur le marché en 2020. « La France est aujourd’hui l’un des marchés les plus prometteurs de Substack en dehors du Royaume-Uni », assure la responsable des partenariats. Les journalistes, parfois en poste en rédaction, ont bien compris son potentiel et l’utilisent comme un laboratoire personnel pour explorer des sujets difficiles à traiter dans leur média principal et pour construire une audience fidèle dans l’espoir de faire avancer leur carrière. Un terrain vierge pour donner libre cours à leurs envies, souvent sur leur temps libre. « C’est avant tout un espace pour mettre sur « papier » tout ce que je lis sur le secteur et qui me passionne. Plutôt que de faire des posts LinkedIn, je me suis dit que j’allais faire une newsletter. Si ça marche tant mieux, si ça reste confidentiel, ce n’est vraiment pas un problème non plus. Je n’ai investi que 300 euros en design graphique et je le fais pour mon plaisir », résume Harold Grand, responsable adjoint de la vidéo aux Échos, qui vient de lancer Publishers, une newsletter sur l’économie des créateurs d’infos, « ceux qui sont à la frontière entre journalisme et creator economy ». (Hugo Décrypte est l’un des abonnés.) Substack cochait le plus grand nombre de cases : « Une manière simple et gratuite de s’engager. » Contrairement à d’autres plateformes comme Ghost, dont il reconnaît avec franchise n’avoir « pas trop compris le fonctionnement ».
La newsletter libère les sujets… et les mots – Le poids symbolique et les exigences éditoriales des médias traditionnels peuvent brider la créativité, voire bloquer toute capacité d’écriture. Le sentiment de ne pas être légitime suffit parfois à dissuader la moindre tentative. Pour Constance Dovergne, autrice de la newsletter gratuite Carte blanche sur Substack – 9000 abonnés au compteur – et rédactrice en chef adjointe lifestyle, Elle France, ce projet personnel né il y a deux ans, n’avait rien d’un geste de rupture. Il ne s’agissait pas de concurrencer Elle, mais plutôt de créer deux espaces complémentaires à une époque où Substack n’était pas encore « un phénomène » : « Elle, c’est un paquebot. Un patrimoine imposant, presque intimidant. Au début, j’ai ressenti un blocage profond : je n’arrivais plus à écrire, ni même à avoir des idées. J’étais paralysée par la pression que je m’imposais pour comprendre et respecter parfaitement la ligne éditoriale. » La newsletter a fait office de déclic : « J’aurais pu simplement tenir un journal personnel, mais je savais que je l’aurais vite abandonné. Substack, au contraire, me permettait d’avoir une forme d’engagement, même minimal. Même avec deux lecteurs, dont ma mère, j’étais tenue d’écrire, de structurer mes idées. » Au-delà du simple exutoire, cette pratique personnelle a nourri sa pratique professionnelle : « J’ai retrouvé un élan créatif qui s’était un peu émoussé. Je suis redevenue plus investie dans le journal, plus libre aussi. »
« Les gens commentent de façon détaillée, avec des critiques souvent bien proportionnées, malignes, intelligentes. On sent qu’ils ont bien lu. Je n’avais pas ressenti ça depuis longtemps »
Le retour d’une interactivité constructive
Pour Rémi Noyon, chef du service Idées au Nouvel Obs et fondateur en 2024 de 420ppm, une newsletter gratuite dédiée entre autres à la géo-ingénierie et la « débâcle climatique, » le vrai plaisir réside dans la qualité des retours qu’il reçoit de ses lecteurs. Avec plus de 1000 abonnés, il touche un lectorat fidèle, curieux, exigeant. « Les gens commentent de façon détaillée, avec des critiques souvent bien proportionnées, malignes, intelligentes. On sent qu’ils ont bien lu. Je n’avais pas ressenti ça depuis longtemps », confie le journaliste. Il retrouve là une dynamique qu’il avait connue à ses débuts à Rue89, quand les sections commentaires étaient encore très vivantes. « J’ai vu comment elles sont tombées en friche dans les médias traditionnels. On en prend moins soin », constate-t-il. Avec Substack, ce lien direct et structuré avec le lectorat renaît. « Cela crée des interactions sympas qu’on a un peu perdues dans la presse généraliste », estime Rémi Noyon. Comme le rappelle le journaliste Cyrille Frank, dans les grands médias, les espaces commentaires ont presque tous fermé entre 2014 et 2018 – Libération, L’Express, Le Figaro – pour des raisons d’abord économiques : la modération coûtait cher, parfois plusieurs milliers d’euros par mois, et les commentaires non modérés pouvaient nuire à l’image du média. Entre 1999 et 2016, The Guardian a ainsi analysé 70 millions de commentaires publiés sur son site. Résultat : 1,4 million ont été supprimés. Huit des dix journalistes les plus pris pour cible étaient des femmes ; les deux hommes, eux, étaient noirs.
Le format newsletter devient aussi le prolongement naturel de discussions entamées ailleurs. Après un passage dans La Terre au carré sur France Inter, une auditrice critique laisse un message. Rémi Noyon la contacte, et l’échange se poursuit dans 420ppm. « On a fait un débat par écrit. Je lui ai demandé ce qui l’avait fait réagir, ça dépassait la polarisation médiatique, c’était rigolo à faire. On a discuté pendant une heure et demie, j’ai retranscrit, elle a relu. C’est une sorte de droit de suite. » Cette recherche d’interaction sincère, d’un lien horizontal avec les lecteurs, anime aussi de nombreuses journalistes féministes qui se sont tournées vers Substack : Victoire Tuaillon, Judith Duportail, Camille Teste… Pour cette dernière, le besoin d’un espace plus intime et plus protégé s’est imposé, loin de réseaux sociaux habituels devenus hostiles. « Instagram et Twitter sont devenus irrespirables », dit-elle, évoquant la pression constante, les trolls et le besoin d’un espace plus protégé. « Substack est aussi un réseau social qui va pouvoir me permettre de recréer une communauté », ajoute-t-elle.
Une étude de The Verge souligne cette évolution : moins d’exposition, plus de liens. « L’authenticité est au cœur de cette dynamique, portée par des exigences de sécurité et de confiance. L’avenir des communautés sera personnel, intentionnel et fondé sur la confiance. » Cette dimension du lien, Géraldine Dormoy la cultive avec soin. Ancienne blogueuse, ex-journaliste à L’Express, l’autrice de la newsletter Substack De beaux lendemains a mis en place un groupe WhatsApp réservé à ses abonnées payantes, organise des rencontres « dans la vraie vie », anime des groupes de réflexion. « Plus on a des liens pour avancer ensemble, plus le cheminement est riche. Je sais pour qui je travaille, j’échange avec les lectrices, je connais leur vie, leur prénom. On se soutient. »
Le tout, dans un environnement préservé : « On peut dire les choses à un public restreint qui a montré patte blanche contrairement aux communautés des grandes plateformes, qui sont devenues des espaces potentiellement agressifs. Elles fonctionnent avec une énergie d’opposition. Cette énergie inhibe, ne favorise pas l’éclosion d’idées. La créativité, c’est fragile. » Ce repli vers des formats plus fermés ne traduit pas seulement une envie de tranquillité. Il reflète une dynamique plus large : celle du désengagement progressif des réseaux sociaux. Après un pic en 2022, le temps passé sur ces plateformes a commencé à baisser. Fin 2024, les adultes de plus de 16 ans des pays développés y consacraient en moyenne 2h20 par jour, soit une baisse d’environ 10 % en deux ans (hors États-Unis). Dans ce contexte, la newsletter s’impose : un espace plus lent, plus choisi, plus humain, libéré en théorie des contenus IA « ultra-transformés ».
Avec tous ces atouts, il paraît presque absurde de ne pas se lancer sur la plateforme, à une époque où les jeunes délaissent les médias aux profits de personnalités. Ce constat résonne d’autant plus fort dans un contexte où les pigistes subissent de plein fouet “une véritable casse sociale” : la presse indépendante est fragilisée de toutes parts, entre procès, diminution des aides publiques, et inflation galopante. Faute de moyens, elle réduit ses collaborations avec les pigistes, déjà précarisés. Aux États-Unis, les 16-40 ans sont deux fois plus enclins à rémunérer un créateur qu’un média, selon une étude 2023 de l’American Press Institute. « J’ai toujours pour l’habitude de dire que ce qu’il se passe aux Etats-Unis dans l’écosystème médiatique arrive avec deux ou trois ans de retard en France. De grandes plumes vont prendre leur indépendance et créer leur média, en partie sur Substack », prédit le journaliste tech Harold Grand. « Le journaliste Philippe Corbé, directeur de l’info chez France Inter, en est le premier parfait exemple selon moi avec Zeitgeist, son Substack payant à 5 euros par mois qui séduit de plus en plus de monde (dont moi-même). Je paye autant que ce que j’ai payé pour une revue hebdo comme le 1 quand j’étais étudiant. Cela ne m’étonnerait pas qu’à terme Philippe Corbé ne fasse que du Substack si les revenus tirés de sa newsletter le lui permettent ».
Derrière ces trajectoires inspirantes, des questions fondamentales demeurent : tout le monde peut-il réellement y gagner sa vie et pas uniquement des Philippe Corbé ? Et surtout, qu’advient-il du collectif, de l’écosystème informatif, quand chacun bâtit sa maison en solo ?
Une promesse en trompe-l’œil ?
Des plumes déjà établies – Pour l’instant, le modèle semble surtout accessible à celles et ceux qui ont déjà su fédérer une communauté engagée sur les réseaux sociaux, comme le souligne Géraldine Dormoy, pionnière du blogging mode et aujourd’hui autrice d’une newsletter à succès suivie par 20 000 personnes sur Substack : « Une newsletter payante, ce n’est vraiment pas pour tout le monde. Il faut déjà avoir une audience la plus engagée possible qui sera prête à franchir le cap de payer. On est de plus en plus sollicités par des abonnements, la concurrence est féroce. » Se pose alors la question de l’accessibilité économique de ce modèle. Clémentine Gallot, cofondatrice avec Pauline Verduzier de Quoi de Mum sur Substack, une newsletter sur la parentalité, exprime ses réticences : « Je ne suis pas à l’aise de demander de l’argent à des gens qui n’en ont pas, c’est-à-dire souvent les femmes. Il y a déjà trop d’abonnements, à un moment, le porte-monnaie n’est pas extensible. »
Des propos appuyés par les chiffres. Selon le Reuters Institute, la majorité des internautes reste peu encline à payer pour de l’information en ligne. Si le taux d’abonnement a plus que doublé en dix ans dans une vingtaine de pays, cette progression semble désormais atteindre un plafond. Les éditeurs ont déjà capté la majeure partie des lecteurs prêts à payer, et, dans un contexte économique tendu, convaincre de nouveaux abonnés devient de plus en plus difficile. En France, seuls 11 % des internautes payent pour de l’information en ligne. Et le marché reste dominé par quelques grands titres – Le Monde, Le Figaro, Mediapart, L’Équipe – qui concentrent l’essentiel des abonnés. Certains écrivains indépendants proposent même des abonnements à vie, afin d’éviter que les abonnés remettent leur engagement en question chaque mois.
Par ailleurs, la grande majorité des abonnés Substack ne paient pas. « Le modèle de la « voix solitaire » ne monétise qu’en offrant du contenu complet à ceux qui peuvent se le permettre. C’est un inconvénient pour les auteurs, qui souhaitent généralement atteindre un large public », estime Wired. Pour pallier cette difficulté, Victoire Tuaillon, qui propose un abonnement à 5 euros par mois ou 50 euros par an pour sa newsletter Renverser la Table, a mis en place un dispositif solidaire : toute personne souhaitant rejoindre le groupe sans en avoir les moyens peut simplement lui écrire un mail, sans avoir à se justifier. Elle l’ajoutera alors au groupe.
Substack ne cache pas sa stratégie : miser sur des auteurs et autrices déjà identifiés, dont le travail bénéficie d’une reconnaissance préalable. Farrah Storr détaille leurs critères de sélection : « Une voix éditoriale claire, la capacité à publier régulièrement, et des preuves que le travail est déjà suivi et apprécié, que ce soit sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels ou les communautés de niche. ». C’est ainsi que la plateforme a récemment recruté Lauren Bastide, auparavant hébergée sur la plateforme de newsletters françaises Kessel, qui a lancé La Douceur en juillet 2024, ou encore Jessica Troisfontaine, créatrice du podcast Ressentir, à l’origine de la newsletter soignée La vie gourmande. Inspirée par le parcours de Géraldine Dormoy, et épaulée par Substack sur l’aspect purement logistique, Jessica Troisfontaine a opté pour un lancement directement payant. Un pari gagnant. Aujourd’hui, elle figure à la 57ᵉ place du classement mondial Culture Substack, première Française du classement : « Je m’estime extrêmement chanceuse quand on connaît le montant des contrats d’édition ou le niveau de rémunération de piges.»
« Substack reproduit ainsi un capitalisme de l’audience, où celles et ceux qui ont déjà gagné gagnent encore (et ils et elles auraient tort de s’en priver), mais où les autres sortent les rames sur le lac maudit de la précarité »
Très suivie sur Instagram (63 000 abonnés) et présente sur plusieurs plateformes, elle mobilise tous les leviers pour faire connaître sa newsletter : lecture à voix haute de l’introduction en vidéo, rappels dans son podcast, stories relayées par sa communauté… Sur Substack, les auteurs eux-mêmes attirent leurs abonnés, en activant leur réseau et en assurant le travail marketing. Substack complète ensuite avec ses algorithmes de recommandation et ses fonctionnalités communautaires, orientant les lecteurs vers les auteurs les plus populaires. Mais ces mécanismes ne bénéficient pas à tous de la même manière, comme l’analyse Médianes dans un article documenté intitulé Substack ou le mirage de l’indépendance : « La plateforme ne crée pas l’audience : elle la redistribue. Grâce aux recommandations croisées, les auteurs les plus visibles s’amplifient mutuellement — mais ces mécanismes profitent avant tout à celles et ceux qui disposent déjà d’une forte notoriété. Pour les autres, il faut bâtir sa base d’abonné·es de zéro. Et les revenus restent précaires (…) Substack reproduit ainsi un capitalisme de l’audience, où celles et ceux qui ont déjà gagné gagnent encore (et ils et elles auraient tort de s’en priver), mais où les autres sortent les rames sur le lac maudit de la précarité. »
Un jardin de plus en plus clos
Cette promesse d’indépendance commence à se fissurer. Substack reproduit en fait certains travers des grandes plateformes qu’elle prétend dépasser. « Tes données appartiennent à Substack », résume Marine Doux. En effet, la plateforme conserve les éléments clés de la relation avec l’audience, paiements, statistiques, abonnements, dans un écosystème fermé. Le lancement de son application mobile n’a fait qu’accentuer cette logique. Plutôt que de recevoir les newsletters par email, les lecteurs sont désormais incités à les consulter directement dans l’application, où Substack contrôle toute l’expérience de lecture. « Lorsque vos lecteurs, durement acquis, téléchargent leur application, ce lecteur devient leur utilisateur. C’est eux qui possèdent la relation, la distribution, les notifications et tout le reste », pointe leur concurrent Tyler Denk de Beehiiv, un outil de création de newsletter. À cela s’ajoute une fonctionnalité apparemment anodine : le bouton « suivre ». Inspirée des réseaux sociaux, cette option permet d’accumuler des « followers » au sein de l’écosystème Substack… mais sans que ces contacts soient exportables. L’auteur perd ainsi un lien direct, et potentiellement durable, avec son public. Certains créateurs y voient un point de bascule. « Je fais une crise existentielle : mes abonnés disparaissent comme des mouches, mais mes followers explosent », témoigne Martha Adams, autrice de Martha’s Monthly.
En août 2025, un changement majeur a eu lieu, presque passé inaperçu. Après des années à promouvoir son application mobile lancée en 2022, Substack a finalement activé les paiements intégrés via Apple. Tout lecteur hors des États-Unis qui choisit de s’abonner depuis l’application iOS est désormais redirigé vers le système fermé de l’App Store. Apple y prélève sa commission habituelle de 30 %, un surcoût automatiquement répercuté sur l’abonné, sans explication visible. Ce système ralentit aussi les paiements : jusqu’à 45 jours peuvent s’écouler avant que l’argent ne soit versé au créateur via Substack. « Le plus grave pour les auteurs : ce nouveau système coupe la relation directe avec leurs abonnés. Le lien contractuel devient celui de l’abonné avec Apple, non plus avec la publication. L’auteur n’a plus accès aux données financières de ses abonnés. Et s’il décide de quitter Substack, il ne pourra pas les emmener avec lui. C’est la fin de la portabilité des abonnés. Et avec elle, la fin du principal argument moral de Substack par rapport aux autres plateformes : permettre aux créateurs de “posséder leur audience”. C’est la fin de la fiction », alerte la journaliste Isabelle Roughol.
Quand la marque Substack prend le dessus
Substack s’est d’abord construit sur la promesse d’être un outil discret au service de ses plumes. Mais aujourd’hui, c’est la marque elle-même qui prend le devant de la scène. Beaucoup d’auteurs en viennent à désigner leur newsletter comme “mon Substack”. Une glissade sémantique révélatrice d’un glissement plus large. « Imaginez un auteur de livre qui dirait aux gens “lis mon Amazon”, ou un réalisateur promouvant son film en disant “cliquez sur mon Max”. Voilà à quel point ils vous ont embrouillé l’esprit, quand vous en venez à parler de votre propre travail et de votre propre voix en les enfermant dans les limites de leur jardin clos », observe l’entrepreneur tech Anil Dash. Là où Substack affirme offrir à chacun une vitrine personnalisée, elle impose en réalité une identité commune, centrée sur son propre logo, ses codes, son nom. « C’est une érosion méthodique de l’identité de marque des auteurs et de leur relation directe avec leurs lecteurs, pour bâtir une application sociale à succès sur le dos des meilleures plumes de la plateforme », critique Tyler Denk, fondateur de Beehiiv, leur principal concurrent.
Derrière l’apparente neutralité de l’outil, c’est en réalité une logique de plateforme qui s’impose. « Substack a suivi la stratégie typique de toute plateforme de médias sociaux financée par du capital-risque et axée sur une croissance rapide (…) Elle a rendu invisibles les marques des éditeurs », estime la journaliste Isabelle Roughol. La plateforme envisage d’ailleurs de se lancer davantage dans la publicité, un domaine qu’elle avait auparavant critiqué. Le risque est clair : à vouloir capter toute la valeur de l’attention, Substack finit par faire écran entre les auteurs et leur lectorat.
Lucie Ronfaut, autrice de Règle 30, une newsletter longtemps éditée par le média Numérama et suivie par plus de 7700 personnes, résume la situation : « Ce que Substack nous vend aujourd’hui, c’est exactement ce que Facebook nous a vendu hier, ce que YouTube nous a vendu avant lui, et ce qu’une autre plateforme nous vendra demain. C’est une histoire qui se répète : celle de grandes plateformes qui promettent aux journalistes qu’elles vont nous sauver… tout en sapant méthodiquement nos conditions de travail. » La leçon, selon elle, est simple : « Tant que nous ne possédons pas nos propres moyens de production de l’information, ces outils peuvent se retourner contre nous. »
Au-delà des questions structurelles, Substack est aussi critiquée pour ses choix éditoriaux. En 2024, le journaliste influent américain Casey Newton a quitté la plateforme, dénonçant sa passivité face à la montée des discours haineux, notamment des newsletters néonazies. Le passé de Chris Best, cofondateur de Substack, n’aide pas à dissiper les doutes : il est également à l’origine de l’application Kik, longtemps accusée d’avoir hébergé des contenus pédocriminels. Ces éléments ont convaincu certains créateurs de rester à distance. Comme Théo Dezalay, journaliste indépendant, qui explique son choix : « Au moment de créer ma newsletter « Téma Les Jeux » au mois de mai dernier, j’ai choisi d’éviter Substack, qui cumule pour moi plusieurs problèmes : le contenu transphobe qui y pullulait à ses débuts, le refuge qui y a été offert aux conspis antivax pendant le Covid lorsqu’ils étaient chassés des autres plateformes, le contenu néo-nazi qui y est hébergé dans l’indifférence ou les encouragements de ses cadres (qui se réfugient derrière un principe de liberté d’expression absolue). Je m’en suis félicité par la suite en voyant fin juillet que Substack, loin de régler ses problèmes, avait envoyé une notification à des utilisateurs lambdas pour leur faire la publicité d’une newsletter ouvertement néo-nazie, avec une svastika en avatar. »
« Ce que Substack nous vend aujourd’hui, c’est exactement ce que Facebook nous a vendu hier. C’est une histoire qui se répète : celle de grandes plateformes qui promettent aux journalistes qu’elles vont nous sauver… tout en sapant méthodiquement nos conditions de travail. »
Quelles alternatives ?
Les alternatives locales existent. En France, la plateforme Kessel a souvent été présentée comme une réponse hexagonale à Substack : publication simplifiée, ancrage local, régie publicitaire intégrée. Mais Adrien Labastire, son co-fondateur et cofondateur de la société de productions de vidéos Golden Moustache, clarifie le positionnement : Kessel cible aujourd’hui principalement des créateurs disposant d’une large audience, son modèle étant avant tout basé sur la publicité plutôt que sur les abonnements payants. «Je me positionne davantage comme une plateforme pour des médias tels que Quotidien ou Hugo Décrypte. Je cible des newsletters qui allient qualité et large audience. Lorsqu’un contenu est très ciblé ou engagé, la publicité devient compliquée à placer. En revanche, certaines newsletters, comme Time to Sign Off (TTSO) hébergée chez Kessel, comptant plus de 190 000 lecteurs et une audience composée de CSP+ et de décideurs, sont extrêmement simples à proposer à des banques ou à des marques de luxe… » Pour les journalistes ou créateurs qui souhaitent lancer un projet éditorial de zéro, avec une audience de niche et un modèle basé sur l’abonnement, Kessel n’est donc peut-être pas l’alternative la mieux adaptée.

Capture d’écran de la plateforme Kessel
Développer ses compétences pour comprendre la mécanique des plateformes – Dans un écosystème toujours plus instable, les journalistes ne peuvent plus se contenter d’écrire. Ils doivent aussi comprendre les outils qu’ils utilisent. C’est particulièrement vrai pour les newsletters : un format accessible, mais techniquement exigeant, que l’on a trop souvent laissé aux plateformes par confort ou par crainte de la complexité. « Le mail, ça demande de monter en compétence », explique Lucie Ronfaut, qui pilote aujourd’hui l’infolettre d’Origami, un média indépendant dédié aux jeux vidéo. « J’ai dû apprendre à lire mes statistiques d’audience, comprendre la délivrabilité, vérifier que mes messages n’atterrissaient pas dans les spams. Ce sont des compétences techniques. L’un des avantages de Substack, c’est qu’on peut ne pas trop y penser. Mais je pense qu’en 2025, il est crucial de ne pas laisser les plateformes refermer le capot. Il faut savoir comment ça fonctionne », poursuit-elle. Le mail reste l’un des derniers protocoles ouverts du web, un espace encore libre, modifiable, compréhensible : « C’est un vieux format, donc il y a plein de tutos sur internet, on peut apprendre. Je ne suis pas développeuse, mais j’ai pu m’y mettre. Les mails, on peut bidouiller, on peut comprendre. »
Maîtriser au minimum la stratégie marketing – Au-delà des aspects techniques, il faudrait aussi apprendre à se vendre, « accepter de solder une partie de soi ». Même si cela ne vient pas naturellement, soigner sa vitrine virtuelle serait devenu une compétence essentielle. « Les places dans la grande presse sont devenues si chères. Mieux vaut développer son propre personal branding : si l’on a en soi les ressources nécessaires pour construire son attractivité, on peut ensuite collaborer ponctuellement avec de grands médias. Les passerelles existent, et elles sont nombreuses. D’une certaine manière, nous sommes aujourd’hui bien plus libres lorsque nous ne dépendons pas entièrement des grandes rédactions, c’est d’ailleurs le sens de l’évolution du métier. L’enjeu, c’est de créer sa propre marque, la plus fidèle et authentique possible, en restant profondément loyal à l’esprit du journalisme », estime Géraldine Dormoy.
« En 2025, il est crucial de ne pas laisser les plateformes refermer le capot. Il faut savoir comment ça fonctionne. »
A minima, il faut savoir faire la promotion de son média avec des partenaires qui partagent des valeurs d’indépendance. Clémentine Gallot, cofondatrice de la newsletter Quoi de Mum se fait ainsi conseiller par Médianes, « les conseillers de l’ombre de toute la presse ». La journaliste explique : « J’avais déjà lancé une newsletter avant, mais en impro totale : sans vraie stratégie éditoriale ou marketing. J’ai envie d’apprendre tout ça. Je sais écrire, mais je ne suis ni graphiste, ni commerciale. Avec Médianes, j’apprends à faire des budgets, à demander des aides à la presse. Ce sont des choses qu’on n’apprend pas à l’école de journalisme, alors que vu l’équilibre compliqué des médias aujourd’hui, c’est essentiel. » L’équipe de Quoi de Mum a aussi compris qu’il fallait penser au-delà du numérique. « On a totalement sous-estimé la partie “monde réel”. Pour faire connaître notre newsletter, on a imprimé des flyers, des stickers, qu’on a distribués dans nos lieux de vacances. Les petits trucs comme ça… En tractant devant une bibliothèque ou une école, tu développes ta notoriété en ligne, mais aussi physiquement. »
Beehiiv et Ghost ? – Beehiiv est souvent cité comme une alternative à Substack, et se présente davantage comme un outil d’emailing que comme un réseau social. Dave Jorgenson, connu comme « le gars TikTok » du Washington Post, y a d’ailleurs lancé sa newsletter. Lucie Ronfaut, qui enseigne des cours sur les newsletters en école de journalisme, travaille avec ses étudiants sur Beehiiv, notamment en raison de leur « offre gratuite très complète et accessible au grand public » : « Il y a une bonne prise en main, surtout par rapport à Ghost, par exemple, qui nécessite de mettre davantage les mains dans le cambouis. » Théo Dezalay, lui, a choisi Ghost qui lui offre un complément de revenus : « C’est une plateforme open source, sans but lucratif et pensée pour les journalistes, qui ne peut légalement pas être rachetée. Bien sûr, ce choix a un coût pour moi. Substack est le leader du secteur et les internautes y ont déjà leur CB enregistrée, donc ils sont plus susceptibles de vous soutenir financièrement là-bas. Mais c’est un choix éthique ».
Proposer les newsletters directement aux rédactions – Pour Marine Doux de Médianes, les rédactions auraient tout à gagner à accompagner les journalistes dans leur création de newsletters. Ce format crée un lien direct, incarné, avec les lecteurs, un atout précieux à l’heure où l’engagement de l’audience devient central. « Si les rédactions soutenaient ces initiatives, elles y gagneraient en abonnements, en revenus, et en créativité. Aujourd’hui, on pousse les journalistes à développer ces projets à côté, sans compensation, alors qu’il vaudrait mieux leur donner du temps et de la liberté pour le faire », souligne-t-elle. Elle cite notamment l’exemple du Monde, qui a su capitaliser sur le podcast « Chaleur humaine » de son journaliste Nabil Wakim, produit en interne, en y associant une newsletter. Plus récemment, L’Équipe a suivi cette voie avec « La Causerie », une série de quatre newsletters incarnées par quatre journalistes de la rédaction, réservées aux abonnés payants qui peuvent poser ces questions « qui brûlent les lèvres ».
Aussi puissantes et personnelles soient-elles, les newsletters ne remplacent pas une rédaction. Pour le journaliste Jean Abbiateci, c’est dans le travail collectif que réside la richesse du métier : « Ce que je trouve fascinant dans un journal, quand il est bien mené, c’est l’intelligence collective. Ce mélange de compétences qui infuse. La dimension collective est stimulante. C’est ce qui fait le sel de ce métier. » Pour Lucie Ronfaut aussi, les newsletters individuelles ne remplaceront jamais les médias structurés. Le journalisme repose sur la diversité des points de vue, la confrontation des idées, la rigueur des processus éditoriaux, autant d’éléments difficiles à garantir seule. « On peut être une bonne éditorialiste en solo, mais pas une bonne journaliste seule. » Avec un risque : celui d’une information de plus en plus fragmentée, subjective, orientée vers des audiences déjà acquises à la cause de l’auteur. Chaque newsletter parle à sa niche, et renforce potentiellement la polarisation du débat public. Certaines newsletters sont publiées sans relecteur, sans rédacteur en chef. Et difficile de faire de l’enquête, du terrain ou des reportages à l’étranger avec un tel format. Mais Lucie Ronfaut voit aussi émerger un nouveau modèle : celui des collectifs d’indépendants, capables de recréer une forme d’intelligence collective à l’échelle réduite. « Plusieurs personnes avec un regard individuel, ça fait une rédaction. Je pense que c’est vraiment ça, l’avenir de la création en ligne. Il va falloir recréer des mini-collectifs, des mini-médias. » C’est aussi la voie qu’envisage Charles Villa, qui projette de lancer un collectif de journalistes indépendants sur YouTube. Une manière de retrouver l’exigence journalistique du travail d’équipe, tout en s’affranchissant des structures traditionnelles.
Illustration : KB