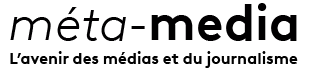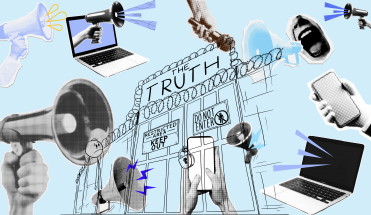Didier Pourquery « La nuance permet de reconstruire des espaces de dialogues utiles à la vie démocratique »

À l’ère des clashs permanents, de la défiance généralisée, peut-on encore « conférer », selon le mot de Montaigne ? A-t-on encore la patience de la nuance ? Didier Pourquery, auteur de Sauvons le débat : osons la nuance, en fait un levier pour reconstruire un dialogue fondé sur le réel.
Propos recueillis par Alexandra Klinnik, MediaLab de l’Information de France Télévisions
Fake news, complotismes, déformation des faits : comment débattre dans un monde où le réel lui-même semble contesté ? Didier Pourquery, président de The Conversation France, défend l’idée que la nuance – fondée sur l’écoute, la curiosité et le doute – n’est pas un luxe d’intellectuel, mais une condition pour reconstruire une conversation démocratique fondée sur des savoirs partagés.
En 2021, dans votre essai Sauvons le débat : osons la nuance, vous défendiez l’idée que la nuance est essentielle pour réhabiliter un espace de dialogue sain. Quels sont les pouvoirs de la nuance ?
La nuance n’est pas une baguette magique, mais elle est puissante. Elle est un outil qui permet d’approcher du mot juste ; un état d’esprit qui cherche la résolution dans l’exploration des interstices ; un ensemble de dispositifs conversationnels qui recherchent des points d’équilibre, des lieux de passage. Le but ici, grâce à cet outil, est de reconstruire des espaces de dialogues utiles à la vie démocratique. Les principaux ennemis auxquels la nuance s’attaque sont l’urgence, la défiance, la violence, l’arrogance…
Toutes ces maladies du débat qui coupent, limitent, déforment et donc empêchent de converser utilement. Face au déluge informationnel, à l’urgence imposée, à la communication envahissante (que l’on songe aux trois annonces quotidiennes que Trump a faites durant ses cent premiers jours) l’approche nuancée conduit à choisir les « slow medias », à maitriser son régime informationnel, à chercher des sources d’information qui apportent des analyses, plutôt que du « bruit ». C’est d’autant plus important que les personnalités politiques anti-démocratiques utilisent des ressorts très puissants : la saturation médiatique, l’outrance verbale, la violence qui joue avec les émotions des citoyens. L’âge des populismes dans lequel nous vivons est dangereux parce qu’il s’appuie sur des réseaux sociaux bâtis pour attirer l’attention via les émotions. La défiance – ou méfiance généralisée et obtuse – est une autre plaie des temps. Elle revient à rejeter systématiquement toutes les sources de savoir officielles et toutes les décisions fondées sur des démarches raisonnées. Encore une fois, on voit le résultat dans le trumpisme triomphant. La défiance fait le lit de tous les complotismes, elle fausse les perceptions… Face à cette maladie, la nuance cherche à mettre en place de véritables conversations entre tiers de confiance : des chercheurs, de vrais experts, des gens qui, somme toute, se coltinent au réel. Les faux débats, le catch médiatique des plateaux d’experts autoproclamés, ont fait beaucoup de mal à la confiance que les citoyens pouvaient avoir en la connaissance. Il faut reconstruire tout cela en injectant des morceaux de vrais savoirs dans les échanges citoyens. C’est cela aussi la nuance : installer ici ou là des sources de savoir simples et utiles pour saisir ce qui advient.
La nuance suppose une forme de doute intérieur, presque une modestie de la pensée : est-elle encore compatible avec un monde où chacun est sommé de s’affirmer, de prendre position, de performer son opinion ?
La nuance s’appuie sur un élément qu’il faut à nouveau apprendre à l’école : l’écoute. La modernité a poussé les individus à d’abord s’exprimer, parler, écrire, exister en prenant la parole. Les réseaux sociaux ont augmenté cette tendance. Par ailleurs, l’éloquence est à nouveau valorisée au collège et au lycée, ce qui est une bonne chose puisqu’elle suppose la maîtrise de quelques outils rhétoriques toujours utiles. Mais il est temps d’apprendre aussi l’art de la conversation, l’art de conférer cher à Montaigne et qui, aux XVII et XVIII siècle, a produit les magnifiques échanges des salons. Or dans ces salons, l’écoute courtoise, curieuse, active et interrogative était pratiquement aussi valorisée que les beaux discours. C’est cela qu’il convient de retrouver. Certes cela suppose une part de doute, de modestie, mais aussi une grande curiosité, une vraie volonté de comprendre ce que me dit l’autre, pourquoi il le dit et ce que ce qu’il dit peut entraîner. On confond souvent l’écoute et le fait de rester silencieux pendant que l’autre parle. Observez les plateaux de catch de CNews ou autres : les intervenants n’écoutent pas vraiment, ils préparent leur prochaine punchline, leur prochain clash dans un format aussi court que possible puisqu’il doit être remarqué sur les réseaux sociaux. Face à ce genre de caricatures de débats, de simulacres en circuit fermé, la nuance propose de promouvoir l’écoute active – interrogeante – avec toute l’ouverture qu’elle suppose.
Or les deux modèles omniprésents sur les plateaux de combat audiovisuels sont celui de celui qui parle fort, qui « tonitrue » (que j’appellerai le « tribun sur commande») et l’arrogant (celui qui non seulement n’écoute pas l’autre, mais le méprise). Montaigne, déjà, considérait ces deux-là comme des plaies quand il s’agissait d’échanger, de conférer pour chercher une voie, tenter de s’entendre. Il refusait d’ailleurs de converser avec eux, il pensait que c’était perdre son temps.
La nuance ne commence-t-elle pas par un accord préalable sur la « question à résoudre ». En quoi la nuance est-elle aussi un pacte sur le réel ?
Montaigne, encore lui, met cette question au cœur de toute conversation. Rappelons que l’auteur des Essais exerce ses talents de médiateur en des temps extrêmement violents – les guerres de religion – où l’on peut s’écharper pour quelques mots dans la Bible. Montaigne est le bon exemple d’un philosophe qui réfléchit au milieu du chaos… et qui montre bien que l’on peut réfléchir à la nuance, la modération en période de conflits, de tensions, de violences sans merci. On me dit souvent : il n’est plus temps de miser sur la nuance, l’extrême droite est à nos portes, il faut la combattre avec ses armes. Je pense que justement c’est le bon moment pour calmer le jeu et mettre en œuvre des débats apaisés. Alors oui, mais de quoi va-t-on « conférer » ? En quoi tel ou tel thème est important à mettre en conversation ? (Plutôt que : contre qui vais-je me battre ce soir pour « faire le show » ?) Pouvons-nous nous entendre au moins sur les questions qui se posent, les questions de fond, et non les polémiques instantanées. Les controverses plutôt que les polémiques. Ce premier pas est crucial et relève entièrement de la nuance ; on quitte le domaine de l’émotion pour approcher celui de la raison ; le sens critique est à l’œuvre ; l’honnêteté est de mise.
Et puis quoi ? En ces temps de post-vérité et de propagande, il ne s’agit pas de chercher à se mettre d’accord sur « la » vérité, mais sur la réalité. Il faut revenir à des choses simples, un pacte minimum en effet : parlons du réel. Que se passe-t-il ? Reconnaissons que ce n’est pas simple, il s’agit d’un gros travail ; mais si, au moins, on peut mettre en avant des chiffres, des faits, des analyses sérieuses on va dans le bon sens.
Dans un monde où les faits eux-mêmes sont contestés, la nuance a-telle encore une chance d’émerger ? Si deux personnes ne s’entendent même pas sur la définition du problème, à quoi bon débattre ?
Évidemment, la définition d’un fait est toute une affaire. Un fait scientifique, juridique, journalistique… déjà on entre dans les difficultés. Mais justement, c’est de cela dont d’abord il faut parler. L’idée de « conférer » chère à Montaigne vient aussi de la disputatio du Moyen-Âge. On prend un morceau de texte et on l’observe sous toutes les coutures, on débat du sens, il y a des techniques bien sûr, mais au départ il y a cette envie d’en savoir plus.
Car – et c’est l’essentiel – conférer, converser est d’abord une manière d’apprendre ensemble. Il y a un commun, là : une volonté d’en savoir plus. Montaigne le dit très clairement : je veux converser car c’est vraiment ainsi que j’apprends. Les salons où l’on menait des conversations sous l’Ancien Régime servaient à répandre des idées nouvelles, à partager des savoirs. On en revient à l’importance de l’écoute, de la curiosité. Mobiliser les savoirs des uns et des autres de façon à produire – par le « frottement de nos cervelles » comme dit Montaigne – non pas la vérité, mais un savoir commun solide.
Comment reconstruire concrètement ce «socle de réel» dans une société fragmentée ?
Une voie à laquelle je crois – et que j’ai expérimenté aussi bien à The Conversation qu’à Cap Sciences – commence par se poser la question du tiers de confiance. Quelles sont les professions qui inspirent le plus de confiance ? Dans le peloton de tête on trouve les métiers du savoir et notamment les chercheurs. On a là une piste. Mais contrairement à ceux qui veulent asséner « la science » pour clore tout débat, il vaut mieux partager avec le plus grand nombre la démarche scientifique. La science en train de se faire nous apprend que le doute fait partie de cette démarche-là et qu’il est naturel de douter, y compris de ce que l’on voit, pour aller voir derrière, dessous. Elle nous enseigne que chercher peut être aussi passionnant qu’une enquête policière. Elle nous montre aussi que la controverse est un outil très nécessaire pour faire avancer les savoirs scientifiques. À chaque fois que l’on parle de doute, ou de controverse cela permet de parler de leur différence avec la défiance et la polémique ; ainsi, on avance sur des concepts solides.
Il existe de nombreux moyens d’apprendre la démarche scientifique. Prenons un exemple simple : celui de la science participative, ou de la science citoyenne. Des chercheurs mobilisent des citoyens pour les aider au recueil de faits, d’informations de terrain, puis ils les tiennent au courant des étapes suivantes de leur recherche, étapes franchies grâce notamment aux données recueillies pas ces citoyens. Tout le monde y gagne et à la fin les citoyens en ont appris un peu plus sur la démarche scientifique. C’est à travers ce genre d’opérations modestes, souvent locales, que l’on va peu à peu faire passer les idées nécessaires à un débat apaisé. Concentrons-nous d’abord sur le « comment » avant d’aborder le « pourquoi » : comment travaillent les chercheurs, mais aussi comment fonctionnent les médias. L’éducation aux médias et à l’information, tout au long de la vie, permet de mieux saisir les concepts, de faits, d’événements, de communication et de fiabilité des sources. Ce sont les bases d’une vraie conversation, nuancée et productrice de savoirs.

Couverture du livre de Didier Pourquery, publié aux Éditions Presses de la Cité